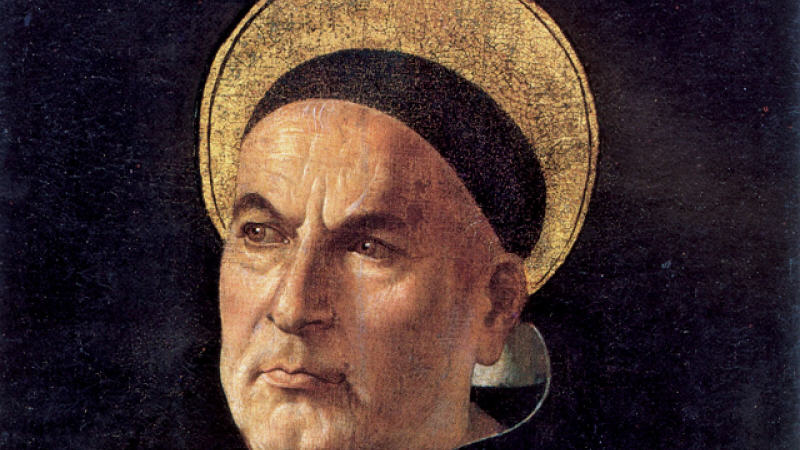 |
Pour beaucoup, il est normal que Dieu déverse sur eux sa miséricorde
alors qu'ils demeurent dans le péché...
|
Le 22 novembre 2023 -
E.S.M.
-
Beaucoup de fidèles se réjouissent d'entendre parler de la
miséricorde divine, et ils espèrent que la radicalité de l'Evangile
pourrait s'assouplir même en faveur de ceux qui ont fait le choix de
vivre en rupture avec l'amour crucifié de Jésus. Ils ne mesurent pas
le prix payé par lui sur la Croix, qui a délivré chacun de nous du
joug du péché et de la mort. Ils estiment qu'à cause de l'infinie
bonté du Seigneur tout est possible, écrit le cardinal Sarah, même
en décidant de ne rien changer de leur vie.
|
|
Saint Thomas d'Aquin -
Pour agrandir
l'image ►
Cliquer
Nicolas Diat : A une époque où le relatif est la
règle, comment l'Eglise peut-elle encore faire comprendre les dogmes qui
constituent un de ses soubassements les plus importants ?
Le subjectivisme est un des
traits les plus significatifs de notre temps. Le sentiment et le désir
personnel constituent la seule norme. Souvent, l'homme moderne considère les
valeurs traditionnelles comme des archéologismes.
Depuis les révolutions sociales des années I960 et 1970,
il est d'usage d'opposer la liberté individuelle et l'autorité.
Dans ce cadre,
même chez les fidèles, il peut sembler que l'expérience
personnelle devient plus importante que les règles établies par l'Église.
Si l'individu est le centre de référence, chacun peut interpréter la parole
de l'Eglise à sa manière, en la mettant en accord avec ses propres idées. Je
regrette que de nombreux chrétiens se laissent influencer par cet
individualisme ambiant ; ils peuvent parfois avoir du mal à se retrouver
dans leur maison à l'intérieur de l'Église
catholique, dans sa forme traditionnelle, avec ses dogmes, son enseignement,
ses lois, ses exhortations et son magistère. Bien sûr, le décalage est
encore plus important pour les questions morales.
Désormais, il n'est pas faux de considérer qu'il existe
une forme de refus des dogmes de l'Église, ou une
distance croissante entre les hommes, les fidèles et les dogmes. Sur la
question du mariage, il existe un fossé entre un certain monde et l'Eglise.
La question devient donc fort simple : le monde
doit-il changer d'attitude ou l'Église sa fidélité à Dieu ? La
distance entre ces deux réalités est-elle tenable dans le temps, au risque
de voir les incompréhensions se creuser ? Car si les fidèles aiment encore
l'Église et le pape, mais qu'ils n'appliquent pas sa doctrine, en ne
changeant rien dans leurs vies, même après être venus écouter le successeur
de Pierre à Rome, comment envisager l'avenir ?
Beaucoup de fidèles se
réjouissent d'entendre parler de
la miséricorde divine, et ils espèrent que la radicalité de
l'Evangile pourrait s'assouplir même en faveur de ceux qui ont fait le choix
de vivre en rupture avec l'amour crucifié de Jésus. Ils ne mesurent pas le
prix payé par lui sur la Croix, qui a délivré chacun de nous du joug du
péché et de la mort. Ils estiment qu'à cause de l'infinie bonté du Seigneur
tout est possible, même en décidant de ne rien changer de leur vie. Pour
beaucoup, il est normal que Dieu déverse sur eux sa miséricorde alors qu'ils
demeurent dans le péché...
Or le péché m'annihile : comment peut-on greffer des
énergies de vie divine sur du néant ? Malgré les multiples rappels de saint
Paul, ils n'imaginent pas que la lumière et les ténèbres ne peuvent
coexister : « Que dire alors ? Qu'il nous faut rester dans le péché, pour
que la grâce se multiplie ? Certes non ! Si nous sommes morts au péché,
comment continuer de vivre en lui ? Ou bien ignorez-vous que, baptisés dans
le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés? [...]
Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la Loi, mais
sous la grâce ? Certes non!» (Rm 6, 1-3, 15).
Cette confusion demande des réponses rapides.
L'Église ne peut plus avancer comme si la réalité n'existait pas ; elle ne
peut plus se contenter d'enthousiasmes éphémères, qui durent l'espace de
grandes rencontres ou d'assemblées liturgiques, si belles et riches
soient-elles. Nous ne pourrons pas longtemps faire l'économie d'une
réflexion pratique sur le subjectivisme en tant que racine de la majeure
partie des erreurs actuelles. À quoi sert-il de savoir que le compte Twitter
du pape est suivi par des centaines de milliers de personnes si les hommes
ne changent pas concrètement leurs vies ? À quoi sert-il d'aligner les
chiffres mirifiques des foules qui se pressent devant les papes si nous ne
sommes pas certains que les conversions sont réelles et profondes, et si
nous ignorons combien Jésus et son Évangile sont la référence et le guide de
nos fidèles ? Cela étant, les Journées mondiales de la jeunesse ont aussi
permis de belles et généreuses réponses à l'appel de Dieu.
Face à la vague du subjectivisme qui semble emporter le
monde, les hommes d'Église doivent prendre garde de nier la réalité en
s'enivrant d'apparences et de gloire trompeuses. Certes, des événements
peuvent provoquer des retournements intimes et de véritables conversions.
Par exemple, je suis certain que les obsèques de Jean-Paul II et les
cérémonies de sa canonisation, en même temps que celle de Jean XXIII, ont
donné beaucoup d'élan à de nombreux fidèles ; cette foule immense réunie
autour de l'autel du Seigneur a pu approfondir le message de Karol Wojtyia
et l'appel universel à la sainteté suscité par le concile Vatican II que les
deux papes ont incarné dans leur vie quotidienne. Pour engager un changement
radical de la vie concrète, l'enseignement de Jésus et de l'Église doit
atteindre le cœur de l'homme. Il y a deux millénaires, les apôtres ont suivi
le Christ. Ils ont tout quitté et leur existence n'a plus jamais été la
même. Aujourd'hui encore, le chemin des apôtres est un modèle.
L'Église doit retrouver une vision. Si son enseignement
n'est pas compris, elle ne doit pas craindre de remettre cent fois son
métier sur l'ouvrage. Il ne s'agit pas d'amollir les exigences de l'Évangile
ou de changer la doctrine de Jésus et des apôtres pour s'adapter aux modes
évanescentes, mais de nous remettre radicalement en cause sur la manière
dont nous-mêmes vivons l'Évangile de Jésus et présentons le dogme.
L'incompréhension semble atteindre un tel niveau que
l'héritage philosophique même du christianisme est nié. Par exemple, peu de
penseurs rappellent l'apport fondamental de l'Eglise à la construction de
l'humanisme. D'ailleurs, n'assistons-nous pas désormais à l'émergence d'un
humanisme qui ne connaît plus le Christ ?
Effectivement, la religion chrétienne a mis l'homme au
centre de toutes ses préoccupations, au contraire des croyances païennes qui
la précédèrent. L'espérance du salut annoncée par le Christ s'adresse à
l'humanité entière. Mais c'est uniquement le Christ Jésus, l'Homme-Dieu, qui
manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa
vocation. Et s'il est vrai que le Christ révèle pleinement l'homme, alors il
est aussi juste que si nous rejetons le Christ, ou si nous obscurcissons son
visage, les conséquences se manifestent au centuple dans la confusion de ce
qu'est l'homme.
Le péché brouille le visage de l'homme. Or le Christ
n'est pas venu seulement pour sauver l'homme, mais pour réparer ce que le
péché a cassé, pour arracher l'homme à tout ce qui le défigure, afin de
donner à la destinée humaine toute son ampleur et son achèvement.
À la suite de saint Irénée et de saint Athanase d'Alexandrie,
saint Thomas d'Aquin affirme que le Fils unique de
Dieu a pris notre nature afin de diviniser les hommes. Athanase dit «
pour nous faire Dieu ». A contrario, la philosophie des Lumières a
voulu déchristianiser l'humanisme. Mais dès l'instant où Dieu n'est plus
créateur, l'homme est rabaissé. Dans la Genèse, il est dit que Dieu a un
plan pour l'homme, auquel celui-ci doit être fidèle. Si l'homme veut se
libérer de Dieu, il perd sa structure trinitaire et se déshumanise.
L'humanisme qui veut ignorer le Christ se vide de sa substance et devient
simplement un matérialisme.
En conservant quelques pauvres racines spirituelles, le
matérialisme peut faire illusion parfois. Mais il n'a plus rien en commun
avec un humanisme façonné par le christianisme, qui place au centre de toute
chose le visage de l'homme, reflet unique de Dieu.
Sans un véritable humanisme fondé sur le Christ, l'homme ne se comprend
plus. Il ne peut même pas aimer véritablement, ou s'il aime, il le fera avec
beaucoup d'égoïsme et de dureté.
L'homme, pour se réaliser pleinement, est comme
ontologiquement lié à Dieu par Jésus Christ. Il existe en relation vitale
avec Dieu. L'impossibilité de séparer désormais l'homme de Jésus,
l'Homme-Dieu, faisait dire à Paul VI, en conclusion du deuxième concile du
Vatican : « Le chemin vers Dieu passe par l'homme. La découverte de Dieu
passe par la découverte de l'homme. Le service de Dieu passe par le service
de l'homme. »
Qu'entendez-vous par l'expression « structure
trinitaire » de l'homme ?
Comment définir la Trinité ?
C'est un seul Dieu en trois personnes. Le Fils est du Père, et
l'Esprit est avec le Père et le Fils ; il est le Vinculum caritatis
entre le Père et le Fils, le lien d'amour entre le Père et le Fils. La
Trinité est une communion de connaissance et d'amour. Précisément, l'homme
est un être de relation. Il est poussé vers Dieu et vers son semblable. Si
l'homme perd cette orientation, il n'a plus qu'à se regarder lui-même à
l'infini, dans un égotisme qui peut prendre différentes formes.
En dehors de sa nature trinitaire, où il réalise pleinement sa vocation
d'union à Dieu, l'homme se renferme sur lui-même. L'autre devient un
problème et non plus un prolongement de soi. La conséquence ultime de
l'abandon de la Trinité se produit lorsque l'homme cherche à diviniser sa
nature propre, dans une quête éperdue et désespérée de lui-même, loin de
Jésus Christ.
Saint Irénée, dans son Traité contre les hérésies, développe une
anthropologie chrétienne proche de celle de saint Paul. On y retrouve comme
dans un miroir le dessein divin, afin de refaçonner l'homme à son image.
Pour Irénée de Lyon, l'homme est modelé à la ressemblance divine par
l'Esprit-Saint : « Nous recevons présentement une part
de l'Esprit qui nous perfectionne et nous prépare à l'incorruptibilité et
nous accoutume peu à peu à recevoir Dieu. » Et le Christ est
Archétype de l'homme nouveau. Aussi Irénée peut-il écrire : « La gloire de
Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu.
Si la révélation de Dieu par la création donne la vie à tout être vivant sur
la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe donne-t-elle la
vie à ceux qui voient Dieu ! »
En s'éloignant du Dieu-Trinité, l'homme oublie le
véritable ordre des choses, car Dieu s'est fait homme pour que l'homme
devienne Dieu. En fait, l'élimination de Dieu provoque une grande violence.
Sans le Père, l'homme se trouve exclusivement contingenté à de petits
marchés personnels, lesquels induisent une grande solitude. Sans le Christ,
l'homme devient un loup pour l'homme, et il ne sait plus aimer comme Jésus.
Sans l'Esprit, l'intelligence de l'homme se contemple toujours plus
elle-même et finit par reculer ;
avec l'Esprit, la raison est dans l'espérance et la
joie.
Benoît XVI n 'a cessé d'appeler à un dialogue
fructueux entre la
fides et la ratio, la foi et la raison. Aujourd'hui, une
grande partie de la réflexion philosophique semble se couper de toute
transcendance. Comment jugez-vous cette évolution ?
La rencontre de la philosophie grecque et du
christianisme a été un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Ce
dialogue si puissant a été voulu par Dieu.
Comment définir la philosophie ? Je pense qu'il ne s'agit
pas uniquement de l'amour de la sagesse, mais surtout d'une quête incessante
de la vérité, et d'une connaissance contemplative des causes profondes des
choses par l'intelligence humaine. Cette recherche a connu de nombreux
écueils, et elle s'est vraiment affermie avec Socrate, pour atteindre un
très haut niveau avec Platon et Aristote.
En rencontrant la foi chrétienne, avec saint Augustin,
saint Thomas d'Aquin, et d'autres encore, l'intelligence humaine façonnée
par des penseurs non chrétiens va aimer non plus seulement la sagesse
naturelle mais
la sagesse éternelle, la
sagesse incarnée, le Christ qui a déclaré : «
Je suis la Vérité. » Ainsi, la philosophie
grecque va recevoir le baptême chrétien, et elle sera purifiée pour devenir
dans l'Église la servante de la théologie.
Incontestablement, saint Thomas d'Aquin est l'homme qui a
donné sa vie pour préparer cette rencontre providentielle. C'est lui qui
bénira les consentements de l'union entre la sagesse grecque et la sagesse
éternelle...
Au bout d'une longue recherche, belle, honnête et
patiente, les philosophes grecs, comme Aristote, ont compris l'essence de la
nature, de la matière, de la vie et de l'esprit. Malgré la perfection de la
pensée qu'il a pu élaborer, avec une vision ordonnée de l'univers et de
l'homme, Aristote, qui a joué un des plus grands rôles dans l'histoire de la
réflexion philosophique, reconnaît ses limites. Dans l'Éthique à
Nicomaque, Aristote s'écrit : « Ô mes amis... il
n'y a pas d'amis ! » Cet aveu amer pourrait se traduire en d'autres
termes : « II n'y a pas de communion ! » C'est là une reconnaissance
douloureuse que la soif de l'homme n'est jamais étanchée par la seule
intelligence humaine. La philosophie, à elle seule, est incapable de
conduire l'homme jusqu'à son achèvement total, jusqu'à sa rencontre avec la
vérité éternelle, même si « ce qu'il a d'invisible depuis la création du
monde se laisse voir à l'intelligence» (Rm 1, 20).
L'idée même d'une création « à partir de rien »
n'effleure pas l'esprit d'Aristote. Ainsi, la sagesse grecque nous a fait
avancer bien près de la vérité. Pourtant, dans sa plus haute expression,
elle reste loin de concevoir un Dieu qui s'abaisserait à s'occuper de
l'homme. Sa pensée continue de ne pas comprendre les fondements de la
personne humaine. Cette ignorance explique l'incapacité à percevoir
l'égalité radicale de tous les hommes, et à deviner la grâce ineffable de
l'adoption filiale divine qui est surnaturelle. Nous devenons tous frères,
non par nature, mais par la grâce de Dieu. La sagesse grecque ne peut pas
expliquer le mal, ni la souffrance, ni le rachat, ni l'espérance. Mais cette
soif de l'amitié divine demeure cependant une merveilleuse attente, et une
préparation à la Révélation, au
logos.
Alors que plusieurs textes aristotéliciens semblaient
s'éloigner frontalement de la doctrine chrétienne, et malgré toutes les
lacunes de la sagesse grecque, saint Thomas d'Aquin va essayer de comprendre
Aristote, pour accueillir sa pensée avec la volonté de l'améliorer en vue de
l'enseignement, car la démarche du philosophe lui semble épouser la méthode
correcte de recherche de la vérité. En outre, saint Thomas considérait cette
méthode comme un instrument utile à l'étude de la doctrine de la foi. Il n'a
pas voulu, comme d'autres théologiens de son époque, rejeter la sagesse
païenne à cause de ses carences ou de ses expressions philosophiques
partiellement erronées, mais il s'en est servi après les avoir purifiées de
leur saveur païenne...
Avant lui,
saint Basile, dans sa lutte contre la culture grecque de son temps,
s'est vu confronté à une tâche semblable. Dans ses catéchèses consacrées aux
Pères de l'Église, Benoît XVI évoque un passage de l'auteur du Traité du
Saint-Esprit où il s'attache à reprendre une présentation que le prophète
Amos donne de lui-même : « Amos répondit et dit à Amasias : "Je n'étais ni
prophète, ni fils de prophète ! J'étais bouvier, je
traitais les sycomores" (Am 7, 14). La traduction grecque de
ce livre du prophète, la Septante, rend la dernière expression plus concrète
de la manière suivante : "J'étais un bouvier qui fend les fruits du
sycomore." Cette traduction repose sur le fait que les fruits du sycomore
doivent être fendus avant leur récolte, ainsi ils mûrissent au bout de peu
de jours. Dans son commentaire, Basile présuppose cette pratique, puisqu'il
écrit : "Le sycomore est un arbre qui porte beaucoup de fruits. Ils n'ont
cependant aucun goût à moins de les fendre avec soin et de laisser écouler
leur jus, par quoi ils obtiennent un bon goût. L'écoulement du jus semble
suggérer le processus de purification, de transformation totale, la
transformation ne détruisant pas la substance, mais lui donnant la qualité
qui lui manque. C'est pourquoi nous pensons que le sycomore est le symbole
pour l'ensemble des païens : il y en a en abondance, mais c'est fade. Cela
vient de la vie dans les habitudes païennes. Quand on arrive à la fendre par
le logos, il se transforme et devient savoureux et utile."
Ainsi, le logos lui-même doit fendre nos cultures et leurs fruits,
afin que l'immangeable soit purifié et devienne bon. Car c'est le
logos seul et son Évangile qui peuvent conduire nos cultures à leurs
maturités véritables ; le
logos
se sert de ses serviteurs, ceux qui traitent les sycomores.
»
Ce texte symbolise en quelque
sorte le rôle de l'Évangile dans l'espace de la culture et de la pensée
philosophique. L'Évangile n'est pas seulement
tourné vers l'individu ; il irradie la culture en accompagnant la croissance
et le développement de la personne, sa façon de penser, sa fécondité pour
Dieu et le monde. L'Évangile est une « entaille », une purification qui
amène la maturation et la guérison. Il est évident que cette « entaille »
n'est pas l'affaire d'un moment, mais d'une rencontre patiente entre le
logos et la culture.
Aujourd'hui, après des rencontres si fertiles, comme
celle de la Grèce antique et de l'Évangile, la soif de la philosophie n'est
pas étanchée. La philosophie, même sans la Révélation, peut atteindre la
transcendance et arriver à Dieu comme cause créatrice et finale.
Mais le refus de Dieu enferme à nouveau la philosophie dans un
questionnement sur la seule matière. Jésus Christ, l'homme parfait,
vient magnifier toute recherche sur la nature de l'homme. Pourquoi vouloir à
tout prix s'engager dans une forme de régression et refuser une découverte
de l'homme ? La philosophie contemporaine s'intéresse à lui de manière très
superficielle. Cette nouvelle sagesse ne touche finalement que les
phénomènes extérieurs à l'homme. Souvent, il s'agit plus d'une sociologie
que d'une philosophie ! Le temps n'est-il pas venu de remettre à leur place
certaines s ciences humaines ?
Laissons de coté la question culturelle pour aborder
la politique au sens large du terme. Diriez-vous également que la démocratie
est une invention du christianisme ?
Incontestablement, il existe une conception chrétienne de
l'égalité entre les hommes. Le Christ accorde une égale dignité à chacun ;
son salut ne connaît aucune barrière. Seul le Christ garantit le respect et
la protection des droits fondamentaux de toute personne humaine. Lui seul
exige de tout homme et de toute femme le devoir d'assurer pleinement ses
responsabilités vis-à-vis de sa conscience et de la société, pour promouvoir
la justice, la liberté et le bien commun. Le Christ met au cœur des sociétés
le primat de l'amour fraternel et du service des autres. Ce sont là quelques
éléments qui doivent entrer en ligne de compte dans la constitution d'une
vraie démocratie.
Cette dernière n'est pas exactement le gouvernement de la
majorité, mais elle s'en rapproche. Une majorité mérite-t-elle encore ce nom
lorsqu'elle écrase, à l'aide de lois oppressives, les minorités raciales,
religieuses et politiques ? Dans
Deus caritas est, Benoît XVI rappelait que « l'ordre juste de la
société et de l'État est le devoir essentiel du
politique. Un État qui ne serait pas dirigé selon la justice se réduirait à
une grande bande de vauriens, comme l'a dit un jour saint Augustin : "Remota
itaque iustitia quid sunt régna nisi magna latrocinia ?" ». Ce sont des
situations et des réalités qui ne sont pas rares aujourd'hui. Il est bon que
tout pouvoir soit équilibré par des contre-pouvoirs. Aussi la démocratie,
qui est un idéal et une pratique, est-elle reconnue comme le système
politique le moins mauvais. Mais si la démocratie exclut la religion,
explicitement ou non, elle n'est plus un bien pour le peuple ; dès lors,
l'État de droit n'est plus.
Le message chrétien est révolutionnaire : tous les hommes
sont frères et possèdent un même Père. Nous sommes égaux en dignité, car
tous à l'image de Dieu. Pourtant, la vraie démocratie ne peut pas être le
règne arbitraire de la majorité. Car la majorité est-elle forcément juste ?
Il est évident que la réponse est négative. Parfois, ce sont les minorités
qui détiennent la vérité...
Je suis convaincu qu'une démocratie qui contribue au
développement intégral de l'homme ne peut subsister sans Dieu. Lorsqu'un
chef d'État sait que Dieu est au-dessus de lui, il est plus facilement
appelé par sa conscience à l'humilité et au service. Sans référence
chrétienne, dans l'ignorance de Dieu, une démocratie devient une sorte
d'oligarchie, un régime élitiste et inégalitaire. Comme toujours, l'éclipsé
du divin signifie l'abaissement de l'humain.
Le lundi 18 avril 2005, lors de la
Missa pro eligendo Romano Pontifice, quelques heures avant son
élection sur le trône de Pierre, le cardinal Ratzinger avait choisi de
dénoncer
la dictature du relativisme. Vous semblez considérer que ce discours
a gardé toute son acuité.
Oui, et je voudrais d'abord citer un long passage de
cette homélie. Le cardinal Joseph Ratzinger déclarait alors : « Combien de
vents de la doctrine avons-nous connus au cours des dernières décennies,
combien de courants idéologiques, combien de modes de la pensée... La petite
barque de la pensée de nombreux chrétiens a été souvent ballottée par ces
vagues — jetée d'un extrême à l'autre : du marxisme au libéralisme, jusqu'au
libertinisme ; du collectivisme à l'individualisme radical ; de l'athéisme à
un vague mysticisme religieux ; de l'agnosticisme au syncrétisme, et ainsi
de suite. Chaque jour naissent de nouvelles sectes et se réalise ce que dit
saint Paul à propos de l'imposture des hommes,
de l'astuce qui tend à les induire en erreur (Ep 4, 14). Posséder une
foi claire, selon le Credo de l'Église, est
souvent défini comme du fondamentalisme. Tandis que le relativisme,
c'est-à-dire se laisser entraîner "à tout vent de la doctrine", apparaît
comme l'unique attitude à la hauteur de l'époque actuelle. On est en train
de mettre sur pied une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme
définitif et qui donne comme mesure ultime uniquement son propre ego et ses
désirs. Nous possédons, en revanche, une autre mesure : le Fils de Dieu,
l'homme véritable. C'est lui la mesure du véritable humanisme. Une foi
"adulte" ne suit pas les courants de la mode et des dernières nouveautés ;
une foi adulte et mûre est une foi profondément enracinée dans l'amitié avec
le Christ. C'est cette amitié qui nous ouvre à tout ce qui est bon et
qui nous donne le critère permettant de discerner entre le vrai et le faux,
entre imposture et vérité. Cette foi adulte doit mûrir en nous, c'est vers
cette foi que nous devons guider le troupeau du Christ. Et c'est cette foi —
cette foi seule — qui crée
l'unité et qui se réalise dans la charité. Saint Paul nous offre à ce propos
— en contraste avec les tribulations incessantes de ceux qui sont comme des
enfants ballottés par les flots - une belle parole : faire la vérité dans la
charité, comme formule fondamentale de l'existence chrétienne. Dans le
Christ, vérité et charité se retrouvent. Dans la mesure où nous nous
rapprochons du Christ, la vérité et la charité se confondent aussi dans
notre vie. La charité sans vérité serait aveugle ; la vérité sans charité
serait comme "cymbale qui retentit" (1 Co 13, 1). »
Aujourd'hui, le relativisme
apparaît comme l'assise philosophique des démocraties occidentales refusant
de considérer que la vérité chrétienne puisse être supérieure à toute autre.
De manière parfaitement assumée, elles nient la phrase du Christ : «
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père
sans passer par moi » (Jn 14, 6).
Dans un système relativiste, tous
les chemins sont possibles, comme les fragments multiples d'une marche du
progrès. Le bien commun serait le fruit d'un dialogue continu de tous, une
rencontre des différentes opinions privées, une tour de Babel fraternelle où
chacun possède une parcelle de la vérité. Le relativisme moderne va jusqu'à
prétendre qu'il est l'incarnation de la liberté. En ce sens, cette dernière
devient l'obligation agressive de croire qu'il n'existe aucune vérité
supérieure ; dans ce nouvel éden, si l'homme refuse la vérité révélée par le
Christ, il devient libre. Le vivre-ensemble prend la forme d'un horizon
indépassable, où chaque individu peut disposer de sa vision morale,
philosophique et religieuse. En conséquence, le relativisme pousse l'homme à
créer sa propre religion, peuplée de divinités multiples, plus ou moins
pathétiques, qui naissent et meurent au gré des pulsions, dans un monde qui
n'est pas sans rappeler les religions païennes antiques.
Dans ce carcan totalitaire,
l'Église perd son caractère absolu ; ses dogmes, son enseignement et ses
sacrements sont quasiment prohibés ou abaissés dans leur rigueur et leur
exigence. L'Épouse du Fils de Dieu est marginalisée,
dans un mépris qui engendre la christianophobie, car elle est un
obstacle permanent. L'Église devient une parmi d'autres, et l'objectif
final du relativisme philosophique reste sa mort par dilution progressive ;
les relativistes attendent avec impatience ce grand soir, et le prince de ce
monde avec eux. Ils travaillent à l'avènement du règne des ténèbres
Jean-Paul II et Joseph Ratzinger, comme préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi, avaient saisi l'importance du péril
mortifère des théories relativistes. La déclaration
Dominus Jesus est en grande partie une réponse au relativisme. Dans
l'introduction, qui n'a rien perdu de son acuité, Joseph Ratzinger écrit
avec justesse : « La pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est
aujourd'hui mise en péril par des théories relativistes, qui entendent
justifier le pluralisme religieux, non seulement
de facto mais aussi de iure (ou en tant que principe).
Elles retiennent alors comme dépassées des vérités, comme par exemple le
caractère définitif et complet de la révélation de Jésus Christ, la nature
de la foi chrétienne vis-à-vis des autres religions, l'inspiration des
livres de la Sainte Écriture, l'unité personnelle entre le Verbe éternel et
Jésus de Nazareth, l'unité de l'économie du Verbe incarné et du
Saint-Esprit, l'unicité et l'universalité salvifique du mystère de Jésus
Christ, la médiation salvifique universelle de l'Église, la non-séparation,
quoique dans la distinction, entre le Royaume de Dieu, le Royaume du Christ
et l'Église, la subsistance de l'unique Église du Christ dans l'Église
catholique. Ces théories s'appuient sur certains présupposés de
nature philosophique ou théologique qui rendent difficiles la compréhension
et l'accueil de la vérité révélée. On en signalera quelques-uns : la
conviction que la vérité sur Dieu est insaisissable et ineffable, même par
la révélation chrétienne ; l'attitude relativiste vis-à-vis de la vérité,
entraînant que ce qui est vrai pour certains ne le serait pas pour d'autres
; l'opposition radicale qu'on établit entre la mentalité logique occidentale
et la mentalité symbolique orientale ; le subjectivisme de qui, tenant la
raison comme seule source de connaissance, devient "incapable d'élever son
regard vers le haut pour oser atteindre la vérité de l'être" ; la difficulté
à percevoir et à comprendre dans l'histoire la présence d'événements
définitifs et eschatologiques ; la privation de sa dimension métaphysique de
l'incarnation historique du Logos éternel et sa réduction à une
simple apparition de Dieu dans l'histoire ; l'éclectisme qui, dans la
recherche théologique, prend des idées dans différents contextes
philosophiques et religieux, sans se soucier ni de leur cohérence
systématique ni de leur compatibilité avec la vérité chrétienne ; la
tendance finalement à lire et à interpréter la Sainte Ecriture en dehors de
la Tradition et du magistère de l'Église. Sur la base de ces présupposés
adoptés sans uniformité, comme des affirmations pour certains, comme des
hypothèses pour d'autres, des propositions théologiques sont élaborées qui
font perdre leur caractère de vérité absolue et d'universalité salvifique à
la révélation chrétienne et au mystère de Jésus Christ et de l'Église, ou y
jettent au moins une ombre de doute et d'incertitude. »
Le relativisme est un mal diffus et il n'est pas aisé
de le combattre. La tâche devient d'autant plus complexe qu'il constitue
arbitrairement une forme de charte d'un mode de vie communautaire.
Le relativisme tente d'achever le processus de la disparition sociale de
Dieu. Il oriente l'homme dans une logique attrayante qui se révèle un
système totalitaire pervers. L'Église poursuit aujourd'hui la lutte de
Benoît XVI contre la liquidation de Dieu. Et c'est une lutte en faveur de
l'homme.
Suite de ce texte :
►L'idéologie du genre
Sur le même sujet :
►
La morale catholique et les idéologies homosexuelles et de genre dans le
magistère de J. Ratzinger/Benoît XVI
►
La
réalité vient avant l’idéologie. Même du « Gender »
►
Discours de Benoît XVI aux Académies pontificales - 02.02.2010
|
Les lecteurs qui
désirent consulter les derniers articles publiés par le site
Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent
cliquer sur le lien suivant
► E.S.M.
sur Google actualité |
Sources : Extraits de la
deuxième partie "Dieu ou rien" - Entretien du cardinal SARAH
avec Nicolas Diat -
E.S.M
Ce document est destiné à l'information;
il ne constitue pas un document officiel
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.)
22.11.2023
|