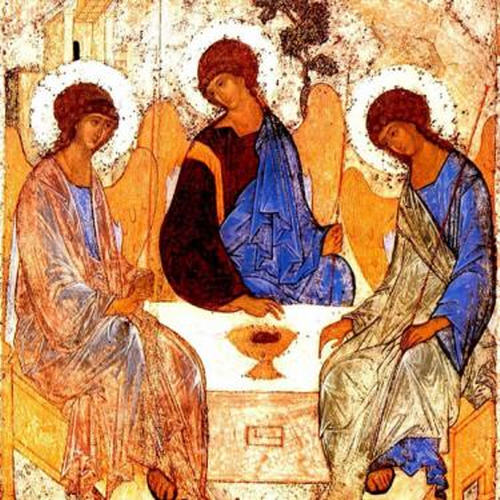 |
Benoît XVI : Les échappatoires, voies sans issue
|
Le 26 mai 2023 -
E.S.M.
-
La doctrine
chrétienne, exprimée dans la formule du « Dieu un et trine »,
signifie, au fond, le refus des échappatoires, en restant dans le
mystère, insondable à l'homme : en fait, c'est seulement par cette
confession que l'on renonce effectivement à la prétention de tout
savoir, illusion qui rend si séduisantes les solutions nettes avec
leur fausse sobriété.
|
|
Benoît XVI :
Dieu un et trine -
Pour agrandir l'image
►
Cliquer
Lien précédent :
-
Benoît XVI : Le point de départ de la foi en Dieu un et trine
c) Les échappatoires, voies sans issue
Les multiples ramifications de la lutte menée par la foi aux premiers
siècles, peuvent, à la lumière des réflexions précédentes, se ramener à
l'opposition insoluble de deux voies, de deux pistes de recherche,
qui
devaient s'avérer de plus en plus comme de fausses pistes : le subordinatianisme
(ndlr : Conception théologique liée à
l'arianisme, qui suppose dans la Trinité une
subordination ontologique du Fils et de l'Esprit par rapport au Père)
et le monarchianisme
(ndlr : Doctrine chrétienne hérétique
refusant le dogme de la Trinité). Tout en paraissant très logiques,
les deux solutions, avec leur simplification fallacieuse, ruinent
l'ensemble. La doctrine chrétienne, exprimée dans la formule du « Dieu un et
trine », signifie, au fond, le refus des échappatoires, en restant dans le
mystère, insondable à l'homme : en fait,
c'est seulement par cette
confession que l'on renonce effectivement à la prétention de tout savoir,
illusion qui rend si séduisantes les solutions nettes avec leur fausse
sobriété.
Le subordinatianisme échappe au dilemme en disant : Dieu lui-même est
unique ; le Christ n'est pas Dieu, mais simplement un être tout proche de
Dieu. Ainsi le scandale est écarté, mais de la sorte, comme nous l'avons
abondamment montré plus haut, l'homme est coupé de Dieu même, cantonné dans
l'approche préliminaire. Dieu devient pour ainsi dire un monarque
constitutionnel ; la foi n'a pas affaire à lui, mais seulement à ses
ministres
21. Si l'on n'admet pas cela,
si l'on croit réellement à la
souveraineté de Dieu, à la présence du « plus grand » dans le plus petit,
alors il faut tenir fermement que Dieu est homme, que l'être de Dieu et
celui de l'homme se compénètrent ; ainsi la foi au Christ deviendra le point
de départ pour la doctrine trinitaire.
Le monarchianisme, dont nous avons déjà évoqué la solution, résout le
dilemme en sens inverse. Il maintient fermement l'unité de Dieu ; mais en
même temps il prend au sérieux ce Dieu qui vient à notre rencontre, d'abord
comme créateur et père, ensuite comme fils et rédempteur dans le Christ et
enfin comme Saint-Esprit. Mais ces trois formes ne sont considérées que
comme des masques de Dieu, qui nous renseignent sur nous-mêmes,
mais
nullement sur Dieu. Si séduisante que paraisse cette solution, il n'en
résulte pas moins que l'homme reste finalement enfermé en lui-même, sans
pouvoir atteindre le Dieu véritable. Les résurgences du monarchianisme dans
l'histoire de la pensée moderne confirment cela une nouvelle fois. Hegel et
Schelling, dans leur tentative d'interpréter philosophiquement le
christianisme et de penser la philosophie à partir du christianisme, se sont
rattachés à cet essai de philosophie du christianisme, fait par l'Église
ancienne. En partant de là, ils ont espéré pouvoir rendre la doctrine
trinitaire transparente et utilisable pour la raison, en faire la clé de
toute intelligence de l'être, en lui donnant le sens purement philosophique
censé être le sien. Il ne nous est pas possible, bien sûr, de présenter ici
exhaustivement ces tentatives - les plus exaltantes faites jusqu'à ce jour -
d'une assimilation de la foi chrétienne par la pensée. Il suffira d'indiquer
comment l'impasse, qui nous a parue typique du monarchianisme (modalisme),
se retrouve pratiquement ici.
Le point de départ reste l'idée que la doctrine trinitaire est l'expression
de la dimension historique de Dieu, de la manière dont Dieu apparaît dans
l'histoire. En allant jusqu'au bout de cette idée, Hegel et, de façon
différente, Schelling en viennent à ne plus distinguer ce processus de
l'épiphanie historique de Dieu, d'avec un Dieu qui serait au-delà, immuable
en lui-même ; ils voient désormais dans le devenir de l'histoire, le devenir
de Dieu lui-même. La forme historique de Dieu est alors le mouvement
progressif du divin devenant lui-même ; l'histoire est bien le devenir du
Logos, mais le Logos lui-même n'est réel que dans ce devenir de l'histoire.
En d'autres termes, c'est dans l'histoire seulement que le logos - le sens
de tout être - s'engendre graduellement pour devenir lui-même.
L'historicisation de la doctrine trinitaire, telle qu'elle est impliquée
dans le monarchianisme, devient ainsi l'historicisation de Dieu. Cela
revient à dire que le « Sens »
(Ndlr : le sens concerne ce qui se
construit dans la pensée) n'est plus le créateur de l'histoire, mais
que l'histoire devient créatrice du « Sens », celui-ci devenant créature de
l'histoire. Karl Marx a, sur ce point, poussé résolument plus loin la
réflexion ; si le sens ne précède pas l'homme, il se trouve dans l'avenir
que l'homme doit lui-même promouvoir de haute lutte.
Mais il ressort de là que la pensée
monarchienne entraîne la perte du chemin
de la foi tout autant que le subordinatianisme. Car dans une telle
conception disparaît la confrontation des libertés, essentielle à la foi ;
disparaît également le dialogue de l'amour avec son caractère imprévisible ;
et disparaît enfin la structure personnaliste du Sens, avec la
compénétration du maximum et du minimum, du Sens qui englobe l'univers et de
la créature à la recherche du sens. Tout cela - le caractère personnel et dialogal, la liberté et l'amour -
est fondu ici dans la nécessité du seul
processus de la raison. Mais une autre conséquence apparaît encore : vouloir
pénétrer jusqu'en son fond la doctrine trinitaire, vouloir la réduction
radicale à la logique, qui aboutit à historiciser le Logos lui-même, et qui
veut, en comprenant Dieu, comprendre aussi sans mystère l'histoire de Dieu,
la construire suivant une exacte logique, cette tentative grandiose de
prendre totalement en main la logique du Logos, nous ramène à une mythologie
de l'histoire, au mythe du Dieu qui s'engendre lui-même dans l'histoire. La
tentative d'une logique totale finit dans l'absence de logique, dans
l'absorption de la logique par le mythe.
L'histoire du monarchianisme présente encore un autre aspect, que nous
devons évoquer brièvement : déjà sous sa première forme et à nouveau sous la
forme que lui ont donnée Hegel et Marx, le monarchianisme contient une note
nettement politique, il est « théologie politique
». Dans l'ancienne Église,
il sert à étayer théologiquement la monarchie impériale ; chez Hegel, il
devient l'apothéose de l'État prussien ; chez Marx, un programme d'action
pour un avenir heureux de l'humanité. A l'inverse, on pourrait montrer
comment dans l'Église ancienne, la victoire de la foi trinitaire sur le
monarchianisme a représenté une victoire sur l'emploi politique abusif de la
théologie : la foi trinitaire chrétienne a fait éclater les schémas
utilisables à des fins politiques ; elle a supprimé la théologie comme mythe
politique ; elle a refusé de faire servir la prédication à la justification
d'une situation politique
22.
d) Doctrine trinitaire et théologie négative
En considérant l'ensemble, on peut constater que la forme ecclésiastique de
la doctrine trinitaire se justifie tout d'abord négativement, à partir de
l'impasse où aboutissent toutes les autres voies. Peut-être même est-ce la
seule justification que nous puissions réellement apporter ici. La doctrine
trinitaire serait alors essentiellement négative ; il faudrait la comprendre
comme la seule manière de rejeter toute prétention à une intelligence
exhaustive, comme le symbole du caractère insoluble du mystère de Dieu. Elle
deviendrait sujette à caution, si elle prétendait simplement à un savoir
positif. Si la laborieuse histoire des efforts humains et chrétiens, pour
atteindre Dieu prouve quelque chose, c'est bien d'abord ceci :
toute
tentative de capter Dieu dans nos concepts conduit à l'absurde.
Nous ne
pouvons parler convenablement de Lui qu'en renonçant à le concevoir, qu'en
sauvegardant son caractère inconcevable. La doctrine trinitaire ne doit donc
pas apparaître comme la solution du mystère de Dieu. Elle est une
affirmation des limites ; elle est un geste qui renvoie au-delà d'elle et
évoque l'ineffable ; elle n'est pas une définition qui situe une chose dans
les compartiments du savoir humain ; elle n'est pas un concept grâce auquel
la chose pourrait être captée par l'esprit humain.
Ce caractère allusif, où le concept devient simple suggestion, où concevoir
signifie simplement chercher à tâtons l'inconcevable (Begreien/Ausgreien/Un-greibaren),
pourrait être nettement mis en évidence à l'aide des formules
ecclésiastiques et de leur préhistoire. Chacun des grands concepts
fondamentaux de la doctrine trinitaire s'est trouvé condamné à un moment ;
tous ont dû subir la contradiction de la condamnation pour être acceptés ;
ils ne sont valables qu'à la condition d'être en même temps reconnus
impropres ; et alors seulement ils sont tolérés comme un misérable
balbutiement, sans plus
23. Le concept de « personne » (prosopon) a été
condamné une fois, comme nous l'avons dit ; le mot central, qui devint au IVe
siècle l'étendard de l'orthodoxie, le homousios (= consubstantiel avec le
Père) avait été condamné au IIIe
siècle ; le concept de procession a également
une condamnation à son actif, et l'on pourrait continuer ainsi. Je pense
qu'il faudrait dire que ces condamnations sont partie intrinsèque des
formules devenues plus tard celles de la foi ; c'est à travers la négation et
dans le sens infiniment indirect qu'elle donne aux formules, que celles-ci
deviennent utilisables : la doctrine trinitaire n'est possible que comme
théologie contestée.
On pourrait encore ajouter une autre remarque. Quand on examine l'histoire
dogmatique de la théologie trinitaire dans le miroir d'un Manuel de
théologie moderne, elle apparaît comme un cimetière d'hérésies, dont la
théologie porte les insignes comme des trophées de victoires surmontées.
Mais, considérer les choses de cette façon, c'est mal les comprendre; car,
toutes les tentatives qui, au cours de longs efforts de recherche, ont été
écartées comme des apories, et donc comme des hérésies, ne sont pas
simplement des monuments funéraires de recherches vaines, des pierres
tombales, témoins des multiples échecs de la pensée, objets d'une pure
curiosité tournée vers le passé, sans nul profit en fin de compte. Chaque
hérésie est plutôt le symbole d'une vérité qui demeure, qu'il faut
rapprocher d'autres vérités également valables, et dont on ne peut l'isoler
sans aboutir à une fausse perspective. Autrement dit, tous ces énoncés, loin
d'être des monuments funéraires, sont plutôt des pierres pour une
cathédrale; pour devenir utiles, il est vrai, elles ne doivent pas rester
isolées, mais être intégrées dans l'ensemble; de même, les formules
positivement adoptées ne valent que si elles sont conscientes en même temps
de leur insuffisance.
Le janséniste Saint-Cyran a dit cette parole remarquable, que la foi
consistait en une série de contradictions que la grâce permet de maintenir
ensemble
24. Il a ainsi exprimé, dans le domaine de la théologie, une donnée
qui aujourd'hui, en physique, fait partie de la pensée scientifique, en tant
que loi de complémentarité. Le physicien se rend compte qu'il n'est pas
possible de circonscrire une réalité donnée - comme par exemple la structure
de la lumière ou celle de la matière en général - par une seule forme
d'expérimentation ni par une seule forme d'énoncé ; par différentes
approches, nous percevons chaque fois un seul aspect, irréductible à
l'autre. Les deux aspects - par exemple la structure « corpuscule et onde »
- qu'il n'est pas possible d'englober dans un seul concept, doivent être
considérés ensemble comme une première saisie du tout, celui-ci ne nous
étant pas accessible en tant que tout, dans son unité, en raison de l'étroitesse de notre point de vue. Ce qui vaut dans le domaine de la
physique, comme conséquence des limites de notre perception, vaut à plus
forte raison pour les réalités spirituelles et pour Dieu. Ici également,
nous ne pouvons regarder que d'un point de vue et nous ne percevons chaque
fois qu'un aspect déterminé, qui paraît contredire l'autre, et qui pourtant
doit être joint à l'autre pour pouvoir renvoyer au tout, qu'il est
impossible d'exprimer ni d'embrasser d'un seul regard. C'est seulement par
des approches variées, en regardant et en affirmant à partir de points de
vue différents et apparemment contradictoires, que nous pouvons entrevoir la
vérité, dont la réalité totale cependant nous échappera toujours.
Peut-être le principe de la physique moderne nous sera-t-il d'un meilleur
secours que la philosophie aristotélicienne. Le physicien nous dira que,
pour parler de la structure de la matière, il faut procéder par
approximations, à partir de points de vue différents. Il sait que le
résultat de ses expériences dépend de la position respective de
l'observateur. Cela ne devrait-il pas nous aider à concevoir de façon toute
nouvelle la recherche théologique ? Dans la question de Dieu, il ne faut pas
vouloir, à la manière aristotélicienne, trouver un dernier concept,
englobant le tout ; il faut s'attendre, au contraire, à rencontrer une
pluralité d'aspects, dépendants de la position respective de l'observateur;
il n'est plus possible d'embrasser tous ces aspects d'un seul regard, nous
ne pouvons simplement que les accepter ensemble, sans arriver à exprimer la
réalité dernière. Nous voyons ici l'interaction cachée de la foi et de la
pensée moderne. Que la physique moderne, dépassant le déterminisme de la
logique aristotélicienne, s'oriente dans ce sens, n'est-ce pas une
répercussion de la nouvelle dimension introduite par la théologie
chrétienne, obligée de penser par complémentarités ?
A ce propos, je voudrais encore évoquer brièvement deux données de la
physique, qui peuvent aider notre réflexion. E. Schrödinger a défini la
structure de la matière comme des « paquets d'ondes », introduisant ainsi
l'idée d'un être, non pas substantiel, mais purement actuel, dont la «
substantialité » apparente ne résulte en réalité que de la combinaison des
mouvements d'ondes superposées. Une telle proposition, dans le domaine de la
matière, est sans doute très discutable du point de vue physique et, en tout
cas, du point de vue philosophique. Mais elle offre une comparaison
intéressante pour l'actualitas divina, pour l'être purement actuel de Dieu ;
elle fait entrevoir que l'être le plus dense - Dieu - peut consister dans
une pluralité de relations, qui ne sont pas des substances mais des « ondes
», et constituer pourtant une réalité unique, la plénitude même de l'être.
Nous aurons à reprendre plus à fond cette idée déjà formulée, en fait, par
Saint Augustin, lorsqu'il développe l'idée de l'Existence qui est Acte pur
(«
paquet d'ondes »).
Voyons d'abord la deuxième donnée des sciences expérimentales, qui pourrait
aider notre réflexion. Il est un fait connu aujourd'hui que, dans
l'expérimentation physique, l'observateur lui-même fait partie de
l'expérience, il doit y entrer, s'il veut arriver à la perception d'une
donnée physique. Cela prouve que, même en physique, l'objectivité pure
n'existe pas ; dans ce domaine aussi, le résultat de l'expérience, la réponse
de la nature, dépend de la question qu'on lui adresse. Dans la réponse, se
trouve toujours quelque chose de la question posée et de la personne même
qui questionne ; la réponse ne reflète pas seulement la nature dans son
être-en-soi, dans sa pure objectivité, elle restitue aussi quelque chose de
l'homme, de notre être propre, quelque chose du sujet humain. Il en va de
même,
mutatis mutandis, pour la question de Dieu. L'observateur pur et
simple ne saurait exister. L'objectivité parfaite n'existe pas. On peut même
dire : plus un objet a rapport à l'homme, plus il l'affecte en son centre et
engage l'être propre de l'observateur, et plus il devient difficile de
prendre ses distances dans une pure objectivité. Quand donc quelqu'un
prétend apporter une réponse objective, pure de toute passion, une réponse
qui dépasse enfin les préjugés des gens pieux, une information purement
scientifique, disons qu'il se leurre lui-même. Ce genre d'objectivité est en
dehors des possibilités de l'homme. Il ne peut questionner et exister comme
simple observateur. Comme tel, il n'apprendra jamais rien.
Pour percevoir la
réalité «.Dieu »,
il faut également s'engager dans l'expérience sur Dieu,
expérience que nous appelons foi. C'est seulement en s'y engageant que l'on
peut apprendre ; ce n'est qu'en participant à l'expérience, qu'il est
possible de poser véritablement une question et de recevoir une réponse.
Dans son célèbre argument du pari, Pascal a exprimé cette vérité avec une
clarté presque troublante et avec une acuité qui touche à la limite du
supportable. La discussion avec le partenaire incroyant en est arrivée à un
point, où celui-ci reconnaît qu'il doit prendre une position devant le
problème de Dieu. Mais il voudrait éviter le saut inévitable, il voudrait
avoir une clarté mathématique : « Mais encore, n'y a-t-il pas moyen de voir
le dessous du jeu ? - Oui, l'Écriture et le reste... - Mais j'ai les mains
liées et la bouche muette... je suis fait d'une telle sorte que je ne puis
croire. Que voulez-vous donc que je fasse ? - Apprenez au moins que votre
impuissance à croire vient de vos passions. Puisque la raison vous y porte
et que néanmoins vous ne le pouvez, travaillez donc non pas à vous
convaincre par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de
vos passions. Vous voulez aller à la foi et vous n'en savez pas le chemin.
Vous voulez vous guérir de l'infidélité et vous en demandez les remèdes,
apprenez de ceux qui ont été liés comme vous... suivez la manière par où ils
ont commencé. C'est en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de
l'eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement même cela vous
fera croire et vous abêtira
25. »
Ce texte singulier contient au moins cette vérité : la simple curiosité
neutre de l'esprit, qui ne veut pas entrer lui-même dans le jeu, est
incapable de nous ouvrir les yeux et de nous éclairer, même sur un homme, et
encore moins sur Dieu. L'expérience sur Dieu ne peut se faire sans l'homme.
Ici aussi s'applique, et à plus forte raison encore, le principe qui vaut en
physique : celui qui s'engage dans l'expérience, reçoit une réponse qui ne
reflète pas seulement Dieu, mais aussi notre propre question ; elle nous
apprend quelque chose sur Dieu à travers la réfraction par notre être
propre. Les formules dogmatiques elles-mêmes - par exemple « une nature en
trois personnes » - incluent cette réfraction par l'humain ; elles reflètent
dans notre cas, l'homme de la fin de l'antiquité, l'homme qui questionne et
expérimente dans les catégories philosophiques de la fin de l'antiquité, ces
catégories déterminent le point de vue à partir duquel il pose sa question.
Il faut encore aller plus loin : si nous avons ici la possibilité même de
questionner et d'expérimenter, c'est que Dieu de son côté s'est prêté à
l'expérience et s'y est engagé lui-même comme homme.
Par la réfraction
humaine qui s'est faite dans cet homme unique, nous pouvons expérimenter
plus que simplement l'homme ; en Lui qui est à la fois homme et Dieu, Dieu
s'est montré sous un visage humain ; dans l'homme, il s'est fait connaître
lui-même.
A suivre : II. POUR UNE INTELLIGENCE POSITIVE DU
MYSTÈRE
Notes :
2l. E. PETERSON, Theologlsche Traktate, München,
1951, pp. 45-147 : « Der Monotheismus als politisches Problem »,
surtout pp. 52 s.
22. Ibid., pp. 102 ss. - La remarque finale de Peterson, p. 147, note
168, est également importante : « Le concept de théologie politique pour
autant que je sache, a été introduit dans la littérature par CARL SCHMITT,
Polltische Théologie, München, 1922... Nous
avons essayé ici de montrer, à l'aide d'un exemple concret, l'impossibilité
théologique d'une " théologie politique " ».
23. Cf. l'histoire du Homousios ; voir le résumé de A. GRILLMEIER,
dans LTHK, V, pp. 467 s: - et aussi l'aperçu de l'histoire du dogme
trinitaire dans A. ADAM, op. cit., pp. 115-254. Sur le thème du
balbutiement de l'homme devant Dieu, cf. le beau récit « Das Stammeln » tiré
des contes hassidiques dans M. BUBER, Les récits hassidiques, Paris,
1949, pp. 303-304.
24. Cité dans H. DOMBOIS, « Der Kampf um das Kirchenrecht », dans H.
ASMUSSEN - W. STÄLIN, Die Kalholizität
der Kirche, Stuttgart, 1957, pp. 285-307, citation 297 s.
25. B. Pascal, Pensées, Fragment 233 (éd. Brunschvicg 137 s) : - cf.
aussi page 333, note 53, où Brunschvicg montre contre V. Cousin, (voir aussi LAROS, p. 97, note 1) que « s'abêtir » chez Pascal, signifie : «
retourner à
l'enfance, pour atteindre les vérités supérieures qui sont inaccessibles à
la courte sagesse des demi-savants ». En partant de là, Brunschvicg peut
dire, dans le sens de Pascal : « Rien n'est plus conforme à la raison que le
désaveu de la raison. » Pascal ne parle pas ici, comme le pensait Cousin, en
tant que sceptique, mais à partir de la conviction et de la certitude du
croyant.
Blaise Pascal Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets...PDF
(Édition. 1897 À Paris, Léon Brunschvicg, éditeur)
|
Les
lecteurs qui désirent consulter les derniers articles publiés par le
site
Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent cliquer
sur le lien suivant
► E.S.M.
sur Google actualité |
Sources :Texte original des écrits du Saint Père Benoit XVI -
E.S.M.
Ce document est destiné à l'information; il ne
constitue pas un document officiel
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 26.05.2023
|