|
Le pape Benoît XVI s'adresse aux
pèlerins francophones |
 |
Cité du Vatican, le 18 juin 2008 -
(E.S.M.)
- Le pape Benoît XVI a salué particulièrement les
étudiants de l'institut de philosophie de Paris, la paroisse de Rodez et
tous les jeunes. "Je vous invite - a-t-il dit - à faire dans votre vie,
l'unité entre la contemplation de Dieu et le service de vos frères".
|
Le pape
Benoît XVI, place St Pierre - Pour
agrandir l'image ►
Cliquer
Le pape Benoît XVI s'adresse aux pèlerins francophones
Avant que le pape Benoît XVI ne s'adresse à tous les pèlerins rassemblés
place Saint Pierre, a été lu en différentes langue un extrait de du livre de
la sagesse (7, 13-14)
La sagesse que j'ai apprise sans fraude, je la
communiquerai sans jalousie. Je ne cacherai pas sa richesse car elle est
pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent s'attirent
l'amitié de Dieu. Ils lui sont recommandés par les dons qui viennent de
l'instruction.
Le pape Benoît XVI s'adresse aux pèlerins
francophones
Chers Frères et Sœurs,
Saint Isidore était le frère de Léandre, évêque de Séville, et un grand ami
du Pape Grégoire le Grand. Ses œuvres montrent qu’il avait une connaissance
encyclopédique de la culture classique païenne et une connaissance
approfondie de la culture chrétienne. En 599, Isidore succéda à son frère
sur le Siège épiscopal de Séville, qu’il occupa jusqu’à sa mort en 636. Le
Concile de Tolède le définira comme « illustre maître de notre époque, et
gloire de l’Église catholique ».
Isidore fit dans sa vie l’expérience d’un conflit intérieur permanent entre
le désir de la solitude, pour se consacrer à la méditation de la Parole de
Dieu, et les exigences de la charité envers ses frères, se sentant, en tant
qu’Évêque, chargé de leur salut. Dans la situation politique complexe de son
temps, il contribua à la formation du peuple. Grâce à la richesse de ses
connaissances, il put confronter la nouveauté chrétienne avec l’héritage
classique, ne négligeant rien de ce que l’expérience humaine avait produit
dans l’histoire de sa patrie et du monde. Toutefois, il lui est arrivé de ne
pas réussir à faire passer comme il l’aurait voulu les connaissances qu’il
possédait à travers les eaux purificatrices de la foi chrétienne. La leçon
que nous laisse le grand Évêque de Séville est qu’il n’est pas possible de
vivre ni d’aimer sans faire en même temps l’expérience de la contemplation
et de l’action.
Je suis heureux d’accueillir ce matin les pèlerins de langue française. Je
salue particulièrement les étudiants de l’Institut de philosophie comparée,
de Paris, la paroisse de Rodez, et tous les jeunes. Je vous invite à faire
dans votre vie l’unité entre la contemplation de Dieu et le service de vos
frères. Avec ma Bénédiction apostolique.
© Copyright 2008 - Libreria Editrice Vatican
Texte intégrale de la catéchèse
►
Benoît XVI évoque Saint Isidore de Séville
Texte original du
discours du Saint Père ►
UDIENZA GENERALE
 Regarder
la vidéo en
Italien ou en
Français Regarder
la vidéo en
Italien ou en
Français
Les Etymologiae de Saint Isidore
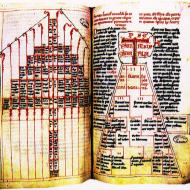 |
À cause de
la structure des Étymologies, qui rappelle celle de certaines bases de
données nommées les tries, et préfigure les inventions futures du
classement alphabétique, puis de la notion d'index, Isidore de Séville a
été proposé, en 2001, comme saint patron des
informaticiens, des utilisateurs de l'informatique, de l'Internet et des
Internautes |
Les Etymologiae
de Saint Isidore -
Pour agrandir l'image:
►
Cliquez
Isdore de Séville (né entre 560 et 570 à Carthagène
(Cartagena) - mort le 4 avril 636) était un religieux espagnol du
VIIe siècle, qui fut évêque métropolitain de Séville
(Sevilla), capitale du royaume wisigothique, entre 601 et 636.
Il vient d'une famille influente (son frère, Léandre, ami
du pape Grégoire le Grand le précède à l'épiscopat de Séville)
qui contribue largement à convertir les Wisigoths, majoritairement ariens,
au christianisme nicéen.
En 552, Carthago Nova (Carthagène) occupée par
les troupes de Justinien (483-527-565),
empereur byzantin, fut reprise et détruite par Athanagild
(531-554-567), roi des Wisigoths d'Espagne. Sévérien s'enfuit
avec son épouse et ses deux enfants, Léandre et Florentine, pour s'installer
à Séville où ce couple d'hispano-romains eut, plus tard, deux autres
enfants, Fulgence et Isidore, né après 560.
Léandre devint l'abbé du monastère de Séville, où il eut comme élève son
tout jeune frère Isidore dont il fut le tuteur, leur père étant mort alors
qu'Isidore n'était qu'un enfant. Léandre devint archevêque et occupa le
siège archiépiscopal de la Bétique, en 576. Après avoir rejeté l'arianisme,
il instruisit Récarède Ier (555-586-601), et présida, avec lui, le IIIe
concile de Tolède, le 8 mai 589, au cours duquel la conversion du roi
wisigoth au catholicisme devint officielle.
Sous l'impulsion de Léandre, Séville était devenue un centre culturel
particulièrement brillant, et la bibliothèque épiscopale, enrichie de
nombreux manuscrits apportés de Rome et de Constantinople par Léandre, et
ceux apportés par les chrétiens réfugiés d'Afrique, permettait d'avoir accès
à de nombreuses œuvres, tant sacrées que profanes. À l’entrée de la
bibliothèque sévillane, on pouvait lire : « Il est
ici bien des œuvres sacrées, bien des œuvres profanes » ; ce vers
trace à lui seul tout un programme.
Isidore reçut ainsi une instruction très complète et, lorsque Léandre
mourut, en 599/600, le clergé local suivit son souhait et élut Isidore comme
évêque.
Havre de paix dans l'Occident de cette fin du VIe siècle, l'Espagne se
trouve appelée à devenir comme le conservatoire de la culture antique ; la
bibliothèque sévillane en est alors le centre le plus brillant. Tout en
accordant une priorité aux grands écrivains chrétiens du IVe au VIe siècle,
en particulier
Augustin (354-430),
Cassiodore
(485-580), Grégoire
le Grand (540- pape 590-604) —
ce dernier fut l’ami personnel de son frère Léandre
—, Isidore tente d’assumer cet immense héritage dans toute sa diversité.
C’est pourquoi manuels scolaires et auteurs classiques s’associent, dans les
sources de ses œuvres, aux Pères latins les plus anciens :
Tertullien (155-222),
Cyprien de Carthage (200-258),
Hilaire de Poitiers (315-367),
Ambroise (340-397).
Pendant son ministère, il eut le souci constant de la formation et de
l'éducation des clercs. Il institua les écoles épiscopales sévillanes.
Puisant dans la très riche bibliothèque de Séville et s'appuyant sur une
équipe importante de copistes, il compila une somme
énorme de connaissances visant à doter la nouvelle église catholique de
solides fondations intellectuelles. Cette œuvre immense aborde
tous les domaines.
La reconquête byzantine du Sud est définitivement arrêtée en 624, Isidore
célébrera en Swinthila (636-639) « le premier
monarque à régner sur l’Espagne tout entière » après
en avoir chassé les derniers occupants byzantins, et au concile de
Tolède tenu probablement en 633, par sa formule Rex, Gens, Patria
(un Roi, un Peuple, une Patrie), il rassemblait
Hispano-Romains et Goths dans une seule et même nation, qui allait
fournir une motivation à la future Reconquista.
Pour Isidore, la qualité royale est définie par des vertus, essentiellement
par la « iustitia » et la « pietas » (bonté,
miséricorde), et les rois, avant de « rendre des comptes à Dieu à
cause de l'Église que le Christ a remis à leur défense », doivent rendre des
comptes aux évêques, qui peuvent les déclarer incapables. Les mauvais rois
sont des tyrans qui peuvent être renversés, et les
évêques peuvent excommunier ceux qui ont enfreint les lois, y compris les
lois civiles : Reges a recte agendo vocati sunt, ideoque recte
faciendo regis nomen tenetur, peccando amittitur. Ainsi, de même que les
évêques s'appuient sur la monarchie, inversement, le souverain tend à
s'appuyer sur l'Église, garante de la fidélité et de l'obéissance de ses
sujets : ces principes, qui placent les évêques sous l'autorité du roi et le
roi à la disposition des évêques, seront repris par la monarchie
carolingienne.
Son œuvre majeure est Étymologies
(Etymologiæ) constituée de vingt livres, qui
propose une analyse étymologique des mots divisée en 448 chapitres. Par
cette œuvre, il essaie de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et
de transmettre à ses lecteurs une culture classique en train de disparaître.
Son livre a une immense renommée et connaît plus de dix éditions entre 1470
et 1530, ce qui montre une popularité continue jusqu'à la Renaissance. Sa
méthode étymologique est un peu déconcertante : il explique un mot par des
termes phonétiquement proches (voir sa définition du roi :
Rex a recte agendo : on appelle « roi » celui qui agit droitement).
La plupart de ces étymologies, dont se sont moqués bien des savants depuis
la Renaissance jusqu'à nos jours, veulent imprimer les mots facilement dans
l'esprit du lecteur. Il contribue à la survivance durant le Moyen Âge de
nombreuses œuvres antiques par sa technique de citation.
Carte du monde connu, Etymologiæ de Isidorus, 1472 : le plus ancien
exemple imprimé de carte en TIl joue un rôle considérable dans la
constitution du bestiaire médiéval, notamment à travers le livre XI des
Étymologies : De homine et portentis (L'homme et
les monstres).
Parmi ses autres travaux, citons, dans le domaine de l'histoire : sa
Chronique (une histoire universelle, qui reprend la
Chronique de saint Jérôme), et son Histoire des Goths
(De origine Getarum…), dans le domaine de la lexicologie :
De differentiis verborum et Synonyma. Il est également l'auteur de
traités théologiques et d'une règle monacale (Regula
monachorum). Beaucoup d'autres traités pourraient venir
compléter cette liste ; les plus importants sont le De natura rerum,
traité d'astrologie (entre autres) composé à la
demande du roi Sisebut et le Liber numerorum
(théorie des nombres, inspirée principalement de
saint Augustin).
L’apôtre saint Jacques, jusqu’aux confins de la Terre
selon saint Isidore de Séville. Dans le De Ortu et Obitu Sanctorum
Patrum, Isidore de Séville écrit : « Jacques, fils de Zébédée et
frère de Jean prêcha l'Évangile en Hispanie, dans les régions occidentales,
et diffusa la lumière de sa prédication aux confins de la Terre. Il succomba
sous le coup de l'épée du tétrarque Hérode. Il fut enseveli à Achaia
Marmarica. … »
Dans le De Ortu et Obitu Sanctorum Patrum «
La naissance et la mort des saints Pères », il reprend les
données du De Sanctis Prophetis. Par quelle voie est parvenu à
Isidore de Séville le livret grec des Vies des Prophètes ou qui l'a traduit
en latin ? Nous ne le savons pas, mais il est évident que cela s'est
effectué, à l'époque où la domination byzantine subsistait encore, par la
pénétration d'éléments grecs dans les provinces wisigothes voisines, comme
celle où vivait Isidore. C'est à cette époque (vers 650)
que commence à circuler une traduction latine des catalogues apostoliques
grecs qui présente comme particularité remarquable de faire prêcher à
Jacques l'Évangile « en Espagne et dans les régions de l'Occident »
(au lieu de Jérusalem). Comme lieu de sépulture,
le texte latin nomme uniquement la Marmarique.
L'ouvrage le plus ancien qui contienne ce texte est le Brevarium
apostolarum, « l’abrégé » ou « bréviaire des
Apôtres. »
Isidore mourut à Séville le 4 avril 636, et en 653, le VIIIe concile de
Tolède, convoqué par Receswinthe (653-672), le
nommait doctor egregius.
Abû Amr Abbad, dit al-Motadid, («Celui qui compte sur
Dieu», 1016 - muluk al-tawaïf (émir) de Séville en 1042 - 1069),
respectueux de la foi chrétienne, autorisa à Ferdinand Ier le Grand
(1017- roi de Castille en 1035 et du León en 1037-1065), en 1063
le transfert, de Séville à León, des restes de saint Isidore, le grand
docteur de l’Église wisigothique des VIe et VIIe siècles. Sur mandat de
Ferdinand Ier, les évêques leonais et asturiens, Alvito et Ordoño, venaient
chercher à Séville les reliques du saint docteur qui furent transférées dans
l'église San Juan de Léon, désormais appelée San Isidoro
Il est canonisé par Rome en 1598 et déclaré docteur de
l'Église en 1722. Il est fêté le 4 avril. (Docteurs
et Saints de l'Église - Page 2)
Catéchèse du Saint-Père : le lien sera
mis dans l'après-midi, après traduction.
Sources : www.vatican.va
TV
-
E.S.M.
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 18.06.2008 -
T/Benoît XVI |