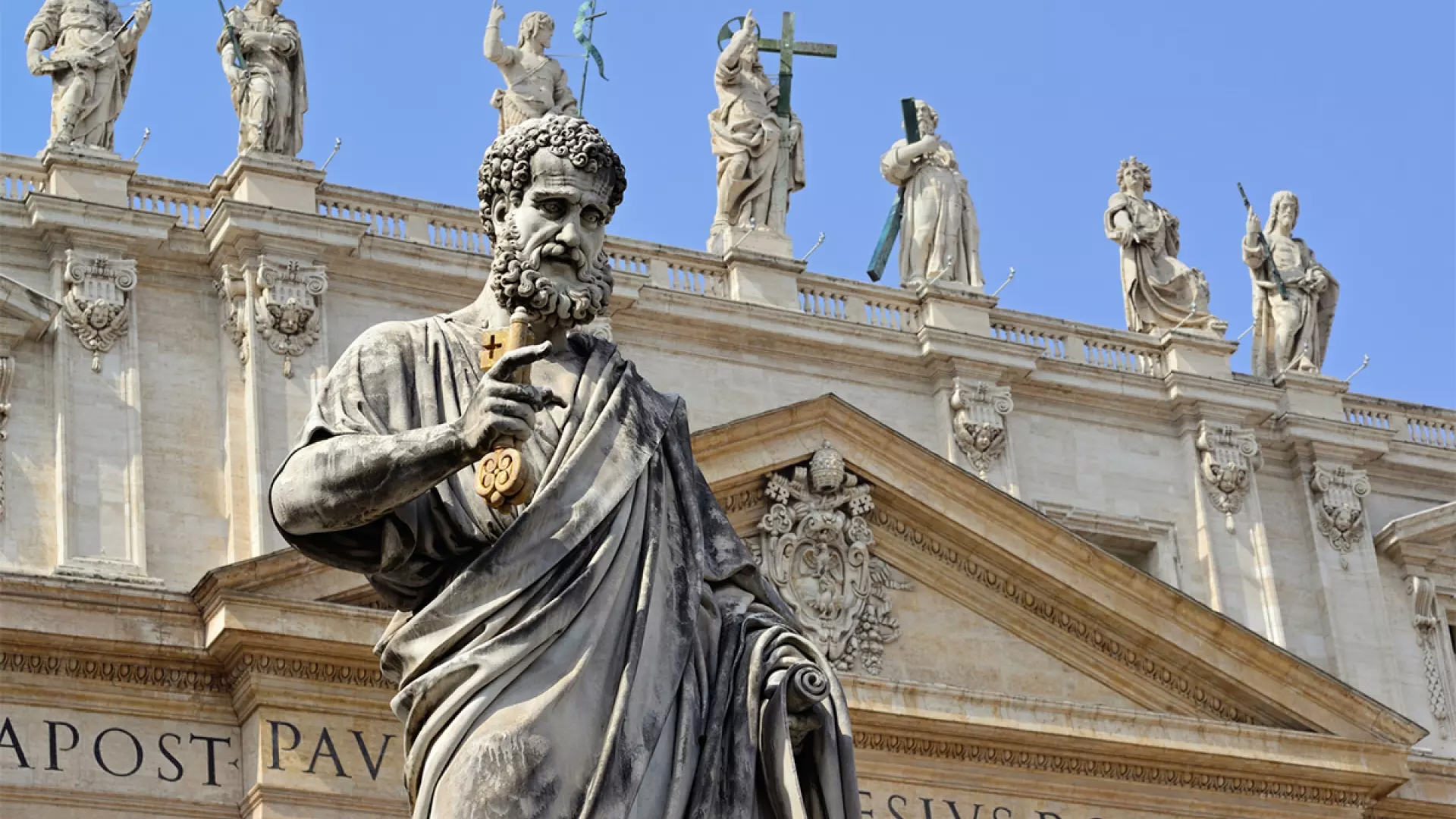 |
Appartenir à l'Église a t'il encore un sens ?
|
Le 17 décembre 2024 -
E.S.M.
-
Nous ne sommes certes pas dans l'Église pour exercer un
pouvoir au sein d'une association. Si appartenir à l'Église a un
sens, alors c'est seulement celui-ci : elle nous donne la vie
éternelle et en général rend la vie juste et vraie. Tout le reste
est secondaire. Si cela n'est pas, tout « pouvoir » dans l'Église,
ravalée alors au niveau d'une simple association, n'est plus qu'un
absurde théâtre. Je crois que nous devons de nouveau sortir de cette
idéologie du pouvoir, de cette réduction, qui découle encore des
accusations marxistes.
|
|
L'Église du Christ -
Pour agrandir l'image
►
Cliquer
Les causes du déclin
Le chapitre qui suit est extrait d'un entretien de Peter Seewald avec
le Cardinal Ratzinger/Benoît XVI et traduit de
l'allemand par Nicole Cazanova
Peter Seewald : Comment la crise de l'Eglise a-t-elle pu s'aggraver à ce
point ? Je voudrais, vous demander tout d'abord s'il ne faut pas rechercher
certains motifs hors de l'Église.
Cardinal Ratzinger/Benoît XVI : Depuis le siècle des Lumières, un vaste mouvement
considère l'Eglise comme une institution désuète. Plus la pensée moderne
s'est développée, plus cette opinion s'est renforcée. Même si des mouvements
de retour se sont produits au XIXe siècle, la ligne générale, dans
l'ensemble, s'est prolongée. Le critère suprême, c'est la justification
scientifique ; il en résulte — très nettement visible chez Bultmann - un
diktat de la prétendue image moderne du monde, qui prend un caractère
extrêmement dogmatique et exclut les interventions de Dieu dans le monde,
par exemple les miracles et la révélation. L'homme peut certes avoir une
religion, mais elle devient alors une donnée subjective et ne peut avoir de
contenus dogmatiques et communs à tous ; de même, le dogme apparaît en
contradiction avec la raison humaine. L'Église est
placée face à ce vent contraire de l'Histoire, si l'on veut, et ce vent
contraire va durer.
Malgré tout, on voit bien le caractère unilatéral de cette
position radicale héritée des Lumières, car une religion purement subjective
n'a plus de force formatrice, c'est le sujet qui se construit lui-même. La
simple rationalité, limitée aux sciences de la nature, ne peut pas répondre
non plus aux questions particulières. D'où venons-nous, que suis-je, comment
dois-je vivre, pourquoi suis-je là ? Ces questions se situent sur un autre
niveau de rationalité. Et on ne peut pas les livrer à la simple subjectivité
ou à l'irrationnel. C'est pourquoi l'Eglise, dans un avenir plus ou moins
lointain, ne sera plus simplement la forme de vie de toute une société, il
n'y aura plus de Moyen Âge, en tout cas pas dans un proche avenir. Elle sera
toujours un mouvement complémentaire, sinon un contre-mouvement opposé à la
conception dominante de la vie ; en même temps elle prouvera toujours sa
nécessité et ce qui, humainement, la fonde.
À la fin des Lumières, déjà, avant la Révolution française,
on a dit : maintenant, le pape, ce dalaï-lama de la
chrétienté, doit enfin disparaître, afin que commence l'ère de la
raison. De fait, il a bien disparu un instant — pendant son exil en France.
Mais au XIXe siècle, la papauté est devenue plus forte qu'elle ne l'avait
jamais été. Et le christianisme n'a certes pas retrouvé au XIXe siècle la
force et la forme du Moyen Âge, mais en revanche quelque chose de bien plus
beau, de grands essors sociaux qui ont produit leurs effets. Il y aura
toujours deux forces, deux courants puissants indépendants l'un de l'autre,
mais qui essaieront toujours aussi de se rejoindre. La nouvelle situation du
monde rend la foi plus compliquée, et se décider pour elle devient plus
personnel et plus difficile, mais le monde ne peut pas abandonner le
christianisme comme un vestige désuet du passé.
L'Église a trouvé de nouveaux concurrents, les hommes
comparent, évaluent et cherchent de nouveaux refuges. Peut-être était-il
plus simple, pour les anciennes générations, de préserver leur force de foi,
parce que pour eux c'était la religion de leurs ancêtres, elle avait fait
ses preuves de leur temps, et l'on ne devait pas poser trop de questions.
Aujourd'hui, cette relation a subi une altération fondamentale. Il s'est
constitué une sorte de dogme profane moderne, selon lequel l'Eglise se fonde
d'abord sur l'oppression et le pouvoir. À présent que les hommes sont
éclairés et que les États se sont sécularisés, il est tout à fait logique
que son étoile commence à décliner.
À ce sujet, je dirais deux choses : premièrement, il s'est
avéré que dans les systèmes totalitaires, l'Église, qui ne se laisse pas
intégrer à une conception unitaire de la vie, qui reste comme un pôle opposé
et qui est là comme une communauté universelle, représente une force contre
l'oppression. Le XXe siècle a révélé, d'une manière jusqu'à présent
inconnue, que cette union communautaire qu'est l'Église constitue une force
antagoniste de tous les mécanismes politiques et économiques qui oppriment
et uniformisent le monde ; elle donne aux hommes un espace de liberté et
impose une ultime frontière à l'oppression. Les martyrs ont toujours subi
cela exemplairement, pour les autres. Que l'Église soit un élément de
liberté, on le voit en Europe de l'Est comme en Chine, mais aussi en
Amérique du Sud ou en Afrique. Elle est un élément de liberté parce qu'elle
a une forme communautaire, qui inclut aussi un engagement communautaire. Si
en conséquence je me révolte contre la dictature, je ne le fais pas
seulement en mon nom personnel, mais à partir d'une force intérieure qui
dépasse mon propre moi et ma subjectivité.
Le deuxième point à présent. Il y a une idéologie qui ramène
au fond tout ce qui existe à un comportement de pouvoir. Et cette idéologie
corrompt l'humanité et détruit aussi l'Église. Je prends un exemple très
concret : si je considère l'Église au seul point de vue du pouvoir, alors
tous ceux qui n'ont pas de fonction à l'intérieur de l'Église sont déjà des
opprimés. Et ainsi la question de l'ordination des femmes passe-t-elle du
concept de pouvoir au concept d'oppression, car tout le monde doit avoir
droit au pouvoir. Je crois que cette idéologie qui ne voit partout d'autre
enjeu que le pouvoir détruit la solidarité non
seulement dans l'Église, mais dans la vie humaine en général.
Elle
donne aussi une optique totalement fausse, comme si le pouvoir était un but
ultime dans l'Eglise. Comme si le pouvoir était l'unique catégorie
permettant d'expliquer le monde et la communauté qu'il forme. Nous ne sommes
certes pas dans l'Église pour exercer un pouvoir au sein d'une association.
Si appartenir à l'Église a un sens, alors c'est seulement celui-ci : elle
nous donne la vie éternelle et en général rend la vie juste et vraie. Tout
le reste est secondaire. Si cela n'est pas, tout «
pouvoir » dans l'Église, ravalée alors au niveau d'une simple association,
n'est plus qu'un absurde théâtre. Je crois que nous devons de nouveau
sortir de cette idéologie du pouvoir, de cette réduction, qui découle encore
des accusations marxistes.
L'Église a lancé une foule considérable d'interdictions,
une sorte de code de la circulation qui doit pour ainsi dire réglementer la
rapidité de la vie. Le style de vie actuel, au contraire, nous signale à
chaque carrefour : « C'est permis : accélère. » Dans ce vertige d'euphorie
engendré par la vitesse, la religion n'est admise par la société que comme
le rêve d'un bonheur sans souffrance, une magie mystique des âmes. L'Eglise
est peut-être d'autant plus violemment critiquée et privée des avantages de
l'essor spirituel actuel quelle pose des exigences, quelle parle du péché et
de la souffrance et d'un chemin de vie fondé sur la justice. Je donnerais un
exemple de cet étrange comportement : au niveau de l'État, semble-t-il, dès
que l'on constate des infractions multipliées et que la société se sent
menacée dans sa sécurité, on exige aussitôt des lois plus sévères. Avec
l'Église, dont les lois sont de nature morale, c'est exactement l'inverse ;
là, on demande toujours plus de laxisme.
Dans la conception que l'on se fait aujourd'hui de la vie,
l'idée d'autonomie et l'idée antiautoritaire, si l'on peut s'exprimer ainsi,
tiennent une place extrêmement dominante. Aussi dominante que le concept de
pouvoir. Ces deux idées se fondent en une seule catégorie qui compte
vraiment dans la communauté des hommes. Les conséquences sont évidentes :
quand le sujet autonome a le dernier mot, il faut qu'il lui soit permis de
tout vouloir. Alors il veut emporter dans ses bagages tout ce que l'on peut
avoir de la vie. C'est vraiment, je crois, un très grand problème que pose
l'existence d'aujourd'hui. On dit que la vie est en soi compliquée et
courte, je veux en tirer tout ce qui est possible, et personne ne doit m'en
empêcher. Je dois avant toute chose arracher le morceau de vie qui me
revient, pouvoir me réaliser moi-même, et personne ne doit s'en mêler. Qui
veut m'empêcher d'empoigner la vie à bras-le-corps est mon ennemi.
Nous pouvons aussi voir transparaître cette conception de la
vie en arrière-plan des comptes rendus du Caire et de Pékin.
(la conférence de l'ONU sur la population et le développement et la
conférence de l'ONU sur les femmes du monde)
L'homme est conçu d'une manière purement
individualiste, il n'est que lui-même. On lui dérobe la relation qui fait
partie de lui-même et par laquelle seulement il devient vraiment lui. Cette
exigence d'être l'ultime et unique instance décidant de soi-même, cette
volonté de s'approprier autant de vie que possible, n'importe comment, et de
n'être entravé par personne, sont inhérentes à la conception de la vie
proposée à l'homme d'aujourd'hui. Dans cette mesure, le « tu ne dois
pas » — il y a des critères auxquels nous devons nous soumettre — est une
intervention ressentie comme une agression et contre laquelle on se défend.
En fin de compte, c'est de nouveau la question fondamentale qui est ici à
débattre : comment l'homme devient-il heureux ? Que doit-il faire pour bien
mener sa vie ? Est-il vrai qu'il doit n'avoir d'autre critère que lui-même
pour être heureux ?
J'ai discuté avec des amis, il n'y a pas longtemps, sur le
fait qu'ici, dans la région de Frascati, on est sur le point de tailler les
vignes, et qu'elles produiront des fruits seulement si on les taille une
fois l'an, que la taille est indispensable à la fructification. L'Évangile
selon saint Jean nous le dit clairement, la parabole du sarment émondé
représente l'existence humaine et aussi la communauté de l'Église. Si l'on
n'a pas le courage de pratiquer la taille, il ne poussera plus que des
feuilles. Si l'on rapporte cela à l'Église : il ne restera que du papier, et
aucune vie n'en sortira plus. Mais revenons aux
paroles du Christ qui nous dit : C'est quand tu crois que tu dois être ton
seul maître et te défendre toi-même que tu te perds. Car tu n'es pas
construit comme une île, tu n'es pas un moi qui repose sur lui-même, mais tu
es construit pour l'amour, et donc pour te donner, pour renoncer, pour être
émondé de toi-même. C'est seulement si tu te donnes, si tu te perds, comme
le Christ le dit, que tu pourras vivre.
Cette décision fondamentale doit être mise très clairement en
évidence, elle est proposée à la liberté de l'homme. Mais on devrait voir
aussi que vivre hors de la pure exigence est un mode d'existence erroné. Le
refus de la souffrance, le refus de notre condition de créature,
c'est-à-dire d'être soumis à une norme, est en fin de compte le refus de
l'amour même, et cela cause la ruine de l'être humain. Car c'est précisément
en se soumettant à une exigence et en se laissant tailler que l'homme peut
mûrir et porter du fruit.
On observe de plus en plus fréquemment que les jeunes gens
considèrent qu'il ne leur est pas assez demandé. Cela explique en partie
leur entrée dans des sectes extrêmement contraignantes : ils y cherchent
d'abord une sécurité, une protection, mais ils veulent aussi que l'on exige
beaucoup d'eux. L'homme a en lui cette certitude : il faut que l'on exige
beaucoup de moi et il faut que je me conforme à un critère supérieur et que
je me donne et que j'apprenne à me perdre
La divergence entre la foi et la société vient sans doute
aussi du fait que la société essaie de soumettre l'Église, histoire et
doctrine, à une sorte de contrôle de plausibilité. Mais ce point de départ
est-il tellement faux ?
Il n'est pas faux si l'on tente par là d'arriver à une
certaine intelligence de la foi. C'est ainsi que dès le début on a proclamé
le message chrétien. La foi n'a pu pénétrer dans le monde que par ses
missionnaires, parce qu'il était possible de la comprendre et qu'elle
pouvait aussi paraître claire aux gens. Saint Paul a pu parler dans les
synagogues non seulement aux juifs, mais aussi avec ceux que l'on appelait
les « craignant Dieu », c'est-à-dire des païens qui avaient reconnu le vrai
Dieu dans le monothéisme d'Israël. Il leur fit comprendre, en argumentant,
que c'est seulement avec le Christ que le judaïsme et le paganisme
monothéiste influencé par le judaïsme arrivaient à leur pleine logique.
Dans cette mesure, l'effort du christianisme pour
rendre une réponse compréhensible est essentiel. Si toutefois on prend le
concept de plausibilité en un sens étroit, au point de ne plus garder du
christianisme que les choses adaptées à nos habitudes de vie actuelles,
alors nous dévalorisons le christianisme et, nous-mêmes, nous ne valons plus
rien.
Articles suivants :
►
Les
fautes de l'Église
►
Les éternelles rengaines visant à affaiblir l'Église
►
Nous sommes le peuple de Dieu
►
Autorité sacrée et amour fraternel
|
Les
lecteurs qui désirent consulter les derniers articles publiés par le
site
Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent cliquer
sur le lien suivant
► E.S.M.
sur Google actualité |
Sources :Texte original des écrits du Cardinal J.
Ratzinger-
E.S.M.
Ce document est destiné à l'information; il ne
constitue pas un document officiel
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 17.12.24
|