|
La liturgie et la musique sacrée |
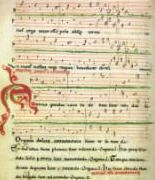 |
Lundi 15 janvier 2007 -
(E.S.M.) -
Joseph Swain nous confie ses observations sur
la liturgie telle qu'elle est célébrée dans la basilique St Marc, à
Venise et il apparaît clairement que le chant grégorien et la musique
polyphonique s'adaptent parfaitement à la continuité de la
messe.
|
Le chant grégorien
La liturgie et la musique sacrée
Basilique Saint-Marc : une liturgie sans cantiques
N'est-ce pas cette liturgie de la grande basilique vénitienne que le Concile
avait en vue ?
par Joseph Swain
Je le redis une fois encore, ce fût une bénédiction d'avoir eu la chance de
vivre à Venise pendant cinq mois, de juillet à décembre 2005, comme
directeur d'un groupe d'étudiants en mission d'étude et ayant reçu le
soutien financier de l'Université de Colgate (New York) où j'enseigne
normalement. Depuis mon dernier voyage en 1994, un nouveau maître de
chapelle a été nommé dans l'église la plus célèbre de la ville, la basilique
Saint-Marc, lieu où reposent les reliques de l'évangéliste et siège du
patriarcat de Venise. De merveilleuses améliorations de la musique
liturgique y ont pris place. Cette nouvelle façon de concevoir les
programmes musicaux est un défi à la manière dont les Américains pensent la
musique liturgique, en ceci de particulier que ces programmes ne comportent
plus aucun cantique.
Il suffit de jeter un oeil aux suggestions musicales et aux conseils donnés
dans nos magazines liturgiques « commerciaux », d'écouter les gens vous
donner leurs opinions et préférences, ou de voir les prêtres et les
commissions liturgiques lorsqu'ils mettent au point les programmes de
chants : en Amérique certainement, et ailleurs tout aussi sûrement, nous
faisons une fixation sur les « quatre chants » – les cantiques entonnés au
début de la messe, à l'Offertoire, après la Communion, et à la sortie.
Cette particularité dérive d'une tradition allemande préconciliaire de
chanter les cantiques et hymnes d'assemblée lors des messes basses
(c'est-à-dire, entièrement dite, et sans musique) aux endroits où le propre
de la messe aurait été normalement chanté par une chorale dans une liturgie
plus solennelle. Le célébrant devait prononcer les textes prescrits pendant
que l'assemblée chantait – dans le meilleur des cas – une paraphrase en
vers, ou sinon simplement un cantique de dévotion familier. La tradition,
remontant au moins au XVIIIe siècle, correspondait au désir naturel de
l'assemblée de prier en chantant comme lors d'une messe solennelle. Le
concile Vatican II, pour promouvoir une telle « participation active », a
chargé l'assemblée de chanter les véritables textes liturgiques. Mais
comme les mélodies grégoriennes du propre ne sont pas si aisées, les évêques
se sont emparés des clauses les moins exigeantes de la Constitution sur la
Liturgie et de ses instructions : ils ont permis qu'aux mélodies
grégoriennes soient substitués des cantiques plus faciles et plus familiers.
À une exception près, les « quatre chants » continuent de servir de
remplacement aux textes prescrits dans le Missel romain pour les fêtes
particulières, c'est-à-dire les textes du propre de l'ancienne tradition :
l'Introït (ou antienne d'entrée), l'antienne de l'Offertoire, et l'antienne
de Communion. La dénomination « antiennes » (antiphonae) tient du fait que
dans les anciens temps, elles n'étaient pas chantées pour elles-mêmes, mais
en réponse aux versets du Psaume tout entier. L'exception reste le chant
d'envoi (ou chant de sortie) qui ne prend la place de rien du tout, mais
satisfait plutôt notre besoin moderne et esthétique d’un « grand final »,
comme dans un opéra ou dans un film hollywodien.
Néanmoins, notre fixation sur les « quatre chants », apparaît quelque peu
en contradiction avec les exhortations du Concile. « Pour promouvoir la
participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les
réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques [...] »
(Constitution conciliaire, Sacrosanctum concilium, sur la sainte Liturgie,
Art. 30). Les « cantiques » ne sont cités dans l'énumération qu'en dernière
priorité. Les documents préconciliaires sur la musique sacrée
Mediator Dei
(Pie XII, 1947) et
Musicae Sacrae (Pie XII, 1958) et les directives
américaines comme Music in Catholic Worship (1983) donnent les mêmes
priorités, parfois avec plus de détail. Mais dans une paroisse américaine
typique, lorsque les ressources ne permettent pas une musique très élaborée,
les assemblées ne chantent ni le Psaume ni l'ordinaire de la messe (par
exemple le Gloria) mais seulement ces « quatre chants ».
Voilà pourquoi l'usage en cours à la basilique Saint-Marc de Venise est
intéressant et instructif. Au cours de la demi-douzaine de messes
solennelles auxquelles j'ai participé, il n'a été chanté aucun cantique
excepté un chant d'entrée à Marie sur la mélodie du « O Sanctissima » pour
la vigile de la fête de l'Immaculée Conception. Autrement, aucune musique
ressemblant à ce que les Américains auraient appelé un chant d'assemblée.
Pourtant la participation active des gens par une musique liturgique riche
et variée était à la fois continue et fervente.
Voici un programme typique de la basilique :
1. Introit. Après un prélude d'orgue, la chorale chante les paroles de
l'antienne du jour, en latin, sur une composition polyphonique avec le
soutien d'un accompagnement d'orgue. L'assemblée, debout, écoute et
contemple la procession d'au moins une douzaine de ministres, suivie par
l'encensement de l'autel.
2. Invocation et accueil. Les chants sont exécutés par le célébrant en
langue vernaculaire (italien). L'assemblée répond de la même manière.
3. Kyrie eleison. Chanté en grec, sur une simple mélodie grégorienne,
l'assemblée répondant à la chorale.
4. Gloria in excelsis Deo. Chanté par la chorale seule, habituellement en
latin, sur une composition polyphonique.
5. Prière, chantée en italien par le célébrant, suivie par la première
lecture, qui est dite.
6. Psaume responsorial. Un chantre donne l'intonation du refrain, auquel
répond l'assemblée. Le chantre psalmodie ensuite les versets par deux,
toujours en italien, après quoi l'assemblée répond en chantant les deux
versets suivants.
7. Acclamation de l'Évangile. Succédant à la seconde lecture (dite),
l'assemblée chante un simple Alleluia, la chorale chantant ensuite le
verset. L'Évangile est lu en italien, excepté lors de la célébration par le
patriarche de la vigile de l'Immaculée Conception, où il est chanté en
italien.
8. Credo. Toujours le très classique Credo III (XVIIe siècle) tiré du Liber
Usualis, chanté en latin avec dialogue entre le choeur et l'assemblée. Le
feuillet distribué aux fidèles indique, en caractères gras, les paroles qui
doivent être chantées.
9. Chant d'offertoire. Une composition polyphonique pour choeur accompagne
la procession des dons, l'encensement des ministres et de l'assemblée.
10. Les dialogues de la préface sont chantés en italien par le célébrant et
l'assemblée. Le célébrant chante ensuite la préface en italien. La chorale
donne immédiatement ensuite le Sanctus sur une polyphonie avec texte en
latin.
11. La Prière eucharistique est dite en italien par le célébrant. L'anamnèse
– un chant en italien (toujours le même) – est chanté.
12. Pater noster. Chanté en latin par le choeur et l'assemblée sur le ton
grégorien traditionnel (à nouveau, le texte latin est donné entièrement sur
le programme).
13. Agnus Dei. Chanté en latin par la chorale et l'assemblée sur une
mélodie grégorienne.
14. Chant de Communion. Une composition polyphonique pour choeur.
15. Rite d'envoi. Chanté en italien par le célébrant, l'assemblée répondant
de même.
16. La «sortie» est habituellement accompagnée par une brillante pièce
d'orgue. Occasionnellement, il arrive que ce soit le choeur qui chante,
auquel cas l'orgue conclut la pièce par un postlude.
L'expérience de cette Liturgie de la basilique Saint-Marc appelle au moins
cinq observations.
Premièrement, il apparaît clairement que le chant grégorien et la musique
polyphonique s'adaptent parfaitement à la continuité dramatique de la
messe. En comparaison, les hymnes et chants, qu'ils soient luthériens,
anglicans, ou de tout type moderne, paraissent souvent arrêter l'action
liturgique – à l'exception de ceux qui servent à accompagner une procession
– car leur forme strophique et leur versification mesurée ne ressemble à
rien d'autre au cours de la messe. Ils se tiennent là, comme des
gratte-ciels en rase campagne. C'est sûrement la raison pour laquelle,
historiquement, les hymnes ont été limitées à l'Office des Heures (Matines,
Vêpres, etc.), qui sont essentiellement des liturgies contemplatives. La
messe, par contraste, est une action, avec sa direction propre. Il n'y a
pas de musique autre que le chant grégorien qui puisse promouvoir cette
action d'aussi belle manière, avec son rythme fluide, et sa mise en musique
de textes aussi efficace.
Deuxièmement, l'expérience liturgique de Saint-Marc contredit complètement
le stéréotype d'un répertoire poussiéreux de polyphonies et de chants
grégoriens toujours identiques. Les compositions polyphoniques données à
Saint-Marc vont du XVIe au XXe siècle, les plus modernes étant largement
fournies en dissonances et en rythmes complexes, à des années lumières de
la musique de Palestrina. L'exécution du chant est déclinée au moins en six
modes de présentation : voix solo a cappella, choeur a cappella, assemblée a
cappella, les trois mêmes pouvant aussi être interprétés sur divers
accompagnements harmonisés à l'orgue. Il est donc difficile de rivaliser
avec cette messe solennelle en variété de sons et d'effets musicaux
Troisièmement, la messe qui est chantée est strictement celle prescrite dans
les livres liturgiques. Les paraphrases et substitutions ne sont présentes
que rarement. Le déroulement est donc très proche de celui que les Pères du
Concile avaient en tête dans le chapitre VI sur la musique dans la
Constitution sur la sainte Liturgie,
Sacrosanctum Concilium (1963).
Quatrièmement, l'assemblée est soulagée de cette course effrénée qui lui est
imposée de l'apprentissage de nouvelles mélodies semaine après semaine. Les
textes les plus variables – le propre – sont confiés à un choeur entraîné,
capable d'apprendre rapidement les centaines de mélodies et
harmonisations sur lesquels ils sont chantés. L'assemblée chante, bien
sûr, un nouveau Psaume chaque semaine, mais le reste du temps elle
interprète le noyau des prières ordinaires et des acclamations, qui elles,
restent invariables. L'assemblée y semble très à l'aise. C'est peut-être ce
qui explique la dernière remarque.
Cinquièmement, l'absence de cantiques ne signifie en rien une perte de la
participation active de l'assemblée. Sur les seize moments liturgiques cités
plus haut, l'assemblée en chante onze, et participe par une écoute et une
contemplation actives aux cinq autres. Le déroulement liturgique continu et
la variété musicale laissent les fidèles entièrement impliqués (mon épouse,
une grande admiratrice de musique liturgique, a admis qu'elle n'avait pas
remarqué l'absence de cantiques à la basilique Saint-Marc, jusqu'à ce que je
lui confie la relecture de cet article). Le chant de l'assemblée semble
passionné et enthousiaste, ceci en dépit d'une proportion toujours
importante de touristes. De fait, le Credo III, une mélodie grégorienne
longue et non répétitive, chantée uniquement à partir du texte rappelé sur
les feuilles (sans notation musicale), sort si merveilleusement qu'il est
effectivement le signe d'une assemblée qui prend son rôle à coeur.
Une basilique majeure comme Saint-Marc profite bien sûr de ressources que
bien peu de paroisses possèdent : un organiste virtuose, un choeur
professionnel, et une abondance de ministres. Cela prouve encore la sagesse
du conseil donné par le Concile au sujet des priorités en matière de musique
liturgique. C'est un encouragement à essayer de penser un peu au-delà des
quatre chants traditionnels, et peut-être à amorcer les prochaines étapes,
que même les paroisses modestes peuvent entreprendre, de ce voyage sans fin
vers une Liturgie parfaite.
Joseph Swain enseigne la théorie et l'histoire
de la musique à l'université de Colgate (Hamilton, New York) depuis 22 ans.
Son Dictionnaire historique de la musique sacrée paraîtra chez Scarecrow
Press en décembre 2006. Cet article est paru dans Pastoral Music en août
2006, et est reproduit ici avec la permission de l'auteur. Un article
antérieur du Dr. Swain – Le latin liturgique reconsidéré, a été publié dans
l'édition de mars 2003 du Bulletin d'Adoremus.
Rubrique - Musique
Sacrée
Sources: Adoremus -
E.S.M.
Eucharistie, sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 15.01.2007 - BENOÎT XVI |