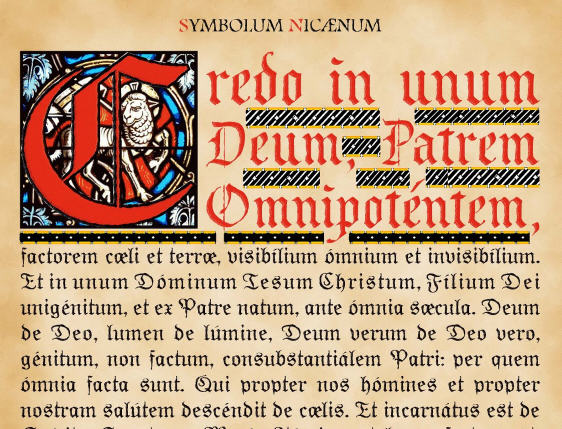 |
Benoît XVI : La foi en un seul Dieu
|
Le 22 avril 2023 -
E.S.M.
-
Se déclarer pour le Credo, c'était par le fait même refuser
les lois du monde ambiant, dont le chrétien faisait partie : refus
d'adorer le pouvoir politique alors en vigueur, comme l'exigeait
l'Empire romain décadent ; refus d'adorer le plaisir ; refus aussi
du culte de la crainte et de la superstition, qui infestait le
monde.
|
|
Credo in unum Deum -
Pour agrandir l'image
►
Cliquer
Benoît XVI : La foi en un seul Dieu
Article précédent
:
Benoît XVI : Qu'est-ce que Dieu ?
II. LA FOI EN UN SEUL DIEU
Benoît XVI : Qu'est-ce que Dieu ?
Revenons au premier article du Symbole : « Je crois en Dieu, Maître de
toutes choses, Père, Créateur. » Cet article du Credo, qui, depuis deux
mille ans, sert au chrétien pour affirmer sa foi, remonte à une époque bien
plus ancienne ; il est la transcription chrétienne de la profession de foi
quotidienne d'Israël : « Écoute, ô Israël,
Yahvé, ton Dieu, est unique
7. »
Dès ses premières paroles, le Credo chrétien reprend le Credo d'Israël, sa
quête de Dieu, l'expérience de foi d'Israël : sa lutte pour Dieu devient
ainsi une dimension intérieure de la foi chrétienne, foi qui n'existerait
pas sans cette lutte. Nous touchons ici, en passant, une loi capitale de
l'histoire des religions et de la foi : celle-ci se développe toujours en
liaison avec ce qui précède, sans qu'il y ait jamais discontinuité totale.
La foi d'Israël constitue certes une nouveauté au regard de la croyance des
peuples d'alentour; cependant elle n'est pas tombée du ciel; elle croît dans
une ambiance de lutte, dans l'affrontement avec les croyances environnantes,
opérant une sélection et une réinterprétation, qui impliquent à la fois
continuité et transformation.
« Yahvé, ton Dieu, est un Dieu unique », cette profession de foi
fondamentale est comme la toile de fond supposée par notre Credo ; elle
signifie primitivement le refus des divinités des peuples environnants.
C'est une confession, au sens plénier du mot, non pas une simple opinion
parmi d'autres mais une option existentielle. En tant que rejet des dieux,
elle signifie le refus de diviniser
les puissances politiques ou les processus cosmiques de mort et de vie. Si
l'on peut dire que la faim, l'amour et la puissance sont les trois forces
qui meuvent l'humanité, l'on peut affirmer également que les trois formes
principales du polythéisme sont l'adoration du pain, l'adoration de l'éros,
l'idolâtrie du pouvoir. Ces trois formes sont des déviations; elles
absolutisent ce qui n'est pas l'Absolu lui-même, et de ce fait, elles
asservissent l'homme. Il est vrai toutefois qu'à travers ces égarements
s'exprime comme un pressentiment de la Puissance qui soutient le monde.
La
confession de foi d'Israël constitue, nous l'avons dit, une déclaration de
guerre à cette triple idolâtrie, et représente ainsi un facteur essentiel
dans l'histoire de la libération de l'homme ; en même temps et plus
radicalement, elle est une lutte contre la multiplication et l'émiettement
du divin tout court. C'est, comme nous le verrons encore plus en détail, le
rejet de dieux particuliers, ou autrement dit, le refus de déifier son
propre bien, caractéristique essentielle du polythéisme. C'est renoncer à
mettre en sûreté, à garantir son bien particulier, c'est surmonter la
crainte qui s'efforce de se concilier le mystère redoutable en lui rendant
un culte ; en même temps, c'est adhérer à l'unique Dieu du ciel, au
Protecteur tout-puissant ; c'est avoir le courage, sans manipuler le divin,
de se confier à la Puissance qui régit le monde entier.
Cette situation de départ, léguée par la foi d'Israël, est restée sans grand
changement dans le Credo des premiers chrétiens. Le fait d'entrer dans la
communauté chrétienne et d'accepter son « Symbole » représente une option
existentielle, entraînant de très graves conséquences. En effet, se déclarer
pour le Credo, c'était par le fait même refuser les lois du monde ambiant,
dont le chrétien faisait partie : refus d'adorer le pouvoir politique alors
en vigueur, comme l'exigeait l'Empire romain décadent ; refus d'adorer le
plaisir ; refus aussi du culte de la crainte et de la superstition, qui
infestait le monde. Ce n'est pas un hasard, si la lutte chrétienne s'est
déclenchée sur ce terrain et eut pour enjeu les principes mêmes de la vie
publique dans l'antiquité.
Il est très important, me semble-t-il, si nous voulons faire nôtre le Credo
aujourd'hui, de saisir à nouveau ces rapports. Nous regardons trop
facilement comme un fanatisme propre aux temps primitifs et par là
excusable, mais nullement à imiter de nos jours, ce geste des chrétiens qui
refusaient, au prix même de leur vie, toute compromission avec le culte de
l'empereur, allant jusqu'à en rejeter les formes les plus inoffensives,
comme, par exemple, l'inscription sur une liste de sacrifice. De nos jours,
en pareil cas, on distinguerait entre loyalisme civique obligé et un acte
religieux véritable; on chercherait un compromis possible, en prétextant que
l'héroïsme n'est pas le fait de l'homme moyen. Une telle distinction est
peut-être, dans certains cas, possible aujourd'hui, mais cela grâce
précisément à l'attitude décidée des chrétiens de ce temps-là. Ce qui, en
tout cas, importe, c'est que ce refus, loin d'avoir été un fanatisme étroit
et borné, a opéré une transformation du monde telle qu'elle ne saurait être
obtenue qu'au prix de la souffrance. Dans ces
circonstances, il apparut que la foi n'est pas un simple jeu de l'esprit
mais une affaire extrêmement sérieuse. Elle oppose un « non »
catégorique à l'absolutisme du pouvoir politique, à l'adoration de la
puissance des Grands : « II a renversé les puissants de leurs trônes ! » (Lc
1, 52) ; de la sorte elle a ruiné une fois pour toutes la prétention
totalitaire du principe politique. La confession du
Dieu unique constitue ainsi, à cause même de l'absence d'intentions
politiques, un programme d'une importance politique radicale ; en
vertu du caractère absolu qu'elle confère à chaque personne de par sa
relation à Dieu, et en vertu du caractère relatif dont elle marque toutes
les sociétés politiques, les référant au Dieu unique
qui les contient et les embrasse toutes, elle représente en définitive la
seule défense contre la tyrannie du collectif et surmonte radicalement tout
exclusivisme dans l'humanité.
Ces considérations au sujet de la lutte chrétienne contre la
déification du pouvoir pourraient également s'appliquer à la lutte menée
pour l'amour humain authentique contre la fausse adoration du Sexe et de l'Éros,
source d'asservissement de l'homme autant que l'abus du pouvoir. Il y a plus
qu'une simple image dans les paroles des prophètes flétrissant l'apostasie
d'Israël, en la qualifiant « d'adultère ». Les cultes étrangers étaient
presque toujours liés à la prostitution cultuelle et justifiaient la
qualification d'adultère par leur forme extérieure même ; par là ils
trahissaient leur orientation profonde. Pour
comprendre que l'amour entre l'homme et la femme est unique, définitif et
sans partage, il faut se référer à la foi en
l'unité et en l'indivisibilité de l'amour de Dieu. Nous comprenons
aujourd'hui toujours mieux à quel point cette conception de l'amour, loin de
pouvoir être déduite philosophiquement et justifiée par elle-même, suppose
nécessairement la foi en un Dieu unique. Et nous
comprenons toujours mieux combien la soi-disant libération de l'amour au
profit des caprices (Beliebigkeit) de
l'instinct livre l'homme à la tyrannie du Sexe et de l'éros, en le
précipitant dans un esclavage impitoyable, alors qu'il prétend se
libérer. Dans la mesure où l'homme s'éloigne de Dieu, il devient la proie
des « dieux ». Pour être libéré, il faut qu'il accepte de se laisser
libérer, en renonçant à se fier à lui-même.
Il importe également, après avoir vu la signification du
refus impliqué dans le Credo, de saisir le sens de l'assentiment, du
« oui », qu'il comporte. Le « non », en effet, n'a sa raison d'être qu'en
fonction du « oui ». Or, ce refus des premiers siècles chrétiens a eu
pour conséquence historique la disparition irrévocable
des dieux. Sans doute les puissances qu'ils représentaient n'ont pas
disparu, pas plus que la tentation de l'absolutisation de ces
puissances. C'est là un effet de
la condition humaine ; les deux faits expriment pour ainsi dire la « vérité
» permanente du polythéisme : l'absolutisation du pouvoir, du pain, de l'éros,
menace les hommes d'aujourd'hui autant que ceux de l'antiquité. Cependant,
même si ces divinités de jadis sont restées aujourd'hui encore des «.puissances
» avec des prétentions totalitaires, elles ont quand même perdu leur masque
divin, elles se voient contraintes de paraître dans leur vraie « profanité
». C'est là la différence essentielle entre le paganisme pré-chrétien et le
paganisme post-chrétien; celui-ci porte la marque imprimée à l'histoire
humaine par le refus chrétien des dieux païens. Dans le vide où nous sommes
aujourd'hui à beaucoup d'égards, surgit d'une façon d'autant plus impérative
la question : quel est le contenu de l'assentiment que représente la foi
chrétienne ?
Note :
7. Texte du Schéma (prière ainsi appelée
d'après la première parole : « Écoute, Israël »), cf. Dt 6, 4 ss.
A suivre :
La foi biblique en Dieu - I Le problème de l'histoire du Buisson
Ardent
|
Les
lecteurs qui désirent consulter les derniers articles publiés par le
site
Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent cliquer
sur le lien suivant
► E.S.M.
sur Google actualité |
Sources :Texte original des écrits du Saint Père Benoit XVI -
E.S.M.
Ce document est destiné à l'information; il ne
constitue pas un document officiel
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 22.04.2023
|