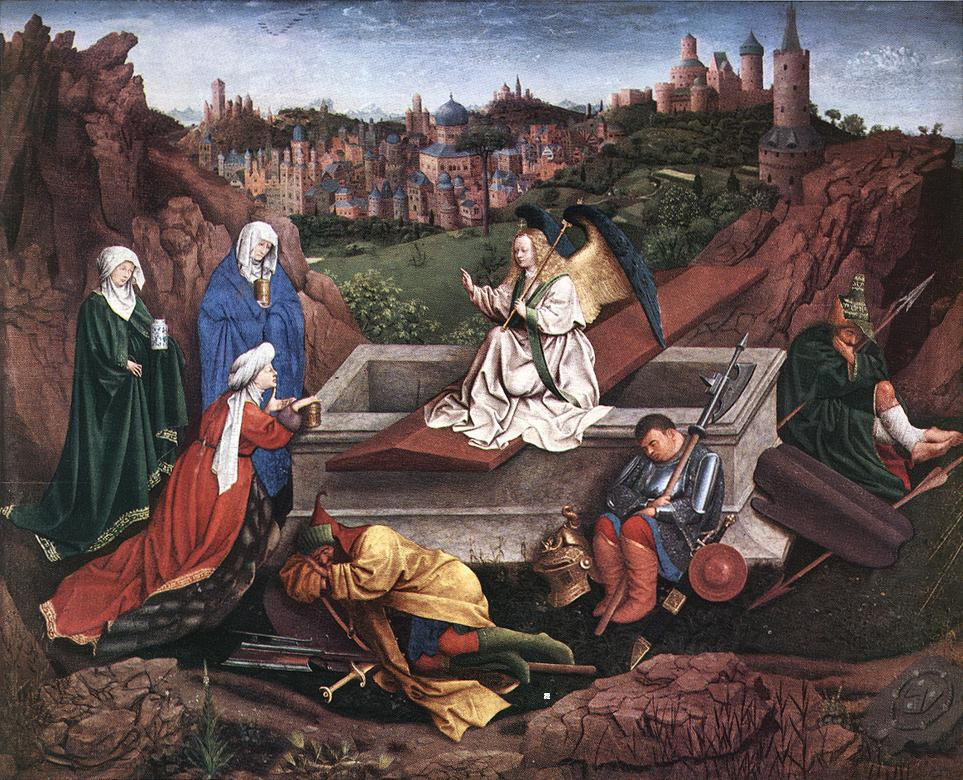 |
Benoît XVI : l'amour exige d'être infini,
indestructible
|
Le 18 mars 2023 -
E.S.M.
-
L'expérience du Ressuscité est tout autre chose que la simple
rencontre avec un homme appartenant à notre histoire ; il ne
faudrait surtout pas la réduire à des conversations de table et à
des souvenirs, qui auraient finalement donné consistance à l'idée
qu'il était vivant et que sa cause continuait. Une telle explication
ramène l'événement à un niveau simplement humain et le vide de
l'essentiel.
|
|
Les trois Marie devant le
tombeau vide, par Jan van Eyck -
Pour agrandir l'image
►
Cliquer
THEOLOGIE
4) « Est ressuscité des morts
La
confession de la foi en la résurrection de Jésus-Christ est pour les
chrétiens l'expression de la certitude que cette parole est vraie, qui
semblait n'être qu'un beau rêve : « L'amour est plus
fort que la mort » (Ct 8, 6). Dans l'Ancien Testament, cette
affirmation figure dans une hymne à la puissance de l'eros. Mais cela ne
veut aucunement dire que l'on puisse simplement l'écarter comme exagération
lyrique. Dans la prétention illimitée de l'eros, dans ses apparentes
outrances et démesures, c'est un problème fondamental, et même le
problème fondamental de l'existence humaine qui trouve son expression, en
tant que s'y manifestent l'essence et le paradoxe interne de l'amour :
l'amour exige d'être infini, indestructible ;
il est pour ainsi dire un appel d'infini. Or il se
trouve qu'en même temps cet appel est une visée irréalisable ;
l'amour exige l'infini, mais ne peut le donner ; il
prétend à l'éternité, mais en réalité il fait partie du monde de la mort,
avec sa solitude et sa puissance de destruction. C'est à partir de là
seulement que l'on peut comprendre ce que signifie la «
résurrection ». Elle est
le triomphe de l'amour sur la mort.
Elle constitue en même temps la garantie de ce qui
seul peut créer l'immortalité, c'est-à-dire : être
dans l'autre qui subsiste encore lorsque je suis retombé en poussière.
L'homme est l'être qui ne vit pas lui-même éternellement, qui est
nécessairement voué à la mort. Humainement parlant, ne
subsistant pas lui-même toujours, il ne peut
survivre qu'en continuant à subsister dans un autre. Les affirmations
de l'Écriture sur le lien entre péché et mort sont à comprendre dans cette
perspective. Car il apparaît clairement à présent que la tentative de
l'homme « d'être comme Dieu », son aspiration à une « autarcie » où il
subsisterait uniquement en lui-même, représentent en réalité sa mort, car
c'est un fait que lui-même ne saurait subsister toujours. Quand l'homme - et
c'est là la véritable essence du péché - veut pourtant, en méconnaissant ses
limites, ne dépendre que de lui-même et être pleinement autonome,
il se livre par là même à la mort.
Or l'homme se rend tout de même compte que sa vie,
à elle seule, ne résiste pas au temps et qu'il doit donc tendre à être en
d'autres, pour demeurer, par eux et en eux, sur la terre des vivants. Deux
voies surtout ont été essayées. Tout d'abord, la survie dans ses propres
enfants : de là vient que le célibat et la stérilité étaient regardés chez
les peuples primitifs comme la plus terrible des malédictions; ils
signifient la ruine inéluctable, la mort définitive. A l'inverse, le plus
grand nombre possible d'enfants offre également le plus de chance de survie,
il est l'espérance d'immortalité et donc la véritable bénédiction que
l'homme peut espérer. Une autre voie s'ouvre, quand l'homme découvre que sa
survie dans les enfants est tout de même très peu authentique et
personnelle; il souhaite voir subsister davantage de lui-même. Il se réfugie
alors dans l'idée de la gloire qui doit réellement le rendre immortel
lui-même, en lui garantissant la survie dans la mémoire des autres à travers
les siècles. Mais cette deuxième tentative de l'homme pour se procurer à
lui-même l'immortalité par l' « être-dans-les-autres » est vouée au même
échec que la première : ce qui demeure, ce n'est pas lui-même, mais un
simple écho, une simple ombre. Et ainsi l'immortalité que l'homme se procure
lui-même n'est en réalité qu'un Hadès, un shéol, plus proche du néant
que de l'être. L'insuffisance des deux voies vient du fait que l'autre, qui
maintient mon être après ma mort, ne peut pas en réalité maintenir mon être
même, il n'en conserve que l'écho ; et d'autre part, plus radicalement
encore, l'autre à qui j'ai pour ainsi dire confié ma survie ne subsistera
lui-même pas toujours - lui aussi retombera en poussière.
Nous pouvons alors faire un pas de plus. Nous
avons vu jusqu'à présent que l'homme en lui-même ne subsiste pas toujours,
qu'il ne peut donc continuer à subsister que dans l'autre, mais que dans cet
autre il ne demeurera jamais qu'à l'état d'ombre, et encore pas de façon
définitive, car l'autre aussi disparaîtra. Dans ces conditions,
un seul pourrait fournir un véritable
appui : celui qui est,
qui ne naît pas
pour mourir ensuite, mais qui demeure au milieu des choses qui deviennent et
qui passent : le Dieu des vivants, qui ne
maintient pas seulement l'ombre et l'écho de mon être et dont les pensées ne
sont pas de simples reproductions en images du réel. Je suis moi-même sa
pensée, à lui qui me pose dans l'être plus originellement que je ne suis en
moi-même; sa pensée n'est pas l'ombre projetée par mon être, mais la force
qui lui donne origine. En lui, je ne subsiste pas
seulement comme ombre, je suis en fait davantage moi-même en lui, que
lorsque j'essaye d'être simplement moi-même.
Avant de revenir, à partir de là, à la
résurrection, essayons de considérer encore une fois la question sous un
angle quelque peu différent. Nous pouvons pour cela reprendre la parole sur
l'amour et la mort et dire : là seulement où pour quelqu'un l'amour compte
plus que la vie, c'est-à-dire là où quelqu'un est prêt à faire passer la vie
après l'amour, à la mettre en jeu à cause de l'amour, là seulement l'amour
est aussi plus, et plus fort que la mort. Pour devenir plus que la mort,
l'amour doit d'abord être plus que la vie. Or, s'il pouvait en être ainsi,
non plus seulement dans l'ordre de l'intention, mais dans la réalité, cela
voudrait dire que la puissance de l'amour se serait élevée au-dessus de la
puissance du biologique et aurait mis le biologique à son service. Pour
prendre la terminologie de Teilhard de Chardin : là où il en serait ainsi,
la complexité et la complexification définitives se seraient réalisées ;
même le bios serait alors englobé et compris dans la puissance de l'amour.
L'amour dépasserait alors sa limite - la mort - et créerait l'unité là où la
mort sépare. Si jamais l'amour pour l'autre arrivait à être fort, au point
de pouvoir garder vivant non seulement le souvenir de l'autre, l'ombre de
son Moi, mais sa personne même, alors on aurait atteint un nouveau seuil de
la vie, qui laisserait derrière lui la sphère des évolutions et mutations
biologiques ; il représenterait le passage à un autre niveau, où l'amour ne
serait plus subordonné au bios, mais le mettrait à son service. Ce dernier
stade de « mutation » et d' « évolution » ne serait plus un stade
biologique, il représenterait l'affranchissement de la tyrannie du bios, qui
est en même temps tyrannie de la mort ; il ouvrirait la sphère que la Bible
grecque appelle « Zoé », c'est-à-dire vie définitive, où le règne de
la mort est aboli. Le dernier stade de l'évolution, dont le monde a besoin
pour atteindre son but, ne se réaliserait plus à l'intérieur du biologique,
mais serait le fruit de l'esprit, de la liberté, de l'amour. Il ne serait
plus évolution, mais décision et don à la fois.
Mais quel rapport tout cela a-t-il avec la foi en
la résurrection de Jésus ? Nous avions jusqu'à présent envisagé la question
d'une possible immortalité de l'homme à partir de deux points de vue, qui
d'ailleurs s'avèrent maintenant être des aspects d'une seule et même
réalité. Puisque l'homme, avions-nous dit, ne peut subsister toujours en
lui-même, sa survie ne saurait être assurée que s'il continue à vivre dans
un autre. Et nous avions dit, en nous plaçant au point de vue de cet autre,
que seul l'amour, qui accueille l'être aimé en lui, pouvait permettre
d'être, de vivre dans l'autre. Ces deux aspects complémentaires se
reflètent, me semble-t-il, dans les deux formules néo-testamentaires qui
décrivent la résurrection : « Jésus est ressuscité » et « Dieu (le Père) a
ressuscité Jésus ». Les deux formules se rejoignent dans le fait que l'amour
total de Jésus pour les hommes, qui le conduit à la croix, s'achève dans le
dépassement total vers le Père, et devient ainsi plus fort que la mort,
parce que par là il est en même temps appui total reçu du Père.
Cela nous permet de faire un pas de plus dans notre
réflexion. Nous pouvons dire maintenant que l'amour crée toujours, d'une
manière ou d'une autre, une certaine immortalité ; même dans ses ébauches
pré-humaines, il tend dans ce sens par la conservation de l'espèce. Et
d'être ainsi principe d'immortalité n'est pas quelque chose d'accessoire
pour l'amour, une de ses conséquences parmi d'autres, c'est vraiment
l'essence de l'amour. On peut inverser cette affirmation et dire :
l'immortalité procède toujours
de l'amour, jamais de l'autarcie de ce qui se suffit à soi-même.
Nous
pouvons même pousser l'audace jusqu'à affirmer que ce principe vaut
également pour Dieu, tel que le voit la foi chrétienne. Si Dieu est
subsistance et permanence absolues face à tout ce qui change, c'est parce
qu'il est en trois personnes ordonnées l'une à l'autre et qui n'ont d'autre
réalité que d'être l'une pour l'autre ; il est substance pleinement actuelle
de l'amour absolu, qui est de ce fait entièrement « relatif », ne vivant que
dans les relations réciproques. Nous avons déjà dit que ce n'est pas
l'autarcie repliée sur elle-même qui est divine. Et nous avons découvert que
ce qui est révolutionnaire dans la vision chrétienne du monde et de Dieu,
par rapport à l'antiquité, c'est qu'elle nous invite à comprendre l'«
Absolu» comme « relativité » absolue, comme « relation subsistante ».
Revenons à notre sujet. L'amour crée l'immortalité et
l'immortalité procède uniquement de l'amour. Cette vérité, à laquelle nous
sommes parvenus, signifie ensuite également que celui qui a aimé pour tous a
fondé aussi l'immortalité pour tous. C'est là le sens
exact de l'affirmation biblique selon laquelle sa résurrection est
notre vie.
L'argumentation de Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, qui à
première vue nous paraît étrange, devient alors compréhensible : s'il est
ressuscité, nous aussi nous le sommes, car alors l'amour est plus fort que
la mort ; s'il n'est pas ressuscité, nous ne le sommes pas non plus, car
alors c'est la mort qui a le dernier mot, alors rien n'est changé (comp.
1 Co 15, 16 s). Comme il s'agit ici d'une affirmation centrale,
exprimons-la encore d'une autre manière : ou bien l'amour est plus fort que
la mort, ou il ne l'est pas. S'il l'est devenu dans le Christ, c'est
justement en tant qu'amour pour les autres. Cela implique évidemment que
notre propre amour, abandonné à lui-même, ne suffit pas pour vaincre la mort
; pris en lui-même, il restera nécessairement un appel non réalisé.
Seul son amour, uni à la puissance d'amour et de vie
de Dieu même, peut fonder notre immortalité. Cependant il reste vrai que la
manière de notre immortalité dépend de notre manière d'aimer.
Nous aurons à y revenir, lorsque nous parlerons du jugement.
Ces réflexions nous ouvrent encore une autre perspective.
Elles nous permettent de comprendre aisément que la vie du Ressuscité n'est
plus bios, la forme bio-logique de notre vie mortelle à l'intérieur
de l'histoire ; elle est Zoé, vie
nouvelle, autre, définitive ; une vie qui a dépassé la sphère de mort de
l'histoire du bios, cette sphère de mort ayant été surmontée ici par une
puissance plus grande. Les récits de la résurrection dans le Nouveau
Testament font d'ailleurs apparaître très clairement que la vie du
Ressuscité ne se déroule plus à l'intérieur de l'histoire du bios, mais en
dehors et plus haut. Il est vrai que cette vie nouvelle a été attestée
dans l'histoire et devait l'être, puisqu'elle est là
pour elle et que la prédication
chrétienne consiste essentiellement à transmettre ce témoignage que l'amour
a triomphé de la mort et transformé ainsi radicalement notre situation à
tous. A partir de là, nous pouvons sans trop de peine trouver l' «
herméneutique » appropriée pour l'exégèse difficile des textes bibliques de
la résurrection, c'est-à-dire trouver dans quel sens il faut les comprendre
pour respecter leur signification. Nous ne pouvons évidemment pas discuter
ici, en détail, les différents problèmes, qui apparaissent aujourd'hui plus
difficiles que jamais, car l'on mélange de façon toujours plus inextricable
des affirmations historiques et philosophiques - celles-ci la plupart du
temps insuffisamment réfléchies - et l'exégèse se forge très souvent sa
propre philosophie, présentée au profane comme la quintessence du donné
biblique. Dans les détails, beaucoup de choses resteront toujours
discutables, mais l'on peut parfaitement reconnaître la limite fondamentale
qui sépare une explication comme telle, et une adaptation arbitraire.
Tout d'abord, il est parfaitement clair que le Christ, après
sa résurrection, n'a pas repris sa vie terrestre antérieure, comme il est
affirmé par exemple du jeune homme de Naïm et de Lazare. Le Christ est
ressuscité à la vie définitive, qui n'est plus liée aux lois chimiques et
biologiques, et qui pour cette raison est soustraite à l'emprise de la mort
; il est entré dans l'éternité que donne l'amour. Voilà pourquoi les
rencontres avec lui sont des « apparitions »; voilà pourquoi ses meilleurs
amis ne reconnaissent plus celui avec qui ils étaient à table deux jours
auparavant; et même une fois reconnu, il demeure étranger : là seulement où
lui, il donne de voir, il est vu ; là seulement où lui, il ouvre les yeux et
où le cœur se laisse ouvrir, il devient possible de reconnaître, au milieu
de notre monde de mort, le visage de l'amour éternel qui triomphe de la mort
et dans cet amour, le monde nouveau, autre, le monde de celui qui vient.
Voilà pourquoi aussi il est difficile, voire impossible, aux Évangélistes,
de décrire les rencontres avec le Ressuscité ; ils ne font plus que
balbutier lorsqu'ils en parlent, et ils semblent se contredire lorsqu'ils
les décrivent. En fait, ils se rejoignent de façon étonnante dans la
dialectique de leurs affirmations : on le touche et en même temps on ne le
touche pas, on le reconnaît et on ne le reconnaît pas, il y a pleine
identité entre le Crucifié et le Ressuscité et en même temps transformation
totale ; il est le même et pourtant il est tout autre. Cette dialectique
reste toujours la même ; ce qui change, ce sont les procédés de style qui
servent à l'exprimer. Prenons par exemple l'histoire des disciples d'Emmaüs,
déjà évoquée brièvement plus haut. Au premier abord, on a l'impression de se
trouver en face d'une représentation lourdement terrestre de la
résurrection, comme si rien ne restait du caractère mystérieux et indicible
que nous trouvons dans les récits de Paul. Il semblerait que la tendance au
pittoresque, à la narration concrète et légendaire, appuyée par une
apologétique visant au tangible, ait pris complètement le dessus et ramené à
nouveau le Seigneur ressuscité totalement à l'intérieur de l'histoire
terrestre. Mais cela est contredit d'abord par sa mystérieuse apparition et
ensuite par sa disparition non moins mystérieuse. Cela est contredit plus
encore par le fait que même dans ce récit il demeure inconnaissable pour
l'œil purement humain. On ne peut l'identifier comme au temps de sa vie
terrestre ; on ne le découvre que dans la sphère de la foi; en expliquant
l'Écriture, il rend brûlant le cœur des deux voyageurs, et en rompant le
pain, il leur ouvre les yeux. Il y a là une allusion aux deux éléments
fondamentaux du culte chrétien primitif, qui se compose de la liturgie de la
parole (lecture et explication de l'Écriture) et de la fraction du pain
eucharistique. L'évangéliste laisse ainsi entendre que la rencontre avec le
Ressuscité se situe sur un plan tout à fait nouveau ;
c'est avec le symbole des réalités
liturgiques qu'il essaye de décrire ce qui ne peut l'être. Par là, il nous
donne à la fois une théologie de la résurrection et une théologie de la
liturgie : on rencontre le Ressuscité dans la
parole et dans les sacrements; le culte est la manière dont il devient
tangible pour nous, et reconnaissable comme le Vivant.
Et inversement : la liturgie est fondée sur le mystère pascal ; elle est à
comprendre comme la venue à nous du Seigneur, qui devient ainsi notre
compagnon de route, qui rend brûlant notre cœur endurci et ouvre nos yeux
voilés. Il marche encore toujours avec nous, il nous trouve encore toujours
inquiets et découragés, il a encore toujours le pouvoir de nous rendre
voyants. Mais avec tout cela
nous n'avons encore dit que la moitié ; le témoignage néo-testamentaire
serait faussé, si on voulait s'en tenir uniquement à cela. L'expérience du
Ressuscité est tout autre chose que la simple rencontre avec un homme
appartenant à notre histoire ; il ne faudrait surtout pas la réduire à des
conversations de table et à des souvenirs, qui auraient finalement donné
consistance à l'idée qu'il était vivant et que sa cause continuait. Une
telle explication ramène l'événement à un niveau simplement humain et le
vide de l'essentiel. Les récits de la résurrection sont autre chose et bien
plus que des scènes liturgiques travesties :
ils manifestent l'événement fondamental sur lequel repose toute la liturgie
chrétienne. Ils attestent un événement qui n'a pas pris naissance dans le
cœur des disciples, qui s'est présenté au contraire à eux du dehors, et les
a convaincus malgré leur doute : le Seigneur est vraiment
ressuscité. Celui qui était dans la tombe n'y est plus, il vit - lui-même
réellement. Lui qui était passé dans l'autre monde, dans le monde de Dieu,
s'est montré cependant assez puissant pour leur prouver de façon tangible
qu'il était lui-même à nouveau présent en face d'eux, qu'en lui la puissance
de l'amour s'était avérée plus forte que la puissance de la mort.
Pour rester fidèle au témoignage du Nouveau Testament,
il faut prendre ce deuxième aspect autant au sérieux que le premier. C'est
aussi la seule manière de sauvegarder l'importance de ce témoignage dans
l'histoire du monde. La tentative trop commode, qui voudrait d'une part
faire l'économie de la foi au mystère de l'action puissante de Dieu dans ce
monde, et avoir cependant en même temps la satisfaction de demeurer sur le
terrain du message biblique, est une tentative vaine : elle ne satisfait ni
à l'honnêteté intellectuelle ni à l'exigence de la foi. On ne peut avoir en
même temps la foi chrétienne et « la religion à l'intérieur des limites de
la raison pure » ; il faut choisir. Il
est vrai que le croyant découvrira toujours davantage combien est sensée la
foi en cet amour qui a vaincu la mort.
A SUIVRE :
EST MONTÉ AUX CIEUX, EST ASSIS A LA DROITE DE DIEU, LE PÈRE TOUT-PUISSANT
►

►

|
Les
lecteurs qui désirent consulter les derniers articles publiés par le
site
Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent cliquer
sur le lien suivant
► E.S.M.
sur Google actualité |
Sources :Texte original des écrits du Saint Père Benoit XVI -
E.S.M.
Ce document est destiné à l'information; il ne
constitue pas un document officiel
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 18.03.2023
|