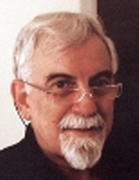 |
Le projet proposé par Benoît XVI
|
ROME, le 30 septembre 2006 -
(E.S.M.) - Ce n’est point un défi politique qu’a lancé Benoît
XVI, et pas davantage une provocation gratuite. C’est une réflexion
sérieuse et fraternelle, qui, accueillie avec calme et sérénité,
peut nous aider à voir plus clair dans les causes de notre
enlisement.
|
|
Le père Samir Khalil Samir, professeur d’islamologie et de la pensée arabe à
l’Université Saint-Joseph (Beyrouth)
Le projet
proposé par Benoît XVI
Il se passe quelque chose d’absurde dans le monde.
Absurde et effarant. Une personne respectée de tout le monde, d’une
profondeur intellectuelle et spirituelle incontestée, Père spirituel de plus
d’un milliard d’hommes et de femmes, mis sur le banc des accusés, abaissé,
insulté, son effigie brûlée pour avoir tenu une conférence magistrale dans
son ancienne université sur le rapport entre foi et raison. Pareil
déferlement de haine et de violence n’est pas digne de la religion de paix
que veut être l’islam.
Mais le plus effarant, c’est que ceux qui
s’acharnent le plus contre lui sont ceux qui n’ont pas la moindre idée de ce
qu’il a dit ou fait, qui n’ont pas lu sa conférence objet de tous les maux.
Ils se sont contentés de lire (ou d’entendre rapporter) deux ou trois
phrases, extraites hors de leur contexte. Et le comble du tragique, c’est
qu’ils protestent parce qu’un auteur du XIVe siècle accuse leur fondateur
d’avoir donné licence à ses adeptes d’user de violence pour amener les gens
à sa religion. Ils protestent d’être non-violents
par des actes de violence.
Face à
cette violence, l’homme de Dieu a dit combien il souffrait d’avoir donné à
ces foules motif de souffrance !
Tout cela ne serait pas
grave si ces personnes n’étaient pas nos frères, et nos frères les plus
proches ! Comment ne pas souffrir avec eux de leur propre souffrance, de
leur propre rage ! Comment ne pas souffrir avec les millions de musulmans
sincères et authentiques qui assistent à cette auto-destruction. Car, en
vérité, à qui profitent ces manifestations ? uniquement aux ennemis du monde
musulman. Une fois de plus, comme si l’affaire des caricatures ne suffisait
pas, le monde musulman a donné au monde la preuve
qu’il ne peut réagir avec calme et raison, lui qui affirme et répète
que l’islam est « la religion de la raison », à la différence du
christianisme si chargé de « mystères » incompréhensibles et déraisonnables
!
Est-ce là un acte de foi, ou un acte de raison ? Car tel est bien
l’objet de la conférence magistrale que Benoît XVI a prononcée dans son
ancienne université de Regensburg. Il s’agissait là d’une réflexion sur le
rapport de l’Occident à la religion en général, et en particulier avec
l’islam. Le pape Benoît XVI constate que l’Occident se ferme toujours plus à
la dimension religieuse, alors que les trois-quarts de l’humanité vivent de
cette dimension religieuse. Il propose une critique de la raison
occidentale, de la raison positiviste, faite de l’intérieur. Une critique
qui ne rejette rien des acquis de la Renaissance et de l’Illuminisme (
Aufklärung), mais qui en rejette les excès. Ce faisant, l’Occident est en
passe de se fermer à toute la dimension religieuse qui anime d’immenses
peuples, dont les musulmans et les chrétiens africains, asiatiques ou
orientaux. Il critique cette raison séculariste qui
étouffe l’Esprit.
Ce faisant, le Père des chrétiens
prépare le terrain à tous ceux qui croient à la dimension surnaturelle et
aspirent à une vie surnaturelle, à tous ceux qui ne veulent pas être
impitoyablement réduits à être des animaux rationnels mais non spirituels,
comme si l’on pouvait séparer les deux, comme si le concept de logikos (nâtiq)
ne signifiait pas, dans la pensée grecque comme dans la pensée arabe, à la
fois l’un et l’autre !
Le christianisme a eu la chance d’être
enraciné, dès le départ, dès le Nouveau Testament, dans la culture grecque,
et d’avoir ses racines profondes dans la tradition biblique. Il a eu la
chance de pouvoir puiser à la fois dans la rationalité grecque et dans la
spiritualité biblique. Le monde musulman au Moyen-Age, entre le IXe et le
XIIe siècles, a eu également la chance de vivre la même réalité, en
plongeant ses racines dans la spiritualité coranique et la soumission
religieuse à Dieu, et en puisant à larges mains dans la rationalité grecque
grâce aux chrétiens syriaques qui vivaient en son sein et lui ont transmis
tout ce patrimoine.
Mais tandis que le monde musulman a pratiquement
perdu le lien avec sa grande tradition médiévale, qui avait donné naissance
à cette extraordinaire floraison que l’on a appelée ’la Renaissance
abbasside’, laissant le religieux dominer totalement le rationnel jusqu’à
aboutir au XIVe-XVe siècles à ce que l’on a appelé ’la Décadence’ (’asr
al-inhitât), le monde chrétien en Occident a poursuivi son parcours
cherchant à maintenir sans cesse ce lien indissociable entre foi et raison,
jusque ce que la bourrasque du XIX e siècle n’ait initié cette lente
décadence spirituelle.
Notre monde arabo-musulman n’a qu’un désir :
faire vivre en harmonie la foi musulmane authentique dans une modernité
ouverte au spirituel. Mais cette modernité se présente à nous comme étant un
Occident dur et sec, possédant une intelligence supérieure vidée de son âme.
Cette modernité-là nous n’en voulons pas et avec raison ! Et alors, la
tentation est forte de se réfugier dans le religieux, dans le religieux
privé de tout esprit critique, d’autant plus a-critique que l’Occident a
fait de la critique son cheval de bataille. Même la liberté, ce don
magnifique de Dieu à l’Homme, est parfois dénaturée, et peut facilement
devenir « un prétexte pour la chair », comme le dit saint Paul dans sa
magnifique épître aux Galates (5,13). Alors nous nous sommes détournés aussi
de la liberté. Sans raison critique, sans liberté, que nous reste-t-il
encore d’humain ?
C’est pour offrir une issue à cette impasse que
Benoît XVI a tenu ce discours étonnant. Il critique cette culture
occidentale dans ce qu’elle a de néfaste et de mortifère, pour l’ouvrir à l’Esprit.
Il critique aussi notre civilisation musulmane dans ce qu’elle a de trop
fondamentaliste et d’acritique, qui peut conduire à la violence, dans ce
qu’elle a de manque de liberté. Mais cette critique n’est pas là pour
écraser l’autre ; elle se fait discrètement, dans un débat courtois, qui
évoque les Majâlis de Baghdad, où chacun exposait librement ses opinions,
pourvu qu’elles soient basées sur la raison, le ’aql (on pense à la
magnifique description qu’en donne au Xe siècle cet andalou choqué qu’est
Humaydi).
Ce n’est point un défi politique
qu’a lancé Benoît XVI, et pas davantage une provocation gratuite. C’est une
réflexion sérieuse et fraternelle, qui, accueillie avec calme et sérénité,
peut nous aider à voir plus clair dans les causes de notre enlisement.
N’est-il pas vrai que nous souffrons du manque de liberté dans nos pays ?
N’est-il pas vrai que nous souffrons du manque de respect de la personne et
de la dignité humaines ? N’est-il pas vrai que nous souffrons de la violence
que déchaînent certains des nôtres et qui nous éclabousse tous ?
Sous
certains aspects ce discours s’applique autant à nos frères juifs comme à
nos frères chrétiens. Jusques à quand allons-nous régler nos problèmes
internationaux par la guerre et la violence ? N’est-ce pas assez de deux
générations humiliées en cette Terre sainte qui est de tous ? La violence
peut-elle se rattacher de quelque manière à Dieu, alors qu’elle est
irrationnelle, comme le disait Manuel Paléologue ? alors qu’elle nous
déshumanise ?
Il y a, dans le discours de
Benoît XVI, un projet de dialogue planétaire, d’un dialogue entre
toutes les cultures et les civilisations, entre toutes les religions et les
formes variées d’athéisme. Un projet qui ne peut être basé sur une religion
(quelle qu’elle soit), ni sur une culture, mais sur la Raison et l’Esprit en
tant que c’est ce qui distingue l’Homme des autres animaux. Je pense à ce
merveilleux traité d’éthique du Xe siècle, le Tahdhîb al-Akhlâq de Yahyâ ben
’Adi, qui s’ouvre par cette phrase : « Sache que ce qui distingue l’homme de
tous les animaux c’est la pensée et le discernement ( fikr wa-tamyîz) ».
La critique que fait Benoît XVI au monde
occidental, c’est pour que nous puissions trouver un espace de liberté à
l’intérieur, tout en gardant notre spécificité de croyant : «
Cette tentative (…) de critique de la raison moderne de l’intérieur,
n’inclut absolument pas l’idée que l’on doive retourner en arrière, avant le
siècle des Lumières, en rejetant les convictions de l’époque moderne. Ce qui
dans le développement moderne de l’esprit est considéré valable est reconnu
sans réserves : nous sommes tous reconnaissants pour les possibilités
grandioses qu’il a ouvertes à l’homme et pour les progrès dans le domaine
humain qui nous ont été donnés.(…). L’intention n’est donc pas un recul, une
critique négative ; il s’agit en revanche d’un élargissement de notre
concept de raison et de l’usage de celle-ci.
Car malgré toute la joie
éprouvée face aux possibilités de l’homme, nous voyons également les menaces
qui y apparaissent et nous devons nous demander comment nous pouvons les
dominer. Nous y réussissons seulement si la raison et la foi se retrouvent
unies d’une manière nouvelle, et si nous franchissons la limite
auto-décrétée par la raison à ce qui est vérifiable par l’expérience, si
nous ouvrons à nouveau à celle-ci toutes ses perspectives . Ce n’est
qu’ainsi que nous devenons également aptes à un véritable dialogue des
cultures et des religions, un dialogue dont nous avons un besoin urgent ».
Tel est le projet qui nous est proposé, un projet humaniste. Car Benoît
XVI est conscient des maux qui minent la société occidentale : « Dans le
monde occidental domine largement l’opinion que seule la raison positiviste
et les formes de philosophie qui en découlent sont universelles. Mais les
cultures profondément religieuses du monde voient précisément dans cette
exclusion du divin de l’universalité de la raison une attaque à leurs
convictions les plus intimes . Une raison qui reste sourde face au divin et
qui repousse la religion dans le domaine des sous-cultures, est incapable de
s’insérer dans le dialogue des cultures ».
N’est-ce pas un peu ce
projet que nous recherchons ? Certes, il y a eu maladresse de la part de ce
Père. Peut-être était-il tellement pris par la dimension académique de son
discours qu’il en oublia les retombées politiques possibles ? Peut-être ne
s’est-il pas encore fait à sa nouvelle fonction de pape, avec ce qu’elle
implique aussi de fonction politique ? Je pense qu’il a cependant quelque
chose à nous dire et qu’il serait raisonnable de lui laisser sa chance. Il
est sûr en tout cas, comme il l’a dit ce dimanche à l’Angelus, qu’il ne
voulait blesser personne. Et si quelqu’un s’est senti blessé, qu’il exerce
cette vertu du pardon, la plus noble de toutes, celle qui nous fait
semblable à Dieu notre Père, al-Rahmân al-Rahîm.
wa-s-salâmun ’alâ
man ittaba’a l-hudâ !
Le
père jésuite Samir Khalil Samir est professeur d’islamologie et de la pensée
arabe à l’Université Saint-Joseph (Beyrouth)
Sources: le père Samir Khalil Samir
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 30.09.2006 - BENOÎT XVI |