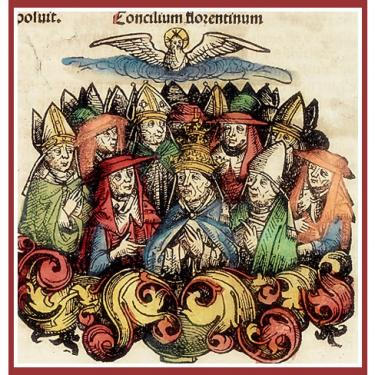 |
Benoît XVI : La genèse et la structure du symbole
des apôtres
|
Le 28 février 2023 -
(E.S.M.)
- A la vue des traces humaines du texte de la profession de
foi, on pourrait demander s'il est bien à propos de le prendre comme
fil conducteur pour une introduction aux vérités fondamentales de la
foi chrétienne. N'est-ce pas s'engager sur un terrain très équivoque
?
|
|
Le Concile de Florence -
Pour agrandir l'image
►
Cliquer
Benoît XVI :
LE VISAGE ECCLÉSIAL DE LA FOI
Si vous désirez lire la page précédente :
cliquez ici
REMARQUE PRÉLIMINAIRE SUR LA GENÈSE ET LA STRUCTURE DU SYMBOLE DES
APOTRES 16
Jusqu'à présent, nous en sommes restés à la question formelle de la foi en
général ; nous avons étudié son point d'insertion possible dans la pensée
moderne et son rôle. Les questions relatives à son contenu sont forcément
restées ouvertes et peut-être l'ensemble apparaît-il encore trop pâle et
trop imprécis. Pour trouver les réponses, il faudra analyser la foi
chrétienne dans sa forme concrète, que nous examinerons maintenant à l'aide
du Symbole des Apôtres, qui nous servira de fil conducteur. Il sera utile de
donner d'abord quelques dates concernant son origine et sa structure. Cela
permettra en même temps de souligner le bien-fondé de notre façon de
procéder. La structure générale de notre Symbole s'est constituée au cours
des IIe et IIIe siècles, en connexion avec la cérémonie du baptême. Pour ce
qui est de son origine géographique, nous sommes en présence d'un texte
romain. Quant au milieu vital, où il a pris naissance, il s'agit du culte et
plus précisément de la célébration du baptême. La forme fondamentale de ce
sacrement est
inspirée à son tour par les paroles de Jésus ressuscité, rapportées en Matthieu 28, 19 : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Trois
questions, conformément à ce texte, sont posées au néophyte : « Crois-tu en
Dieu, le Père tout-Puissant ? Crois-tu en Jésus-Christ, le Fils de Dieu... ?
Crois-tu au Saint-Esprit...17 ? » Le néophyte répond à chacune de ces trois
questions : « Je crois » et chaque fois on le plonge dans l'eau. La plus
ancienne forme du Symbole est constituée par un dialogue en trois parties,
avec question et réponse, intégré à la célébration du baptême.
Probablement dès le IIe, mais surtout au IIIe siècle, cette formule toute
simple, calquée sur le texte de Matthieu, reçoit des ajouts en sa partie
centrale, concernant le Christ. Il s'agissait de ce qui était spécifiquement
chrétien ; c'était le moment de dire en résumé, dans ce cadre, ce que le
Christ représente pour le chrétien. De même, la troisième partie, celle
relative au Saint-Esprit, au présent et à l'avenir de la réalité chrétienne,
fut explicitée et développée. Au IVe siècle, nous trouvons un texte continu,
débarrassé du schéma question-réponse. Le fait d'une rédaction encore en
langue grecque laisse supposer qu'il date du IIIe siècle, car au
IVe siècle à
Rome, le latin avait passé définitivement dans la liturgie. Une traduction
latine parut bientôt. En vertu de la position particulière dont l'Église de
Rome jouissait dans tout l'Occident, la profession de foi baptismale romaine
(appelée symbolum = symbole) se répandit rapidement dans tout le territoire
de langue latine. Cela entraîna encore une série de légères modifications du
texte. Finalement, Charlemagne imposa pour tout son empire un texte - sur la
base du vieux texte romain - qui avait reçu sa forme définitive en Gaule. Ce
texte fut adopté à Rome au IVe siècle. Dès le Ve siècle, peut-être déjà au
IVe, s'était créée la légende de l'origine apostolique du symbole, et
bientôt (probablement encore au Ve siècle) on en vint à attribuer à chacun
des Apôtres la composition de l'un des douze articles, que l'on distinguait
désormais dans l'ensemble du symbole.
Ce symbole romain resta inconnu en Orient. Grande fut la surprise des
représentants romains au concile de Florence (XVe siècle) lorsqu'ils apprirent des Grecs que ce fameux symbole, attribué
aux Apôtres, leur était inconnu. L'Orient en effet n'avait jamais élaboré un
symbole uniforme, pour la bonne raison que chez eux aucune Église
particulière ne jouissait d'une position comparable à celle de Rome en
Occident, comme siège apostolique unique en terre occidentale. L'Orient
resta toujours caractérisé par la pluralité des symboles, dont le genre
théologique s'écartait un peu du symbole romain. Le Credo romain (et par
suite le Credo occidental tout court) met davantage l'accent sur l'histoire
du salut, sur l'élément christologique. Il se concentre pour ainsi dire à
l'intérieur de la positivité de l'histoire chrétienne ; il accepte simplement
le fait de l'incarnation de Dieu pour notre salut, sans se préoccuper des
causes de cet événement, sans en chercher la connexion avec l'ensemble de
l'histoire. L'Orient, en revanche, a toujours essayé de comprendre la foi
chrétienne dans une perspective cosmo-métaphysique. On le voit dans les
différentes confessions de foi, où la christologie est toujours mise en
relation avec la doctrine de la création, en sorte que cet événement unique
de l'histoire et le fait permanent et universel de la création se trouvent
intimement liés. Plus tard, nous verrons comment cette vue élargie reçoit
aujourd'hui, grâce à l'impulsion des œuvres de Teilhard de Chardin, un écho
toujours croissant dans la conscience occidentale.
LIMITE ET IMPORTANCE DU TEXTE
Cette esquisse à gros traits de l'histoire du symbole appelle peut-être une
explication complémentaire. Car ce coup d'œil rapide sur la genèse du texte
fait apparaître toute la tension de l'histoire de l'Église du premier
millénaire, sa splendeur et sa misère. A mon avis, cet aspect a également
son importance pour la foi chrétienne elle-même, il découvre sa physionomie
spirituelle. D'abord, le symbole exprime par de-là toutes les divisions et
toutes les tensions, la foi commune en la Trinité. Il est la réponse à
l'appel de Jésus de Nazareth : « De toutes les nations faites des disciples
et baptisez-les ». En Lui, il reconnaît la proximité de Dieu et le
véritable avenir de l'homme. Mais il marque aussi les origines de la
division entre l'Orient et l'Occident; on y perçoit la position
privilégiée qui revient à Rome, en tant que chef-lieu de tradition
apostolique, et la tension qui en résulta pour l'Église tout entière.
Finalement ce texte reflète encore l'uniformisation de l'Église occidentale,
due à la politique, l'aliénation de la foi, utilisée comme moyen
d'unification de l'empire. A travers ce texte, proposé comme « romain » et
imposé de l'extérieur à Rome sous cette forme, nous découvrons toute la
détresse de la foi, acculée à la sauvegarde de son autonomie, au milieu des
intérêts de la politique. Le sort de ce texte nous montre à quel point la
réponse à l'appel venu de la Galilée a été mêlée, au cours de sa réalisation
historique, à toutes sortes de côtés humains, aux intérêts particuliers
d'une région, à des dissensions parmi les appelés à l'unité, aux intrigues
des puissants de ce monde. Il importe, à mon sens, d'en prendre conscience,
car cela aussi fait partie de la réalité de la foi dans le monde ; il importe
de constater que le saut audacieux, exigé par la foi, ne s'effectue que dans
les mesquineries humaines. Au moment même où il accomplit pour ainsi dire
son exploit le plus grandiose, le saut par-delà l'ombre de son être vers le
Sens qui le porte, à ce moment-là l'homme n'est pas pure grandeur et
noblesse ; là encore son action trahit les oppositions de son être,
misérable dans sa grandeur et cependant toujours grand dans sa misère. Ainsi
apparaît un aspect central de la foi : elle implique et doit impliquer le
pardon ; elle veut amener l'homme à reconnaître qu'il ne peut se réaliser
qu'en recevant le pardon et en l'accordant aux autres ; qu'il a besoin de ce
pardon, même pour ses actions les plus belles et les plus pures.
A la vue des traces humaines du texte de la profession
de foi, on pourrait demander s'il est bien à propos de le prendre comme fil
conducteur pour une introduction aux vérités fondamentales de la foi
chrétienne. N'est-ce pas s'engager sur un terrain très équivoque ? La question
doit se poser. Mais un examen approfondi fera voir que, en dépit de ses
avatars historiques, cette profession reste pour l'essentiel le fidèle écho
de la foi de l'Église primitive et représente fidèlement le noyau de la
Bonne Nouvelle. Les différences, relevées plus haut, entre l'Orient et
l'Occident ne sont que des différences d'une accentuation théologique et non
de profession de foi. En tout état de cause, dans cet essai
d'interprétation, nous centrerons sans cesse l'ensemble sur le Nouveau
Testament et l'expliquerons dans son optique.
CONFESSION DE FOI ET DOGME.
II nous reste encore à considérer un autre aspect. Dans ce texte, lié par
son origine au sacrement du baptême, nous trouvons l'amorce du sens de la «
doctrine », de la « confession de foi » dans le christianisme, du sens aussi
de ce qu'on appellera plus tard « dogme ». Le Credo, comme nous l'avons vu,
consistait en une triple réponse à une triple question, dans le cadre de la
célébration du baptême : « Crois-tu en Dieu, en Jésus-Christ, au
Saint-Esprit ? » Ajoutons maintenant qu'il représente l'affirmation
positive, opposée à la triple renonciation antérieure : « Je renonce à
Satan, à sa pompe, à ses œuvres18. »
Cela revient à dire que la foi est
essentiellement un acte de conversion, un retournement. Le croyant se
détourne de l'idolâtrie du visible et du technique, pour se tourner plein de
confiance vers l'invisible. Ce mot « Je crois » pourrait être rendu par «
Je
m'abandonne à..., je donne mon adhésion à...
19 ». De par son caractère de
profession de foi, de par son origine, la foi n'est pas une récitation de
leçons, ni une acceptation de théories relatives à des choses dont on ignore
tout mais que l'on professe avec d'autant plus d'assurance ; elle est
l'expression d'une mutation existentielle de l'homme. Dans le langage de
Heidegger, l'on pourrait dire qu'elle constitue un « tournant » (Kehre)
total, qui structure dès lors constamment l'existence de l'homme. Par la
triple renonciation et la triple affirmation, par la triple immersion,
symbolisation de la mort et de la résurrection à une vie nouvelle, est
manifestée clairement la signification de la foi : conversion, tournant de
l'existence, retournement de l'être.
Dans le processus de conversion qui caractérise la foi, le « Je » et le «
Nous », le « Je » et le « Tu » s'entrelacent de manière à exprimer toute une
image de l'homme. D'une part, cette conversion concerne au plus haut point
la personne, dont le caractère singulier et irremplaçable est traduit
clairement par le triple « Je crois » et le triple « Je renonce » : c'est
mon existence qui doit changer et se transformer. Mais à côté de cet élément
éminemment
personnel, se trouve également un autre élément : l'option du « Moi » se
présente sous la forme d'une réponse à une question ; elle s'exprime dans
l'alternance des formules : « Crois-tu ? » -« Je crois ». Cette forme
primitive du symbole, en questions et réponses, me paraît être une bien
meilleure expression de la structure de la foi que la forme collective
ultérieure, se réduisant à « Je ». Quand on essaye, en tâtonnant, de
découvrir l'essence de la foi chrétienne, il me semble que, par-delà les
textes doctrinaux postérieurs, on devrait voir dans cette forme primitive
dialoguée de la foi, son expression la plus pertinente, issue de sa nature
même. Cette forme est aussi bien plus adéquate que la forme du pluriel «
Nous » créée en Afrique chrétienne et dans les conciles orientaux20. Ce
nouveau type de confession de foi n'a plus de rapport avec le processus
sacramentel de conversion, de retournement de l'être, il n'est plus enraciné
dans le lieu d'origine de la foi. Né de la lutte des évêques réunis en
concile pour la défense de la vraie doctrine, il constitue le premier pas
vers la forme future du dogme. Il est heureux malgré tout que l'on n'ait pas
eu le souci déjà de formuler des dogmes dans ces conciles. La lutte pour la
vraie doctrine était une lutte pour l'intégrité de la confession de foi
ecclésiale, lutte par le fait même pour assurer la vraie nature de cette
conversion, de ce retournement de l'être que signifie l'existence
chrétienne.
Un exemple typique nous en est fourni par la fameuse querelle au
sujet de la question : « Qui est, qui était le Christ ? », querelle qui a
secoué l'Église aux IVe et Ve siècles. Dans ce débat, il ne s'agissait pas
de spéculations métaphysiques ; celles-ci n'auraient pas pu remuer aussi
profondément ces deux siècles, intéresser jusqu'aux plus simples. Le
problème était plutôt celui-ci : que m'arrivera-t-il personnellement si je
deviens chrétien, si je me mets sous l'obédience de ce Christ et si par là
j'affirme qu'il est le prototype de l'homme, la mesure de l'humain ? Quel
retournement de l'être s'opérera ainsi ? Quelle attitude à l'égard de la
réalité humaine ma démarche impliquera-t-elle, à quelle profondeur se
situera-t-elle et quel jugement sur l'ensemble comportera-t-elle ?
16. L'étude décisive en ce domaine reste encore toujours l'ouvrage classique
de F. KATTÏNBUSCH, Das apostolische Symbol, 1,1894, II, 1900 (édition
nouvelle inchangée, Darmstadt, 1962; citée dans la suite : KATTENBUSCH). -
Comme étude importante, il y a aussi J. DE GHELUNCK, Patristique et Moyen
Age, I, Paris, 1949; - de plus, l'aperçu général de J. N. D. KELLY, Early
Christian Creeds, London, 1950; - également W. TRILLHAAS, Das apostolische
Glaubensbekenntnits, Geschlchte, Text, Auslegung, Witten, 1953. - On pourra
trouver un bref résumé et d'autres indications bibliographiques dans les
Patrologies, telles que B. ALTANER, Précis de Patrologie, Mulhouse, 1961,
pp. 87 ss.; - J. QUASTEN, Initiation aux Pères de l'Église, I, Paris, 1955,
pp. 29-36; - cf. aussi J. N. D. KELLY, Apostolisches
Glaubensbekenntnits,
dans LTHK, I, pp. 760 ss.
17. Cf. par exemple le texte du Sacramentaire Gélasien (éd. Wilson), p. 86,
cité dans KATTENBUSCH, II, p. 485, et surtout le texte dans la Tradition
apostolique d'Hippolyte (éd. Botte), Munster, 1963, pp. 48 ss.
18. HIPPOLYTB, op. cit., p. 46 : Renuntio tlbi, Satana, et omni servitio tuo
et omnibus operibus tuis.
19. KATTENBUSCH, II, p. 503.
20. Cf. A. HAHN, Bibtiothek der Symbole und Glaubentregeln der alten Kirche,
1897; Nouvelle édition Hildesheim, 1962; - G. L. DOSETTI, // simboh di Nicea
et di Costantinopoli, Rome, 1967.
A suivre...
Un bon résumé :
Benoît XVI ouvre l'Année de la Foi : Homélie du Saint-Père
En savoir plus sur le Concile de Florence : Le concile de Florence et l'union des Églises - Diocèse de Paris
Pour en savoir plus :
Le concile de Florence et l'union des Églises - Diocèse de Paris
►

|
Les
lecteurs qui désirent consulter les derniers articles publiés par le
site
Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent cliquer
sur le lien suivant
► E.S.M.
sur Google actualité |
Sources :Texte original des écrits du Saint Père Benoit XVI -
E.S.M.
Ce document est destiné à l'information; il ne
constitue pas un document officiel
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 28.02.2023
|