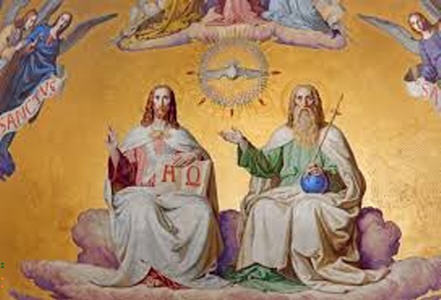 |
Benoît XVI : Dieu est toujours Père, Fils et
Esprit
|
Le 12 mars 2023 -
(E.S.M.)
- L'expression de filiation divine « physique » de Jésus est
tout à fait malheureuse et prête à malentendu ; elle prouve que la
théologie n'a pas encore réussi, en près de deux millénaires, à
libérer son langage conceptuel des moules de son origine
hellénistique.
|
|
Un seul Dieu -
Pour agrandir
l'image ►
Cliquer
THEOLOGIE
2. Le déploiement de la profession de foi au Christ
dans les articles christologiques
I.
« CONÇU DU SAINT-ESPRIT, NÉ DE LA VIERGE MARIE »
L'origine de Jésus est
entourée de mystère. Sans doute, les habitants de Jérusalem objectent à sa
messianité, dans l'évangile de Jean, le fait que l'on sait : « d'où il est ;
tandis que le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est »
(Jn 7, 27). Mais aussitôt après, les paroles de Jésus démontrent à quel
point leur prétendu savoir au sujet de son origine est insuffisant : « Je ne
suis pas venu de moi-même, mais il est véritable celui qui m'envoie, et vous
ne le connaissez pas » (7, 28). Assurément, Jésus est originaire de
Nazareth. Mais que savons-nous de sa véritable origine, même si nous
connaissons le lieu géographique d'où il est issu ? L'évangile de Jean
souligne sans cesse que la véritable origine de Jésus est «
le Père », il vient du Père d'une manière autre
et bien plus radicale que n'importe lequel des envoyés de Dieu avant lui.
Cette origine de Jésus dans le mystère de Dieu « que
personne ne connaît », les récits de l'Enfance, dans Matthieu et Luc, nous
la décrivent, non pas pour lever le mystère, mais pour l'attester comme tel.
Les deux évangélistes, surtout Luc, racontent les débuts de l'histoire de
Jésus presque entièrement en termes de l'Ancien Testament, afin de montrer
ainsi de l'intérieur que ces événements sont l'accomplissement de
l'espérance d'Israël, et pour les intégrer dans l'ensemble de l'histoire de
l'alliance de Dieu avec les hommes. Le mot par lequel, chez Luc, l'ange
salue la Vierge, s'apparente étroitement à la salutation du prophète
Sophonie, que celui-ci adresse à la Jérusalem sauvée des temps
eschatologiques(So 3, 14 ss); il reprend
également les paroles de bénédiction, par lesquelles on avait salué les
femmes célèbres d'Israël (Jg 5, 24; Jdt 13, 18). Marie
est ainsi désignée comme le saint reste d'Israël, comme la vraie Sion, vers
laquelle s'étaient tournées les espérances au milieu des malheurs de
l'histoire. Avec elle commence, d'après le texte de Luc, le nouvel Israël,
ou plutôt : il ne commence pas avec elle, mais elle l'est, elle, la «
fille de Sion », en qui Dieu établit un nouveau commencement
47
La promesse centrale n'est pas moins chargée de
réminiscences : « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du
Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi ce qui naîtra de toi
sera appelé saint : Fils de Dieu » (Lc 1, 35). Par-delà l'histoire de
l'Alliance d'Israël, le regard porte ici jusqu'à la création : l'Esprit de
Dieu est, dans l'Ancien Testament, la puissance créatrice de Dieu; c'est lui
qui, à l'origine, planait sur les eaux et changeait le chaos en cosmos
(Gn 1,2); lorsqu'il est envoyé, les êtres vivants sont créés (Ps 104
(103), 30). Ainsi ce qui doit arriver en Marie est une nouvelle création
: Dieu qui a appelé l'être du néant, établit au milieu de l'humanité un
nouveau commencement; sa Parole devient chair. L'autre image de notre texte
- la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre - évoque le Temple
d'Israël et la sainte Tente du désert, où Dieu manifestait sa présence par
la nuée, qui cache et révèle à la fois sa Gloire (Ex 40, 34; Jg 8,
11). De même qu'auparavant Marie était présentée comme le nouvel Israël,
comme la véritable « fille de Sion », elle apparaît maintenant comme le
Temple, sur lequel descend la nuée, dans laquelle Dieu pénètre au milieu de
l'histoire. Celui qui se met à la disposition de Dieu disparaît avec Lui
dans la nuée, dans l'oubli, dans l'insignifiance et devient par là-même
participant de sa gloire.
La naissance de Jésus à partir de
la Vierge, telle qu'elle nous est racontée dans les évangiles, a offusqué
depuis toujours les rationalistes de tous ordres. On cherchera à
minimiser le témoignage du Nouveau Testament par la distinction de
différentes couches littéraires, à le réduire au symbolique, en rappelant
l'absence de mentalité historique scientifique chez les anciens, on
cherchera à le faire entrer dans le cadre de l'histoire des religions, pour
le présenter comme la variante d'un mythe. Le mythe de
la naissance miraculeuse de l'enfant-sauveur est de fait très largement
répandu. Il exprime une nostalgie de l'humanité : la nostalgie de la
fraîcheur et de la pureté, personnifiées par la vierge intacte ; la
nostalgie d'une présence vraiment maternelle, rassurante, adulte, et pleine
de bonté; il exprime enfin l'espérance, qui reprend vie chaque fois que naît
un homme - l'espérance et la joie que représente un enfant. On peut sans
doute admettre comme vraisemblable qu'Israël aussi a connu des mythes de ce
genre ; le passage d'Is 7, 14 (« Voici qu'une vierge concevra... »)
pourrait bien être l'écho d'une telle attente, même si le texte lui-même
n'indique pas directement qu'il soit question ici d'une vierge au sens
strict.
48
Si l'on devait
comprendre le texte à partir de telles origines, cela voudrait dire que le
Nouveau Testament aurait repris par ce biais les aspirations obscures de
l'humanité vers la « vierge-mère »; quoi qu'il en soit, un tel archétype de
l'histoire humaine n'est sûrement pas sans signification.
Mais en
même temps, il est tout à fait clair que l'enracinement immédiat des récits
néo-testamentaires concernant la naissance de Jésus à partir de la Vierge
Marie, se trouve, non pas dans le domaine de
l'histoire des religions, mais dans l'Ancien Testament. Les récits
extrabibliques de cette espèce se distinguent très nettement, par leur
vocabulaire et leurs conceptions, de l'histoire de la naissance de Jésus. La
principale différence consiste en ce que, dans les récits païens, la
divinité apparaît presque toujours comme une puissance fécondante et
procréante, et donc sous un aspect plus ou moins sexuel; elle est ainsi «
père » de l'enfant-sauveur au sens physique. Rien
de tel, nous l'avons vu, dans le Nouveau Testament.
La conception de Jésus est une nouvelle création, et
non procréation par Dieu. Dieu ne devient pas le père de Jésus
au sens biologique; le Nouveau Testament ainsi que la théologie chrétienne
n'ont jamais vu dans ce récit, dans l'événement qui y est relaté, le
fondement de la véritable divinité de Jésus, de sa « filiation divine ». Car
celle-ci ne signifie pas que Jésus soit moitié Dieu, moitié homme; pour la
foi, il a toujours été fondamental que Jésus soit Dieu
tout entier et homme
tout entier. Sa divinité ne
signifie pas une diminution de son humanité : ce fut là le chemin suivi par
Arius et Apollinaire, les grands hérésiarques de l'Église ancienne. Contre
eux, l'Église défendit avec vigueur l'intégrité totale de l'être humain de
Jésus, et proscrivit ainsi toute transformation du récit évangélique en
mythe païen de procréation divine d'un demi-dieu. La filiation divine de
Jésus ne repose pas, d'après la foi de l'Église, sur le fait que Jésus n'a
pas eu de père humain; la doctrine de la divinité de Jésus ne serait pas
mise en cause, si Jésus était issu d'un mariage normal. Car la filiation
divine dont parle la foi n'est pas un fait biologique, mais ontologique;
elle n'est pas un événement dans le temps, elle se situe dans l'éternité de
Dieu : Dieu est toujours Père, Fils et Esprit ;
la conception de Jésus ne signifie pas la naissance d'un nouveau Dieu-fils,
elle signifie que Dieu comme Fils assume dans l'homme Jésus la créature
homme, de sorte qu'il « est » lui-même homme.
Tout cela n'est pas mis en cause par deux expressions,
qui pourraient facilement induire en erreur un non-initié. Ne dit-on
pas dans le récit de Luc, en liaison avec la promesse de la conception
miraculeuse, que l'enfant « sera appelé saint, Fils de Dieu » (Lc 1,
35) ? La filiation divine n'est-elle pas mise en relation ici avec la
naissance virginale et ne prend-on pas ainsi le chemin
du mythe ? Et pour ce qui est de la théologie
chrétienne, ne parle-t-elle pas continuellement de la filiation divine
« physique » de
Jésus, et ne dévoile-t-elle pas malgré tout par là son arrière-plan mythique
? Commençons par cette dernière façon de parler : sans
aucun doute, l'expression de filiation divine «
physique » de Jésus est tout à fait malheureuse
et prête à malentendu ; elle prouve que la théologie n'a pas encore réussi,
en près de deux millénaires, à libérer son langage conceptuel des moules de
son origine hellénistique. Le mot « physique » est pris ici dans le
sens du concept antique de la « physis », donc de la « nature » ou
mieux de 1" « essence ». Il signifie ce qui appartient à l'essence. La «
filiation physique » veut dire que Jésus est Fils de Dieu par son être et
pas seulement par sa conscience; le mot exprime ainsi l'opposition à l'idée
de la simple adoption de Jésus par Dieu. Il est clair que cet «
être-à-partir-de Dieu », évoqué par le mot « physique » n'est pas à entendre
au plan biologique de la génération, mais au plan de l'être divin et de son
éternité. Cela revient à dire qu'en Jésus, celui-là a pris la nature humaine
qui appartient « physiquement » (= réellement, au niveau de l'être), de
toute éternité, à la relation triple et une de l'amour divin.
Mais que dire, quand un chercheur aussi méritant que E.
Schweizer se prononce sur notre question de la manière suivante : « Comme
Luc ne s'intéresse pas au problème biologique, la limite en direction d'une
interprétation métaphysique n'est pas franchie chez lui
49
» ?
A peu près tout est faux dans cette phrase.
Ce qu'elle a de plus stupéfiant, c'est l'équivalence qu'elle établit
tacitement entre la biologie et la métaphysique. Selon toute apparence, la
filiation divine métaphysique (au niveau de l'être)
est interprétée faussement comme une descendance biologique, et de ce fait
totalement détournée de son vrai sens : car elle est au contraire,
comme nous l'avons vu, la négation expresse d'une conception biologique de
l'origine divine de Jésus. N'est-il pas triste qu'il
faille dire expressément que le plan de la métaphysique n'est pas celui delà
biologie. La doctrine chrétienne de la filiation divine de Jésus ne
se situe pas dans le prolongement de l'histoire de la naissance virginale,
mais dans le prolongement du dialogue « Abba-Fils
», de la relation de la parole et de l'amour que nous y avons
découverte. L'idée d'être de la théologie chrétienne n'appartient pas au
plan biologique, elle se rattache au « Je suis » de l'évangile de Jean, qui
déjà, nous l'avons noté, voit exprimée dans cette formule toute la
radicalité de l'idée de Fils, une radicalité qui comprend bien davantage et
qui porte bien plus loin que les idées biologiques du mythe du dieu-homme.
Nous avons déjà longuement réfléchi là-dessus; il fallait le rappeler ici,
car on a l'impression que l'aversion actuelle pour le message de la
naissance virginale et pour la reconnaissance plénière de la filiation
divine de Jésus repose sur une méconnaissance fondamentale des deux vérités,
et sur la fausse connexion que l'on semble établir communément entre les
deux.
Une question reste encore posée : quelle est la notion de
fils dans le récit lucanien de l'Annonciation ? La réponse à cette question
nous conduit en même temps à la vraie question qui se dégage des
considérations précédentes. Si la conception virginale de Jésus,
opérée par la puissance créatrice de Dieu, n'a
rien à voir, du moins immédiatement, avec sa filiation divine, quel sens
a-t-elle alors ? Ce que signifie le mot « fils de Dieu » dans le récit de
l'Annonciation peut être facilement déterminé à partir de nos considérations
antérieures : contrairement à la simple expression « le fils », il
appartient, comme nous l'avons vu, à la théologie de l'élection et de
l'espérance de l'Ancien Testament, et caractérise Jésus comme le véritable
héritier des promesses, comme le roi d'Israël et de l'univers. Or nous
découvrons là le contexte spirituel à partir duquel notre récit doit être
compris : l'espérance croyante d'Israël; celle-ci a sans doute été marquée
aussi, comme nous l'avons dit, par les espérances païennes, attendant des
naissances miraculeuses, mais elle a donné à ces espérances une forme
entièrement nouvelle et un sens tout à fait différent.
L'Ancien Testament connaît toute une série de naissances miraculeuses,
toujours aux tournants décisifs de l'histoire du salut : Sara, la mère
d'Isaac (Gn 18), la mère de Samuel (/ S1, 3) et la mère
anonyme de Samson (Jg 13) sont stériles ; tout espoir humain de
fécondité est exclu. Chez toutes les trois, la naissance de l'enfant, appelé
à être sauveur d'Israël, est l'effet d'une action
miséricordieuse de Dieu, qui rend possible l'impossible (Gn 18,
14; Lc 1, 37), qui élève les humbles (Is2,l;l, 11 ; Lc
1,52; 1,48), et qui renverse les puissants de leur trône (Lc1,
52). Chez Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, la même ligne continue
(Lc1, 7-25.36), pour atteindre en Marie son point culminant et son but.
Le sens de l'événement est chaque fois le même : le salut du monde ne vient
pas de l'homme et de sa propre force; il faut que l'homme se le laisse
offrir, il ne peut le recevoir que comme don gratuit. La naissance virginale
ne représente pas un chapitre d'ascétisme, et elle n'appartient pas non plus
directement à la doctrine de la filiation divine de Jésus; elle est avant
tout et en dernière analyse théologie de la grâce, message sur la manière
dont le salut vient à nous : dans la
simplicité de l'accueil, comme don absolument gratuit de l'amour qui rachète
le monde. Dans le livre d'Isaïe, cette idée du salut
qui ne peut venir que de la puissance de Dieu, est admirablement exprimée
: « Crie de joie et d'allégresse, toi qui n'a pas eu les douleurs ! Car plus
nombreux sont les fils de l'abandonnée que les fils de l'épouse, dit Jahvé »
(Is 54, 1 ; cf. Ga 4,21; Rm 4, 17-22).
En Jésus, Dieu a posé, au milieu de l'humanité stérile et désespérée, un
nouveau commencement, qui n'est pas produit de l'histoire de cette humanité,
mais don d'en-haut. Si chaque homme déjà constitue une nouveauté
ineffable, s'il représente plus que la somme des chromosomes et plus que le
produit d'un environnement déterminé : une créature de Dieu unique dans
l'histoire, Jésus, lui, est la nouveauté véritable ;
il ne procède pas du propre fonds de l'humanité, mais de l'Esprit de Dieu.
C'est pourquoi il est Nouvel Adam (7 Co 15, 47),
une nouvelle humanité commence avec lui. A
rencontre de tous les élus de Dieu avant lui, Jésus ne
reçoit pas seulement l'Esprit de Dieu, il
est, dans son existence humaine aussi,
uniquement grâce à l'Esprit, et à cause de cela il est
l'accomplissement de tous les prophètes :
le vrai Prophète.
A
vrai dire, l'on ne devrait pas avoir besoin de mentionner expressément que
toutes ces affirmations n'ont de sens que si l'événement, dont elles
s'efforcent de mettre en lumière la signification, a réellement eu lieu.
Elles sont l'interprétation d'un événement; si on le supprime, elles ne sont
que discours vides, dont il faudrait dire non seulement qu'ils ne sont pas
sérieux, mais qu'ils constituent un manque d'honnêteté. Du reste, de telles
tentatives, aussi bien intentionnées qu'elles puissent être parfois, sont
marquées d'une contradiction, que l'on pourrait presque dire tragique : à un
moment où nous avons découvert la corporalité de l'homme avec toutes les
fibres de notre existence, où nous ne pouvons plus concevoir l'esprit de
l'homme autrement que comme incarné, comme
étant-corps (Leib-Sein), non comme ayant
un corps (Leib-Haben), à ce même moment l'on essaye de
sauver la foi en la désincarnant totalement, en se réfugiant dans un domaine
de simple « signification », de pure interprétation se suffisant à
elle-même, et que seul le manque de réalité semble soustraire à la critique.
Or, en fait, la foi chrétienne confesse justement que Dieu n'est pas
prisonnier de son éternité, n'est pas limité à ce qui est purement
spirituel, qu'il peut au contraire agir ici, aujourd'hui, au milieu de mon
univers, et qu'il y a effectivement agi en Jésus, le nouvel Adam, qui est né
de la Vierge Marie par la puissance créatrice de Dieu, dont l'Esprit, au
commencement, planait sur les eaux et qui a créé l'être à partir du néant
50.
Il nous faut
encore faire une autre remarque. Si l'on comprend dans son vrai sens le
signe divin de la naissance virginale, on découvre en même temps quelle est,
théologiquement, la place d'une dévotion mariale qui se laisse guider par la
foi du Nouveau Testament. La dévotion mariale ne peut reposer sur une
mariologie qui serait une espèce de deuxième édition réduite de la
christologie; on n'a ni droit ni motif d'établir cette sorte de duplicata.
Si l'on voulait indiquer un traité de théologie, auquel appartiendrait la
mariologie et dont elle représenterait la forme concrétisée, ce serait
plutôt le traité de la grâce, qui forme d'ailleurs un tout avec
l'ecclésiologie et l'anthropologie. Comme vraie « fille de Sion », Marie est
figure de l'Église, figure de l'homme croyant qui ne peut arriver au salut
et à la réalisation plénière de lui-même que par le don de l'amour - par
grâce. Le mot par lequel Bernanos termine le Journal d'un curé de
campagne - « Tout est grâce » -, et dans
lequel une vie apparemment faible et inutile peut se reconnaître riche et
comblée, ce mot est devenu vraiment réalité en Marie, la « pleine de grâce »
(Lc 1, 28). Marie ne conteste ni ne met en péril 1' « exclusivité »
du salut par le Christ, elle y renvoie au contraire. Elle est la figure de
l'humanité qui est tout entière attente, et qui a d'autant plus besoin de
cette figure, qu'elle court davantage le danger de renoncer à l'attente,
pour se livrer à l'action; celle-ci - aussi indispensable qu'elle soit - ne
pourra jamais combler le vide qui menace l'homme s'il ne trouve pas cet
amour absolu qui lui donne un sens, qui lui apporte le salut,
qui lui fournit ce qui est vraiment le nécessaire vital.
Notes :
47. Cf.
R. Laurentin, Structure et théologie de Luc /-//, Paris, 1957; - L.
Deiss, Marie, fille de Sion, Paris, 1959; - A. STÖGER, Das
Evangelium nach Lukas l, Düsseldorf, 1964, pp. 38-42; - G. Voss,
Die Christologie der lukanischen Sckriften in Grundzügen.
Studio neotestamentaria,
II,
Paris-Bruges, 1965.
48. Cf.
W. Eichrodt, Théologie des AT, I, Leipzig,
1939, p. 257; « ... Ces traits... font conclure dans leur ensemble à une
image de sauveur bien connue du peuple, et dans laquelle ils trouvent leur
unité idéale. Cela est confirmé par la découverte d'une série d'affirmations
concordantes au sujet du roi-sauveur dans tout le monde du Proche-Orient, à
partir desquelles on pourrait presque constituer des scènes d'une biographie
sainte, ce qui montre qu'Israël participe ici largement au fonds oriental
commun.»
49. E.
schweizer, dans Theologisches Wörterbuch
zum NT,
VIII,
p. 384.
50. Il
faut opposer cela aux spéculations par lesquelles P. Schoonenberg essaye de
justifier la réticence du Catéchisme Hollandais sur ce point, dans son
article « De nieuwe Katechismus und die Dogmen ». Mais le point faible de
cette tentative, c'est
avant tout la
méconnaissance fondamentale du concept de dogme, sur laquelle elle repose;
Schoonenberg comprend le « dogme » dans la perspective étroite de la
dogmatique jésuite de la fin du xixe siècle et cherche évidemment
alors en vain une définition dogmatique du magistère, concernant la
naissance virginale, qui serait analogue à la définition dogmatique de 1' «
Immaculée Conception » ( - exemption du péché originel) et de 1' «
Assomption de Marie au ciel ». Il arrive ainsi à la conclusion que sur le
point de la naissance virginale de Jésus, contrairement aux deux autres
définitions, il n'existe pas d'enseignement ferme de l'Église. En réalité,
par une telle affirmation, l'histoire des dogmes se trouve mise sens dessus
dessous, et la forme du magistère introduite définitivement depuis Vatican
I est absolutisée d'une manière qui
n'est pas soutenable, non seulement du point de vue du dialogue avec les
Églises orientales, mais aussi tout simplement du point de vue de la réalité
elle-même; et d'ailleurs Schoonenberg ne maintient pas jusqu'au bout son
principe fondamental. En fait, le dogme en tant qu'énoncé isolé que le Pape
proclame ex cathedra représente la forme inférieure et la plus
récente de la constitution des dogmes. La forme originelle sous laquelle
l'Église affirme sa foi de façon impérative, c'est le Symbole; l'affirmation
non équivoque que Jésus est né de la Vierge appartient de façon ferme, dès
le début, à tous les symboles, et elle est donc partie intégrante du dogme
primitif. Chercher longuement, comme le fait Schoonenberg, jusqu'à quel
point nous sommes liés par Latran I
ou la Bulle de Paul IV
de 1555, est une entreprise sans objet; la tentative de
ramener
également les Symboles
à une explication purement « spirituelle » serait de la pure fantaisie au
point de vue de l'histoire des dogmes.
A suivre :
Justice et Grâce
Méditation :
Catéchèse de Benoît XVI : méditation sur le mystère de l'origine de Jésus
►

|
Les lecteurs qui
désirent consulter les derniers articles publiés par le site
Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent
cliquer sur le lien suivant
► E.S.M.
sur Google actualité |
Sources :Texte original des écrits du Saint Père Benoit
XVI -
E.S.M.
Ce document est destiné à l'information; il ne
constitue pas un document officiel
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 12.03.2023
|