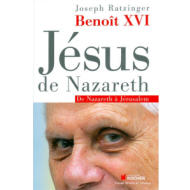 |
Extraits du livre de Joseph Ratzinger-Benoît XVI: Jésus de Nazareth
II
|
Le 02 mars 2011 -
(E.S.M.)
-
Le Saint-Siège a publié mercredi 2 mars les extraits du
nouveau livre de Joseph Ratzinger-Benoît XVI « Jésus de Nazareth, de
l'entrée à Jérusalem à la Résurrection», deuxième tome de l'étude du
pape sur la personne du Christ
|
|
Extraits du livre de Joseph Ratzinger-Benoît XVI: Jésus de Nazareth II
Le 02 mars 2011 - E.
S. M. - Le Saint-Siège a publié mercredi 2 mars les extraits
du nouveau livre de Joseph Ratzinger-Benoît XVI « Jésus de Nazareth, de
l'entrée à Jérusalem à la Résurrection», deuxième tome de l'étude du pape
sur la personne du Christ
Le mystère du traître
La péricope du lavement des pieds nous place devant deux manières
différentes par lesquelles l’homme réagit à ce don : Judas et Pierre. Tout
de suite après avoir évoqué l’exemple, Jésus commence à parler du cas de
Judas. Jean nous rapporte à cet égard que Jésus fut profondément troublé et
déclara : « En vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera »
(13,21).
Par trois fois Jean parle du « trouble » ou plutôt de l’« émotion » de Jésus
: devant le tombeau de Lazare (cf. 11,33.38) ; le « dimanche des Rameaux »,
après la parole sur le grain de blé qui meurt, dans une scène qui évoque de
près l’heure du Mont des Oliviers (cf. 12,24-27) ; et finalement ici. Il
s’agit de moments où Jésus se trouve face à la majesté de la mort et est
touché par le pouvoir des ténèbres – une puissance qu’il est de son devoir
de combattre et de vaincre. Nous reviendrons sur ce « trouble » de l’âme de
Jésus quand nous réfléchirons sur la nuit duMont des Oliviers.
Revenons à notre texte. L’annonce de la trahison suscite une agitation
compréhensible et en même temps, une certaine curiosité parmi les disciples.
« Un des disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre
Jésus. Simon Pierre lui fait signe et lui dit : “Demande quel est celui dont
il parle. ”Celui-ci, se penchant alors sur la poitrine de Jésus, lui dit :
“Seigneur, qui est-ce ?” Jésus répond : “C’est celui à qui je donnerai la
bouchée” » (13,23s.).
Pour comprendre ce texte, il faut avant tout tenir compte du fait que pour
le repas pascal il était prescrit de se tenir allongés à table. Charles K.
Barrett explique ainsi le verset que nous venons de citer. « Ceux qui
participaient à un repas étaient étendus sur leur côté gauche ; le bras
gauche servait à soutenir le corps ; le bras droit était libre pour se
mouvoir. Le disciple placé à droite de Jésus avait donc la tête
immédiatement devant Jésus,et l’on pouvait donc dire qu’il était placé près
de sa poitrine. Il était évidemment en mesure de parler de manière
confidentielle avec Jésus, mais sa place n’était pas la place d’honneur la
plus élevée ; celle-ci était à la gauche de celui qui recevait. La place
occupée par le disciple bien-aimé était néanmoins la place d’un ami intime »
; Barrett note dans ce contexte qu’il existe une description similaire chez
Pline (p. 437).
Telle qu’elle nous est rapportée ici, la réponse de Jésus est parfaitement
claire. Mais l’évangéliste nous fait savoir pourtant que les disciples ne
comprirent pas à qui il se référait. Nous pouvons donc supposer que Jean, en
repensant à cet événement, a donné à cette réponse une évidence que
celle-ci, sur le moment, n’avait pas pour ceux qui étaient présents. Le
verset 18 nous met sur la piste juste. Là, Jésus dit : « Il faut que
l’Écriture s’accomplisse : Celui qui mange mon pain, a levé contre moi son
talon » (cf. Ps 41,10 ; cf. Ps 55,14). C’est le style caractéristique de
Jésus quand il parle : en utilisant des paroles de l’Écriture, il fait
allusion à son destin, en l’insérant en même temps dans la logique de Dieu,
dans la logique de l’histoire du salut.
Par la suite, ces paroles deviennent parfaitement transparentes ; il
apparaît clairement que l’Écriture décrit vraiment son parcours – mais sur
le moment l’énigme demeure. Au prime abord, on en déduit simplement que
celui qui trahira Jésus est l’un des convives ; il devient évident que le
Seigneur doit subir jusqu’au bout et dans tous les détails le destin de
souffrance du juste, un destin qui apparaît de multiples manières surtout
dans les Psaumes. Jésus doit faire l’expérience de l’incompréhension, de
l’infidélité y compris à l’intérieur du cercle plus intime des amis et ainsi
« accomplir l’Écriture ». Il se révèle comme le vrai sujet des Psaumes,
comme le « David », de qui ils proviennent et par qui ils prennent sens.
En choisissant au lieu de l’expression employée dans la Bible grecque pour «
manger », le mot trogein par lequel Jésus, dans son grand discours sur le
pain indique l’acte de « manger » son Corps et son Sang, et donc la
réception du sacrement eucharistique (cf. Jn 6,54-58), Jean ajoute une
nouvelle dimension à la parole du Psaume reprise par Jésus comme prophétie
concernant son propre parcours. Ainsi, la parole du Psaume jette à l’avance
son ombre sur l’Église qui célèbre l’Eucharistie, au temps de l’Évangéliste,
comme dans tous les temps : avec la trahison de Judas, la souffrance pour la
déloyauté n’est pas finie. « Même le confident sur qui je faisais fond et
qui mangeait mon pain, se hausse à mes dépens » (Ps 41,10). La rupture de
l’amitié atteint jusqu’à la communauté sacramentelle de l’Église, où il y a
toujours de nouvelles personnes qui prennent « son pain » et le trahissent.
La souffrance de Jésus, son agonie, se prolonge jusqu’à la fin du monde, a
écrit Pascal à partir de ces réflexions (cf. Pensées VII 553). Nous pouvons
aussi l’exprimer du point de vue opposé : Jésus, en cette heure a pris sur
lui la trahison de tous les temps, la souffrance qui dérive en tout temps du
fait d’avoir été trahi, supportant ainsi jusqu’au bout les misères de
l’histoire.
Jean ne nous donne aucune interprétation psychologique de l’agir de Judas ;
l’unique point de repère qu’il nous offre est l’allusion au fait que Judas,
comme trésorier du groupe des disciples aurait soustrait leur argent (cf.
12,6). Quant au contexte qui nous intéresse, l’évangéliste dit seulement, de
manière laconique : « Après la bouchée, alors Satan entra en lui » (13,27).
Ce qui est arrivé à Judas, selon Jean, n’est plus psychologiquement
explicable. Il est tombé sous le pouvoir de quelqu’un d’autre : celui qui
brise l’amitié avec Jésus, celui qui se débarrasse de son « joug aisé »,
n’arrive pas à la liberté, il ne devient pas libre, mais il devient au
contraire l’esclave d’autres puissances – ou plutôt : le fait de trahir
cette amitié découle alors de l’intervention d’un autre pouvoir auquel on
s’est ouvert.
Et pourtant, la lumière qui, venant de Jésus, était tombée sur l’âme de
Judas, ne s’était pas éteinte complètement. Il y a un premier pas vers la
conversion : « J’ai péché », dit-il à ses commanditaires. Il essaie de
sauver Jésus et rend l’argent (cf. Mt 27,3s.). Tout ce qu’il avait reçu de
Jésus de pur et de grand, demeurait inscrit dans son âme – il ne pouvait pas
l’oublier.
Sa deuxième tragédie – après la trahison – est qu’il ne réussit plus à
croire à un pardon. Sa repentance devient désespoir. Il ne voit plus
désormais que lui-même et ses ténèbres, il ne voit plus la lumière de Jésus
– cette lumière qui peut illuminer et même outrepasser les ténèbres. Il nous
fait ainsi découvrir la forme erronée du repentir : un repentir qui n’arrive
plus à espérer, mais qui ne voit désormais que sa propre obscurité, est
destructeur et n’est donc pas un authentique repentir. La certitude de
l’espérance est inhérente au juste repentir – une certitude qui naît de la
foi dans la puissance supérieure de la Lumière qui s’est faite chair en
Jésus.
Jean conclut le passage sur Judas de manière dramatique avec ces mots : «
Aussitôt la bouchée prise, il sortit ; il faisait nuit » (13,30). Judas sort
– dans un sens plus profond. Il entre dans la nuit, il quitte la lumière
pour aller vers l’obscurité ; le « pouvoir des ténèbres » l’a saisi (cf. Jn
3,19 ; Lc 22,53).
La date de la dernière Cène
Le problème de la datation de la dernière Cène de Jésus se fonde sur
l’opposition en cette matière entre les Évangiles synoptiques, d’une part,
et l’Évangile de Jean, de l’autre. Marc, que Matthieu et Luc suivent
essentiellement, offre à ce sujet une datation précise. « Le premier jour
des Azymes, où l’on immolait la Pâque, ses disciples lui disent : “Où
veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque
?” [...] Le soir venu, il arrive avec les Douze » (Mc 14,12.17). Le soir du
premier jour des Azymes, où dans le Temple étaient immolés les agneaux
pascals, est la veille de la Pâque. Selon la chronologie des Synoptiques il
s’agit d’un jeudi.
Après le coucher du soleil commençait la Pâque, et alors la cène pascale
était consommée – par Jésus et ses disciples, comme par tous les pèlerins
venus à Jérusalem. Dans la nuit entre jeudi et vendredi – toujours selon la
chronologie synoptique – Jésus est arrêté et conduit devant le tribunal, au
matin du vendredi, chez Pilate, il est condamné à mort et ensuite « vers la
troisième heure » (neuf heures du matin) il est crucifié. La mort de Jésus
est datée de la neuvième heure (quinze heures). « Déjà le soir était venu et
comme c’était la Préparation, c’est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d’Arimathie…
s’en vint hardiment trouver Pilate et réclama le corps de Jésus » (Mc
15,42s.). La sépulture devait encore avoir lieu avant le coucher du soleil,
parce que ensuite commençait le sabbat. Le sabbat est le jour du repos de
Jésus au sépulcre. La Résurrection a lieu le matin du « premier jour de la
semaine », le dimanche.
Cette chronologie est compromise par le problème que le procès et la
crucifixion de Jésus auraient eu lieu au cours de la fête de la Pâque, qui
cette année-là tombait un vendredi. Il est vrai que beaucoup de chercheurs
ont tenté démontrer que le procès et la crucifixion étaient compatibles avec
les prescriptions de la Pâque. Malgré cette érudition, il semble
problématique qu’en cette fête très importante pour les Juifs, le procès
devant Pilate et la crucifixion aient été admissibles et possibles. Du
reste, une information rapportée par Marc fait aussi obstacle à cette
hypothèse. Il nous dit que deux jours avant la fête des Azymes, les grands
prêtres et les scribes cherchaient la manière de s’emparer de Jésus par ruse
pour le tuer, mais à ce sujet ils déclarent : « Pas en pleine fête, de peur
qu’il y ait du tumulte parmi le peuple » (14,1s.). Selon la chronologie
synoptique, cependant, l’exécution capitale de Jésus, de fait, aurait eu
lieu justement le jour même de la fête.
Tournons-nous maintenant vers la chronologie johannique. Jean veille avec
soin à ne pas présenter la dernière Cène comme une cène pascale. Au
contraire : les autorités juives qui mènent Jésus devant le tribunal de
Pilate évitent d’entrer dans le prétoire « pour ne pas se souiller, mais
pour pouvoir manger la Pâque » (18,28). La Pâque commence ensuite, seulement
le soir ; durant le procès, la cène pascale est encore à venir ; procès et
crucifixion ont lieu la veille de la Pâque, au cours de la « Préparation »,
et non au cours de la fête elle-même. Cette année-là, la Pâque s’étend donc
du soir du vendredi au soir du samedi et non du soir du jeudi au soir du
vendredi.
Pour le reste, le déroulement des événements demeure le même. Jeudi soir la
dernière Cène de Jésus avec ses disciples, qui cependant n’est pas une cène
pascale ; vendredi – veille de la fête et non la fête elle-même : le procès
et l’exécution capitale ; samedi : le repos du sépulcre ; dimanche : la
Résurrection. Avec cette chronologie, Jésus meurt au moment où, dans le
Temple, sont immolés les agneaux pascals. Il meurt comme le véritable Agneau
qui, parmi l’ensemble des agneaux, était le seul à avoir été annoncé par
avance.
Cette coïncidence, théologiquement importante, de la mort de Jésus au moment
de l’immolation des agneaux pascals, a conduit beaucoup de chercheurs à se
débarrasser de la version johannique considérée comme une chronologie
théologique. Jean aurait changé la chronologie pour créer cette connexion
théologique qui, toutefois, dans l’Évangile n’est pas manifestée
explicitement. Aujourd’hui, cependant, on voit toujours plus clairement que
la chronologie johannique est historiquement plus probable que celle des
Synoptiques. Car – comme il a été dit – procès et exécution capitale le jour
de la fête semblent peu imaginables. D’autre part, la dernière Cène de Jésus
apparaît si étroitement liée à la tradition de la Pâque que la négation de
son caractère pascal se révèle problématique.
Des tentatives de concilier les deux chronologies ont été faites pour cette
raison, depuis toujours. La tentative la plus importante – et, en de
nombreux points, la plus fascinante – d’arriver à une compatibilité entre
les deux traditions vient de la chercheuse française Annie Jaubert, qui,
depuis 1953, a développé sa thèse dans une série de publications. Nous
n’entrerons pas ici dans les détails de cette proposition ; nous nous
limiterons à l’essentiel.
Mme Jaubert se base surtout sur deux textes anciens qui semblent conduire à
une solution du problème. Il y a avant tout l’indication d’un ancien
calendrier sacerdotal, transmis dans le Livre des Jubilés, qui a été rédigé
en langue hébraïque dans la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C. Ce
calendrier ne prend pas en considération la révolution de la lune et prévoit
une année de trois cent soixante-quatre jours, divisée en quatre saisons de
trois mois, dont deux ont trente jours et un trente et un. Avec toujours
quatre-vingt-onze jours, chaque trimestre comprend exactement treize
semaines et chaque année ensuite exactement cinquante-deux semaines. Par
conséquent, les fêtes liturgiques de chaque année tombent toujours le même
jour de la semaine. Cela signifie, pour ce qui concerne la Pâque, que le 15
Nisan est toujours un mercredi et que le repas pascal est toujours consommé
après le coucher du soleil le soir du mardi. Jaubert soutient que Jésus
aurait célébré la Pâque selon ce calendrier, c’est-à-dire le mardi soir, et
il aurait été arrêté dans la nuit du mercredi.
Par là, la chercheuse voit résolus deux problèmes : d’une part, Jésus aurait
célébré un vrai repas pascal comme le rapportent les Synoptiques ; de
l’autre, Jean aurait raison en ce que les autorités juives, qui s’en
tenaient à leur calendrier, auraient célébré la Pâque seulement après le
procès de Jésus et donc celui-ci aurait été exécuté la veille de la
véritable Pâque et non au cours de la fête elle-même. De cette façon, la
tradition synoptique et la tradition johannique apparaissent également
justes sur la base de la diversité entre les deux calendriers.
Le deuxième avantage, souligné par Annie Jaubert, montre en même temps le
point faible de cette tentative de trouver une solution. La chercheuse
française fait remarquer que les chronologies transmises (dans les
Synoptiques et chez Jean) doivent mettre ensemble une série d’événements
dans l’espace étroit de quelques heures : l’interrogatoire devant le
sanhédrin, le transfert devant Pilate, le rêve de la femme de Pilate,
l’envoi chez Hérode, le retour chez Pilate, la flagellation, la condamnation
à mort, le chemin de Croix et la crucifixion. Placer tout cela dans le cadre
de quelques heures semble – selon Jaubert – quasi impossible. Par rapport à
cela sa solution offre un espace de temps qui va de la nuit entre mardi et
mercredi jusqu’au matin du vendredi.
Dans ce contexte, la chercheuse montre que chez Marc pour les jours «
dimanche des Rameaux », lundi et mardi, il y a une succession précise des
événements, mais qu’ensuite il passe directement au repas pascal. Selon la
datation transmise il resterait alors deux jours pour lesquels rien n’est
rapporté. Enfin, Jaubert rappelle que de cette façon le projet des autorités
juives de tuer Jésus, précisément avant la fête, aurait pu fonctionner.
Toutefois, Pilate, par son hésitation, aurait renvoyé la crucifixion au
vendredi.
Contre le changement de la date de la dernière Cène du jeudi au mardi
s’élève, cependant, l’antique tradition du jeudi, que d’ailleurs nous
rencontrons clairement dès le IIe siècle. Mais à cela Mme Jaubert objecte en
citant le second texte sur lequel se base sa thèse : il s’agit de la
Didascalie des Apôtres, un écrit du début du IIIe siècle, qui fixe la date
de la Cène de Jésus au mardi. La chercheuse veut démontrer que ce livre
aurait recueilli une vieille tradition, dont les traces pourraient être
retrouvées dans d’autres textes également.
À cela, il faut cependant répondre que les traces de la tradition,
manifestées de cette façon, sont trop faibles pour pouvoir convaincre.
L’autre difficulté vient du fait que l’utilisation par Jésus d’un calendrier
répandu principalement à Qumran, est peu vraisemblable. Pour les grandes
fêtes, Jésus se rendait au Temple. Même s’il en a prédit la fin et qu’il l’a
confirmée par un acte symbolique dramatique, il a suivi le calendrier juif
des festivités, comme le montre surtout l’Évangile de Jean. Certes, on peut
être d’accord avec la chercheuse française sur le fait que le Calendrier des
Jubilés n’était pas strictement limité à Qumran et aux Esséniens. Mais cela
ne suffit pas à le faire valoir pour la Pâque de Jésus. Ce qui explique
pourquoi la thèse, à première vue fascinante, d’Annie Jaubert est refusée
par la majorité des exégètes.
Je l’ai illustrée de façon aussi détaillée, parce qu’elle laisse imaginer un
peu plus la multiplicité et la complexité du monde juif au temps de Jésus –
un monde que nous-mêmes, malgré toute l’ampleur de nos connaissances des
sources, nous ne pouvons reconstituer que de façon insuffisante. Je
reconnaîtrais, donc, à cette thèse une certaine probabilité, bien que –
tenant compte des problèmes abordés– il ne soit simplement pas possible de
l’accueillir.
Que devons-nous donc dire ? J’ai trouvé l’évaluation la plus précise de
toutes les solutions imaginées jusqu’à maintenant dans le livre sur Jésus de
John P. Meier, qui a exposé une vaste étude sur la chronologie de la vie de
Jésus à la fin de son premier volume. Il arrive au résultat qu’il faut
choisir entre la chronologie synoptique et la chronologie johannique et il
montre, selon l’ensemble des sources, que la décision doit être en faveur de
Jean.
Jean a raison : au moment du procès de Jésus devant Pilate, les autorités
juives n’avaient pas encore mangé la Pâque et pour cela elles devaient se
maintenir encore cultuellement pures. Il a raison : la crucifixion n’a pas
eu lieu le jour de la fête, mais la veille. Cela signifie que Jésus est mort
à l’heure à laquelle les agneaux pascals étaient immolés dans le Temple. Que
par la suite les chrétiens aient vu en cela plus qu’un pur hasard, qu’ils
aient reconnu Jésus comme le véritable Agneau, qu’ainsi ils aient justement
trouvé le rite des agneaux porté à sa vraie signification – tout cela est
donc tout à fait normal.
Reste la question : mais alors pourquoi les Synoptiques ont-ils parlé d’un
repas pascal ? Sur quoi se fonde cette ligne de la tradition ? Meier ne peut
pas non plus donner une réponse vraiment convaincante à cette question. Il
en fait toutefois la tentative – comme beaucoup d’autres exégètes – au moyen
de la critique rédactionnelle et littéraire. Il cherche à montrer que les
passages de Mc 14,1a et 14,12-16 – les seuls passages où chez Marc on parle
de la Pâque – auraient été insérés par la suite. Dans le récit proprement
dit de la dernière Cène, la Pâque ne serait pas mentionnée.
Cette tentative – pour autant qu’elle soit soutenue par de nombreux experts
importants – est artificielle. Demeure juste, cependant, l’observation de
Meier quant au rituel pascal qui apparaît peu dans le récit de la Cène
elle-même chez les Synoptiques comme chez Jean. Avec cependant quelques
réserves, on pourra adhérer ainsi à l’affirmation : « Toute la tradition
johannique… concorde pleinement avec celle originaire des Synoptiques pour
ce qui concerne le caractère de la Cène comme n’appartenant pas à la Pâque »
(A Marginal Jew I, p. 398).
Mais alors, que fut vraiment la dernière Cène de Jésus ? Et comment est-on
arrivé à la conception certainement très ancienne de son caractère pascal ?
La réponse de Meier est étonnamment simple et convaincante sous de nombreux
aspects. Jésus était conscient de sa mort imminente. Il savait qu’il
n’aurait pas pu manger la Pâque. Dans cette claire conscience, il invita ses
disciples à une dernière Cène de caractère très particulier, une Cène qui
n’appartenait à aucun rite juif déterminé, mais qui était ses adieux, dans
lesquels il donnait quelque chose de nouveau, il se donnait lui-même comme
le véritable Agneau, instituant ainsi sa Pâque.
Dans tous les Évangiles synoptiques, la prophétie de Jésus sur sa mort et
celle sur sa Résurrection font partie de cette Cène. En Luc, elle a une
forme particulièrement solennelle et mystérieuse : « J’ai ardemment désiré
manger cette pâque avec vous avant de souffrir ; car je vous le dis, jamais
plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle s’accomplisse dans le royaume de
Dieu » (22,15s.). La parole demeure équivoque : elle peut signifier que
Jésus, pour la dernière fois, mange la Pâque habituelle avec les siens. Mais
elle peut aussi signifier qu’il ne la mange plus, mais qu’il s’achemine vers
la Pâque nouvelle.
Une chose est évidente dans toute la tradition : l’essentiel de cette Cène
de congé n’a pas été la Pâque ancienne, mais la nouveauté que Jésus a
réalisée dans ce contexte. Même si ce banquet de Jésus avec les Douze n’a
pas été un repas pascal selon les prescriptions rituelles du judaïsme, en
rétrospective la connexion intérieure de l’ensemble avec la mort et la
Résurrection de Jésus est apparue évidente : c’était la Pâque de Jésus. Et,
en ce sens, il a célébré la Pâque et il ne l’a pas célébrée : les rites
anciens ne pouvaient pas être pratiqués ; quand vint leur moment, Jésus
était déjà mort. Mais il s’était donné lui-même et ainsi il avait vraiment
célébré la Pâque avec eux. De cette façon, l’ancien rite n’avait pas été
nié, mais il avait seulement été porté ainsi à son sens plénier.
Le premier témoignage de cette vision unifiante du nouveau et de l’ancien,
que réalise la nouvelle interprétation de la Cène de Jésus par rapport à la
Pâque dans le contexte de sa mort et de sa Résurrection, se trouve chez
Paul, dans 1 Corinthiens 5,7 : « Purifiez-vous du vieux levain pour être une
pâte nouvelle, puisque vous êtes des azymes. Car notre Pâque, le Christ, a
été immolé ! » (cf. Meier, A Marginal Jew I, p. 429 s.). Comme en Marc 14,1,
le premier jour des Azymes et la Pâque se succèdent ici, mais le sens rituel
d’alors est transformé dans une signification christologique et
existentielle. Les « azymes » doivent maintenant être constitués par les
chrétiens eux-mêmes, libérés du levain du péché. L’Agneau immolé, cependant,
c’est le Christ. En cela Paul concorde parfaitement avec la description
johannique des événements. Pour lui, la mort et la Résurrection du Christ
sont devenues ainsi la Pâque qui perdure.
D’après cela, on peut comprendre comment la dernière Cène de Jésus, qui
n’était pas seulement une annonce, mais qui comprenait aussi, dans les dons
eucharistiques, une anticipation de la Croix et de la Résurrection, a bien
vite été considérée comme Pâque – comme sa Pâque. Et elle l’était
réellement.
Jésus devant Pilate
L’interrogatoire de Jésus devant le Sanhédrin s’était conclu comme Caïphe
s’y attendait : Jésus avait été déclaré coupable de blasphème, un crime pour
lequel était prévue la peine de mort. Mais comme le pouvoir d’infliger la
peine capitale était réservé aux Romains, le procès devait être transféré
devant Pilate et, par là, l’aspect politique de la sentence de culpabilité
devait apparaître au premier plan. Jésus s’était déclaré Messie, il avait
donc manifesté sa prétention à la dignité royale, même si c’était d’une
manière tout à fait particulière. La revendication de la royauté messianique
était un crime politique, qui devait être puni par la justice romaine. Avec
le chant du coq, le jour s’était levé. Le gouverneur romain avait coutume de
siéger pour rendre la justice dans les premières heures de la matinée.
Ainsi, Jésus est amené au prétoire par ses accusateurs et présenté à Pilate
comme un malfaiteur qui mérite la mort. C’est le jour de la « Parascève »
pour la fête de la Pâque : dans l’après-midi, les agneaux seront abattus
pour le banquet du soir. Pour cela, la pureté rituelle est nécessaire ; les
prêtres accusateurs ne peuvent donc pas entrer dans le prétoire païen et ils
traitent avec le gouverneur romain devant l’édifice. Jean, qui nous transmet
ce détail (cf. 18,28s.), laisse ainsi transparaître la contradiction entre
l’observance stricte des prescriptions cultuelles de pureté et le problème
de l’authentique pureté intérieure de l’homme : il ne vient pas à l’idée des
accusateurs que ce n’est pas le fait d’entrer dans la maison païenne qui est
source de souillure, mais le sentiment intime du cœur. En même temps, ce
faisant, l’Évangéliste souligne que le repas pascal n’a pas encore été
célébré et que l’abattage des agneaux doit encore être effectué.
Dans la description du déroulement du procès, les quatre Évangiles
concordent sur tous les points essentiels. Jean est le seul qui rapporte le
dialogue entre Jésus et Pilate, dans lequel la question concernant la
royauté de Jésus, le motif de sa mort, est sondée dans toute sa profondeur
(cf. 18,33-38). Le problème de la valeur historique de cette tradition est –
évidemment – l’objet discuté par les exégètes. Alors que Charles H. Dodd
avec Raymond E. Brown l’évaluent de manière positive, Charles K. Barrett
s’exprime à ce sujet de manière extrêmement critique : « Les intégrations et
les modifications de Jean ne suscitent pas la confiance sur sa fiabilité
historique » (op. cit., p. 511). Il va de soi que personne ne s’attend à ce
que Jean ait voulu présenter quelque chose comme un procès-verbal du procès.
Mais il est tout à fait permis de supposer qu’il est capable d’interpréter
avec une grande exactitude la question centrale dont il s’agissait et qu’il
nous place donc devant la vérité essentielle de ce procès. Ainsi, même
Barrett dit que « Jean, avec une extrême sagacité a trouvé la clé
d’interprétation pour l’histoire de la Passion dans la royauté de Jésus et
il a sans doute mis en valeur sa signification plus clairement que n’importe
quel autre auteur du Nouveau Testament » (p. 512).
Mais posons-nous avant tout cette question : qui étaient précisément les
accusateurs ? Qui a insisté pour que Jésus soit condamné à mort ? Dans les
réponses des Évangiles, il y a des différences sur lesquelles nous devons
réfléchir. Selon Jean, ce sont simplement les « Juifs ». Mais cette
expression chez Jean – comme le lecteur moderne serait tenté de
l’interpréter – n’indique en aucune manière le peuple d’Israël comme tel, et
elle a encore moins un caractère « raciste ». En définitive, Jean lui-même,
pour ce qui est de la nationalité, était un Israélite, tout comme Jésus et
tous les siens. La Communauté primitive tout entière était composée
d’Israélites. Chez Jean, cette expression a une signification précise et
rigoureusement limitée : il désigne par là l’aristocratie du Temple. Ainsi,
dans le quatrième Évangile, le cercle des accusateurs qui veulent la mort de
Jésus est décrit avec précision et il est clairement délimité : il s’agit,
justement, de l’aristocratie du Temple – mais non sans quelque exception,
comme nous le laisse deviner l’allusion à Nicodème (cf. 7,50s.).
En Marc, dans le contexte de l’amnistie pascale (Barabbas ou Jésus), le
cercle des accusateurs semble plus large : voici qu’apparaît l’ochlos qui
opte pour la relaxe de Barabbas. Tout d’abord, ochlos veut simplement dire
une quantité importante de personnes, la « masse ». Bien souvent le mot a un
accent négatif dans le sens de « plèbe ». En tout cas, par ce mot, ce n’est
pas « le peuple » des Juifs qui est désigné comme tel. À l’occasion de
l’amnistie pascale (que, en réalité, nous ne connaissons pas par d’autres
sources mais dont il n’y a pas de raison de douter), le peuple – comme cela
était d’usage pour d’autres amnisties – a le droit de faire une proposition
manifestée par « acclamation » : en ce cas, l’acclamation du peuple a un
caractère juridique (cf. Pesch Markusevangelium II, p. 466). En ce qui
concerne cette « masse », il s’agit en fait des défenseurs de Barabbas qui
se sont mobilisés pour l’amnistie ; en tant que rebelle d’une révolte contre
le pouvoir romain, il pouvait naturellement compter sur un certain nombre de
sympathisants. Les partisans de Barabbas étaient donc là, la « masse »,
tandis que ceux qui croyaient en Jésus, apeurés, restaient cachés ; c’est
ainsi que la voix du peuple sur qui le droit romain comptait était
représentée de manière unilatérale. En Marc donc, à côté des « Juifs »,
c’est-à-dire les cercles sacerdotaux qui font autorité, entre en jeu
effectivement l’ochlos, le groupe des partisans de Barabbas, mais pas le
peuple juif comme tel.
On trouve une amplification de l’ochlos de Marc, fatal dans ses
conséquences, en Matthieu (27,25), qui parle, lui, de « tout le peuple »,
lui attribuant la demande de la crucifixion de Jésus. Ce faisant, Matthieu à
coup sûr n’exprime pas un fait historique : comment le peuple tout entier
aurait-il pu être présent en un tel moment pour demander la mort de Jésus ?
La réalité historique apparaît d’une manière certainement correcte en Jean
et en Marc. Le vrai groupe des accusateurs est celui des cercles existant
dans le Temple et, dans le contexte de l’amnistie pascale, la « masse » des
partisans de Barabbas se joint à eux.
À cet égard, on peut sans doute donner raison à Joachim Gnilka, pour qui
Matthieu – dépassant les faits historiques – a voulu formuler une étiologie
théologique, qui lui permettait de s’expliquer le terrible destin d’Israël
dans la guerre judéo-romaine, dans laquelle le pays, la ville et le Temple
furent enlevés au peuple (cf. Matthäusevangelium II, p. 459). Dans ce
contexte, Matthieu pense peut-être aux paroles de Jésus quand il prédit la
fin du Temple : « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et
lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes
enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes…,
et vous n’avez pas voulu ! Voici que votre maison va vous être laissée
déserte… » (Mt 23,37s. ; cf. Gnilka, tout le paragraphe Gerichtsworte, p.
295-308).
À propos de ces paroles, il faut – comme nous l’avons montré dans la
réflexion sur le discours eschatologique de Jésus – rappeler l’analogie
profonde qui existe entre le message du prophète Jérémie et celui de Jésus.
Jérémie annonce – s’opposant à l’aveuglement des cercles dominants d’alors –
la destruction du Temple et l’exil d’Israël. Mais il parle aussi d’une «
nouvelle Alliance » : le dernier mot n’est pas le châtiment ; celui-ci est
au service de la guérison. De manière analogue, Jésus annonce la « maison
laissée déserte » et donne déjà à l’avance la Nouvelle Alliance « en son
sang » : en dernière analyse, il s’agit de guérison et non pas de
destruction ou de répudiation.
Si, selon Matthieu, « tout le peuple » avait dit : « Que son sang soit sur
nous et sur nos enfants ! » (27,25), le chrétien doit se souvenir que le
sang de Jésus parle un autre langage que celui d’Abel (cf. He 12,24) : il
n’exige ni vengeance ni punition, mais il est réconciliation. Il n’est pas
versé contre quelqu’un, mais c’est le sang répandu pour la multitude, pour
tous. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu… Dieu l’a exposé
[Jésus], comme instrument de propitiation par son propre sang », dit Paul (Rm
3,23.25). De même que c’est en fonction de la foi qu’il faut lire de manière
complètement neuve l’affirmation de Caïphe sur la nécessité de la mort de
Jésus, de même faut-il le faire à propos de la parole de Matthieu sur le
sang : lue dans la perspective de la foi, elle signifie que nous tous nous
avons besoin de la force purificatrice de l’amour, et cette force, c’est son
sang. Ce n’est pas une malédiction, mais une rédemption, un salut. C’est
seulement en fonction de la théologie de la dernière Cène et de la Croix
présente à travers tout le Nouveau Testament que la parole de Matthieu sur
le sang acquiert son sens correct.
Passons des accusateurs au juge : le gouverneur romain Ponce Pilate. Alors
que Flavius Josèphe et surtout Philon d’Alexandrie donnent de lui une image
tout à fait négative, il apparaît d’après d’autres témoignages comme résolu,
pragmatique et réaliste. On dit souvent que les Évangiles, en raison d’une
tendance favorable aux Romains pour des motifs politiques, l’auraient
présenté de manière toujours plus positive, en jetant progressivement sur
les Juifs la responsabilité de la mort de Jésus. En fait, il n’y avait
aucune raison qui permette de soutenir cette tendance dans la situation
historique des évangélistes. Lorsque les Évangiles furent rédigés, la
persécution de Néron avait déjà montré les aspects cruels de l’État romain
et tout l’arbitraire du pouvoir impérial. Si nous pouvons dater l’Apocalypse
plus ou moins à l’époque où fut composé l’Évangile de Jean, il apparaît
évident que le quatrième Évangile ne s’est pas formé dans un contexte qui
aurait permis un cadre « philo-romain ».
L’image de Pilate dans les Évangiles nous fait découvrir, de manière
réaliste, le préfet romain comme un homme qui savait intervenir brutalement,
si cela lui semblait opportun pour l’ordre public. Mais il savait aussi que
Rome devait sa domination sur le monde, en premier lieu, à sa tolérance
vis-à-vis des divinités étrangères et à la force pacificatrice du droit
romain. C’est ainsi qu’il se présente dans le procès à Jésus.
L’accusation selon laquelle Jésus se serait déclaré roi des Juifs était
grave. Il est vrai que Rome pouvait effectivement reconnaître des rois «
régionaux » – comme Hérode –, mais ceux-ci devaient être légitimés par Rome
et obtenir de Rome la description et la délimitation de leurs droits de
souveraineté. Un roi sans une telle légitimation était un rebelle qui
menaçait la pax romana et par conséquent, il se rendait passible de mort.
Mais Pilate savait que Jésus n’avait pas suscité un mouvement
révolutionnaire. D’après tout ce qu’il avait entendu dire, Jésus devait lui
être apparu comme un exalté religieux qui, peut-être, violait des
prescriptions judaïques concernant le droit et la foi, mais cela ne
l’intéressait pas. C’était aux Juifs eux-mêmes qu’il revenait de juger de
cela. Au regard des règlements romains concernant la juridiction et le
pouvoir, qui entraient dans ses compétences, il n’y avait rien de sérieux
contre Jésus.
Arrivés à ce point, il nous faut passer des considérations sur la personne
de Pilate au procès lui-même. Il est dit clairement en Jean 18,34s. que,
selon Pilate, à partir des informations qu’il possédait, il n’y avait rien
contre Jésus. L’autorité romaine n’avait reçu aucune information sur quoi
que ce soit qui aurait pu en quelque manière menacer la paix légale.
L’accusation provenait des concitoyens de Jésus eux-mêmes, des autorités du
Temple. Pilate devait être stupéfait de voir les concitoyens de Jésus se
présenter devant lui comme défenseurs de Rome, alors que ses propres
informations ne lui avaient pas donné l’impression qu’une intervention était
nécessaire.
Mais au cours de l’interrogatoire, voici à l’improviste un moment qui
soulève de l’agitation : la déclaration de Jésus. À la question de Pilate :
« Donc tu es roi ? », il répond : « Tu le dis : je suis roi. Je ne suis né,
et je ne suis venu dans le monde, que pour rendre témoignage à la vérité.
Quiconque est de la vérité écoute ma voix » (Jn 18,37). Auparavant déjà,
Jésus avait dit : « Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume était
de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux
Juifs. Mais mon royaume n’est pas d’ici » (Jn 18,36).
Cette « confession » de Jésus met Pilate dans une étrange situation :
l’accusé revendique royauté et règne (basileía). Mais elle souligne la
totale originalité de cette royauté, et cela en donnant la notion concrète
qui pour le juge romain devait être décisive : personne ne combat pour cette
royauté. Si le pouvoir, et précisément le pouvoir militaire, est la
caractéristique de la royauté et du royaume – il n’y a rien de cela en
Jésus. C’est pourquoi il n’y a même pas une menace contre les règlements
romains. Ce règne est non violent. Il n’a aucune légion à sa disposition.
Par ces paroles, Jésus a créé un concept absolument nouveau de royauté et de
règne devant lequel il met Pilate, le représentant du pouvoir terrestre
classique. Que peut penser Pilate, que devons-nous penser, nous, de ce
concept de royaume et de royauté ? Est-ce quelque chose d’irréel, un
fantasme dont on peut se désintéresser ? Ou bien, cela nous concerne-t-il de
quelque manière ?
À côté de la délimitation précise du concept de règne (personne ne combat,
impuissance terrestre), Jésus a introduit un concept positif, pour rendre
perceptible l’essence et le caractère particulier du pouvoir de cette
royauté : la vérité. Pilate, dans la suite de l’interrogatoire, a mis en jeu
un autre terme qui vient de son monde et qui normalement est relié au terme
« règne » : le pouvoir – l’autorité (exousía). La domination exige un
pouvoir, elle le définit même. Jésus, à l’inverse, qualifie l’essence de sa
royauté par le témoignage à la vérité. La vérité serait-elle donc une
catégorie politique ? Ou bien le « règne » de Jésus n’a-t-il rien à voir
avec la politique ? À quel genre alors appartient-il ? Si Jésus fait reposer
son concept de royauté et de règne sur la vérité comme catégorie
fondamentale, il est alors très compréhensible que le pragmatique Pilate
demande : « Qu’est-ce que la vérité ? » (18,38).
C’est la question que se pose aussi la doctrine moderne de l’État : est-ce
que la politique peut prendre la vérité comme catégorie pour sa structure ?
Ou bien faut-il laisser la vérité, comme dimension inaccessible, à la
subjectivité et s’efforcer au contraire de réussir à établir la paix et la
justice avec les instruments disponibles dans le domaine du pouvoir ? Étant
donné l’impossibilité d’un consensus sur la vérité et en s’appuyant sur
elle, la politique ne se fait-elle pas l’instrument de certaines traditions
qui, en réalité, ne sont que des formes de conservation du pouvoir ?
Mais, par ailleurs, que se passe-t-il si la vérité ne compte pour rien ?
Quelle justice alors sera possible ? Est-ce qu’il ne doit pas y avoir des
critères communs qui garantissent véritablement la justice pour tous –
critères soustraits à l’arbitraire des opinions changeantes et aux
concentrations du pouvoir ? N’est-il pas vrai que les grandes dictatures se
sont maintenues par la force du mensonge idéologique et que c’est la vérité
seule qui a pu apporter la libération ?
Qu’est-ce que la vérité ? La question de l’homme pragmatique, posée de
manière superficielle, non sans un certain scepticisme, est une question
grave, dans laquelle, de fait, est en jeu le destin de l’humanité. Qu’est-ce
donc que la vérité ? Pouvons-nous la connaître ? Peut-elle entrer, en tant
que critère, dans notre pensée et dans notre vouloir, aussi bien dans la vie
de chacun de nous que dans celle de la communauté ?
La définition classique, formulée par la philosophie scholastique qualifie
la vérité de adequatio intellectus et rei – adéquation entre l’intelligence
et la chose (Thomas d’Aquin, S. theol I q 21 a 2 c). Si la raison d’une
personne reflète une chose telle qu’elle est en elle-même, alors cette
personne a trouvé la vérité. Mais c’est seulement une petite part de ce qui
existe réellement – ce n’est pas la vérité dans toute son ampleur et sa
plénitude.
Avec une autre affirmation de saint Thomas nous nous approchons davantage
des intentions de Jésus : « La vérité est dans l’intelligence divine
proprement et premièrement (proprie et primo) ; dans l’intelligence humaine,
proprement mais secondairement (proprie quidem et secundario) » (De verit.
Q 1 a 4 c). Et cela nous fait arriver finalement à la formule lapidaire :
Dieu est « ipsa summa et prima veritas – lui-même la souveraine et première
vérité » (S. theol. I q 16 a 5 c).
Cette formule nous rapproche de ce que Jésus veut dire quand il parle de la
vérité, pour laquelle il est venu dans le monde afin d’en témoigner. Vérité
et opinion erronée, vérité et mensonge en ce monde sont continuellement
mêlés de manière inextricable. La vérité, dans toute sa grandeur et sa
pureté n’apparaît pas. Le monde est « vrai » dans la mesure où il reflète
Dieu, le sens de la création, la Raison éternelle d’où il a jailli. Et il
devient d’autant plus vrai qu’il s’approche davantage de Dieu. L’homme
devient vrai, devient lui-même s’il devient conforme à Dieu. Alors il
atteint sa vraie nature. Dieu est la réalité qui donne l’être et le sens.
« Rendre témoignage à la vérité » signifie mettre au premier plan Dieu et sa
volonté face aux intérêts du monde et à ses puissances. Dieu est la mesure
de l’être. En ce sens, la vérité est le « Roi » véritable qui donne à toutes
choses leur lumière et leur grandeur. Nous pouvons dire également que rendre
témoignage à la vérité signifie : en partant de Dieu, de la Raison
créatrice, rendre la création déchiffrable et sa vérité accessible de telle
manière qu’elle puisse constituer la mesure et le critère d’orientation dans
le monde de l’homme – que le pouvoir de la vérité, le droit commun, le droit
de la vérité puissent venir à la rencontre des grands et des puissants.
Disons même tranquillement : la non-rédemption du monde consiste,
précisément, dans le fait que la création n’est pas déchiffrable, que la
vérité n’est pas reconnaissable. Cette situation conduit alors
inévitablement à la domination du pragmatisme, et ainsi le pouvoir des forts
devient véritablement le dieu de ce monde.
En hommes modernes, nous serions tentés, à ce point, de dire : « La création
est devenue déchiffrable pour nous, grâce aux sciences. » C’est
effectivement ce que dit par exemple Francis S. Collins, qui a dirigé le
Human Genome Project, dans une joie admirative : « Le langage de Dieu a été
déchiffré » (The Language of God, p. 99). C’est vrai, nous percevons le
langage de Dieu dans la grandiose mathématique de la création qu’il nous est
possible aujourd’hui de lire dans le code génétique de l’homme. Mais
malheureusement pas le langage tout entier. La vérité fonctionnelle sur
l’homme est devenue visible. Mais la vérité sur lui-même – sur ce qu’il est,
d’où il vient, pour quel but il existe, en quoi consiste le bien ou le mal
–, cette vérité-là, malheureusement, ne peut pas être lue de cette manière.
Avec la connaissance croissante de la vérité fonctionnelle, semble plutôt
aller de pair un aveuglement croissant pour la « vérité » elle-même – pour
la question de savoir ce qu’est notre véritable réalité et ce qu’est notre
fin véritable.
Qu’est-ce que la vérité ? Cette question, comme étant sans réponse et
impossible pour sa tâche, n’a pas été mise de côté uniquement par Pilate. De
nos jours aussi, dans le débat politique tout comme dans la discussion à
propos de la formation du droit, on éprouve en général une certaine
difficulté à son égard. Mais sans la vérité, l’homme ne peut saisir le sens
de sa vie ; il laisse alors le champ libre aux plus forts. « Rédemption »,
dans le sens plénier du mot, ne peut consister que dans le fait que la
vérité devienne reconnaissable. Et elle devient reconnaissable, si Dieu
devient reconnaissable. Il devient reconnaissable en Jésus Christ. En lui,
Dieu est entré dans le monde et, ce faisant, il a dressé le critère de la
vérité au cœur de l’histoire. Extérieurement, la vérité est impuissante dans
le monde ; tout comme le Christ, selon les critères du monde, est sans
pouvoir : il n’a aucune légion à sa disposition. Il est crucifié. Mais c’est
justement ainsi, dans l’absence totale de pouvoir, qu’il est puissant, et
c’est seulement ainsi que la vérité devient toujours davantage une
puissance.
Dans le dialogue entre Jésus et Pilate, il est question de la royauté de
Jésus et donc de la royauté, du « règne » de Dieu. Dans le dialogue de Jésus
avec Pilate apparaît de manière évidente qu’il n’y a pas de rupture entre
l’annonce de Jésus en Galilée – le royaume de Dieu – et ses discours à
Jérusalem. Le point central du message jusqu’à la Croix – jusqu’à
l’inscription sur la Croix – est le royaume de Dieu, la royauté nouvelle que
Jésus représente. La vérité est, toutefois, au centre de cela. La royauté
annoncée par Jésus dans les paraboles et, finalement, ouvertement devant le
juge terrestre, est justement la royauté de la vérité. Ériger cette royauté
comme libération véritable de l’homme, voilà ce dont il s’agit.
Il devient évident, en même temps, qu’il n’y a aucune contradiction entre
l’accent mis sur le royaume de Dieu dans la période prépascale et celui mis
sur la foi en Jésus Christ, Fils de Dieu, dans la période postpascale. Dans
le Christ, Dieu est entré dans le monde – la vérité y est entrée. La
christologie est l’annonce, devenue concrète, du royaume de Dieu.
Après l’interrogatoire, ce que pratiquement Pilate savait déjà est devenu
évident. Ce Jésus n’est pas un agitateur politique, son message et son
comportement ne représentent pas un danger pour la domination romaine. S’il
n’a pas observé la Torah, que lui importe, à lui, Romain ?
Il semble pourtant que Pilate ait éprouvé une certaine crainte
superstitieuse devant cet étrange personnage. Pilate était certes un
sceptique. Mais en tant qu’homme de l’Antiquité, il ne pouvait toutefois pas
exclure que des dieux, ou, à tout le moins, des êtres semblables à des
dieux, puissent apparaître sous l’aspect d’êtres humains. Jean dit que les «
Juifs » accusaient Jésus de se faire Fils de Dieu, et il ajoute : « Lorsque
Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé » (19,8).
Je crois que nous devons tenir compte de cette peur chez Pilate : peut-être
y avait-il vraiment quelque chose de divin dans cet homme. En le condamnant,
peut-être se mettait-il contre une puissance divine. Sans doute devait-il
s’attendre à la colère de telles puissances. Je crois que son attitude
durant ce procès ne s’explique pas seulement en fonction d’un certain souci
de la justice, mais précisément aussi à cause de ces pensées.
Bien évidemment, les accusateurs s’en rendent compte et ils opposent alors à
cette peur une autre peur. À la peur superstitieuse face à une présence
divine possible, ils opposent la peur très concrète de tomber dans la
défaveur de l’empereur, de perdre sa position et de s’enfoncer ainsi dans
une situation privée de soutien. L’affirmation : « Si tu le relâches, tu
n’es pas ami de César » (Jn 19,12) est une menace. À la fin, le souci de sa
carrière est plus fort que la peur devant les puissances divines.
Mais avant la décision finale, nous devons encore, brièvement au moins,
considérer un épisode dramatique et douloureux qui se déroule en trois
actes.
Le premier acte consiste dans le fait que Pilate présente Jésus comme
candidat à l’amnistie pascale, cherchant ainsi à le libérer. Mais, ce
faisant, il s’expose à une situation fatale. Celui qui est proposé comme
candidat à l’amnistie est en fait déjà condamné. L’amnistie n’a de sens que
de cette manière. Si la foule a le droit d’acclamation, alors, après qu’elle
s’est prononcée, il faut considérer comme condamné celui qu’elle n’a pas
choisi. En ce sens, une condamnation est déjà tacitement incluse dans la
proposition de libération par le moyen de l’amnistie.
À propos de la confrontation entre Jésus et Barabbas et aussi sur la
signification théologique de cette alternative, j’ai déjà écrit de manière
détaillée dans la première partie de cette œuvre (cf. p. 60s.). Il suffit
donc ici de rappeler brièvement l’essentiel. Selon nos traductions, Jean
qualifie Barabbas simplement de « brigand » (18,40). Mais, dans le contexte
politique d’alors, le mot grec qu’il a utilisé avait aussi pris le sens de «
terroriste », ou plutôt de combattant de la résistance. Il est évident que
c’est le sens qui a été retenu dans le récit de Marc : « Or, il y avait en
prison le nommé Barabbas, arrêté avec les émeutiers qui avaient commis un
meurtre dans la sédition » (15,7).
Barabbas (« fils du père ») est une espèce de figure messianique ; dans la
proposition de l’amnistie pascale, deux interprétations de l’espérance
messianique se trouvent face à face. Selon la loi romaine, il s’agit de deux
délinquants accusés du même délit – ils sont en révolte contre la pax romana.
Il est clair que Pilate préfère l’« exalté » non violent, qu’était à ses
yeux Jésus. Mais les catégories de la foule et aussi des autorités du Temple
sont différentes. Si l’aristocratie du Temple en arrive au point de dire au
plus : « Nous n’avons d’autre roi que César ! » (Jn 19,15), il ne s’agit
qu’en apparence d’un renoncement à l’espérance messianique d’Israël : nous
ne voulons pas de ce roi-là. Ils désirent un autre genre de solution au
problème. L’humanité se trouvera toujours à nouveau confrontée à cette
alternative : dire « oui » à ce Dieu qui n’agit que par la force de la
vérité et de l’amour ou bien ne compter que sur ce qui est concret, sur ce
qui est à portée de la main, sur la violence.
Les partisans de Jésus ne sont pas présents sur le lieu du jugement, ils
sont absents par peur. Mais ils manquent aussi par le fait qu’ils ne se
montrent pas comme une masse. Leur voix se fera entendre à la Pentecôte par
la prédication de Pierre, qui alors « transpercera le cœur » de ces hommes
qui, auparavant, s’étaient décidés en faveur de Barabbas. À la question : «
Frères, que devons-nous faire ? », ils reçoivent cette réponse : «
Repentez-vous » – renouvelez et transformez votre manière de penser et
votre être (cf. Ac 2,37s.). Voilà le cri qui, devant la scène de Barabbas et
toutes ses rééditions, doit nous déchirer le cœur et nous conduire à changer
de vie.
Le deuxième acte est laconiquement résumé par Jean dans cette phrase : «
Pilate prit alors Jésus et le fit flageller » (19,1). La flagellation était
la punition qui, dans le droit pénal romain, était infligée comme châtiment
accompagnant la condamnation à mort (Hengel/Schwemer, p. 609). Selon Jean,
celle-ci apparaît comme un acte accompli durant l’interrogatoire – une
mesure que le préfet, en vertu de son pouvoir de police, était autorisé à
prendre. C’était une punition extrêmement barbare ; le condamné « était
frappé par plusieurs bourreaux jusqu’à ce qu’ils soient fatigués et que la
chair du délinquant pende en lambeaux sanguinolents » (Blinzler, p. 321).
Rudolf Pesch commente : « Le fait que Simon de Cyrène soit contraint de
porter à la place de Jésus le bras de la Croix et que Jésus meure si
rapidement est sûrement à relier à la torture de la flagellation, durant
laquelle certains délinquants mouraient déjà » (Markusevangelium II, p.
467).
Le troisième acte est le couronnement d’épines. Les soldats se moquent de
Jésus avec cruauté. Ils savent qu’il se prétend roi. Mais voici que
maintenant il se trouve entre leurs mains, et il leur plaît de l’humilier,
de faire montre de leur force à ses dépens, peut-être aussi de déverser sur
lui, de manière substitutive, leur rage contre les grands. Ils le revêtent,
lui – l’homme frappé et blessé sur tout le corps – des signes caricaturaux
de la majesté impériale : le manteau pourpre, la couronne d’épines tressée
et le sceptre de roseau. Et ils lui rendent hommage : « Salut, roi des Juifs
! » ; leur hommage consiste en gifles par lesquelles ils manifestent, encore
une fois, tout le mépris qu’ils ont pour lui (cf. Mt 27,28s. ; Mc 15,17s. ;
Jn 19,2).
L’histoire des religions connaît bien la figure du roi caricaturé – qui
s’apparente au phénomène du « bouc émissaire ». Tout ce qui angoisse les
hommes est déversé sur lui : de cette manière, on espère éloigner tout cela
du monde. Sans le savoir, les soldats accomplissent tout ce qui dans ces
rites et dans ces coutumes ne pouvait se réaliser : « Le châtiment qui nous
rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison »
(Is 53,5). Jésus est conduit devant Pilate sous cette apparence
caricaturale, et Pilate le présente à la foule – à l’humanité : Ecce homo –
« voici l’homme ! » (Jn 19,5). Sans doute le juge romain est-il bouleversé
devant la silhouette battue et bafouée de ce mystérieux accusé. Il compte
sur la compassion de ceux qui le voient.
Ecce homo – cette expression acquiert spontanément une profondeur qui va
bien au-delà de ce moment-là. En Jésus apparaît l’être humain en tant que
tel. En lui est rendue visible la misère de tous ceux qui sont frappés et
anéantis. Dans sa misère se reflète l’inhumanité du pouvoir humain, qui
écrase le faible. En lui se reflète ce que nous appelons « péché » : ce que
devient l’homme lorsqu’il se détourne de Dieu et prend en mains de manière
autonome le gouvernement du monde.
Mais il y a un autre aspect qui est vrai également : la profonde dignité de
Jésus ne peut lui être enlevée. Le Dieu caché reste présent en lui. L’homme
frappé et humilié reste aussi image de Dieu. Depuis que Jésus s’est laissé
frapper, toutes les personnes blessées et humiliées sont justement image du
Dieu qui a voulu souffrir pour nous. Alors, au cœur de sa Passion, Jésus est
une image d’espérance : Dieu est du côté de ceux qui souffrent.
Finalement Pilate s’assied sur le siège du juge. Il dit encore une fois : «
Voici votre roi ! » (Jn 19,14). Puis il prononce la sentence de mort.
Sans doute, la grande vérité, dont avait parlé Jésus, lui est restée
inaccessible ; mais la vérité concrète de ce cas, Pilate la connaissait
bien. Il savait que Jésus n’était pas un délinquant politique et que la
royauté qu’il revendiquait ne représentait aucun danger politique – il
savait donc qu’il devait être acquitté.
Comme préfet, il représentait le droit romain sur lequel reposait la pax
romana – la paix de l’empire qui s’étendait sur le monde. Cette paix, d’une
part, était assurée grâce à la puissance militaire de Rome. Mais, par la
seule force militaire, il n’est pas possible d’établir une paix quelconque.
La paix repose sur la justice. La force de Rome était son système juridique,
l’ordre juridique sur lequel les hommes pouvaient compter. Pilate – nous le
répétons – connaissait la vérité dont il s’agissait dans ce cas et il savait
donc ce que la justice exigeait de lui.
Mais, en fin de compte, c’est l’interprétation pragmatique du droit qui
l’emporta chez lui : il y a plus important que la vérité du cas présent,
c’est la force pacifiante du droit, voilà ce que fut peut-être sa pensée et
ainsi se justifiait-il à ses yeux. Absoudre l’innocent pouvait être source
d’ennuis non seulement pour lui personnellement – cette crainte fut
certainement un motif déterminant dans son comportement –, mais cela
risquait encore de provoquer d’autres désagréments et des désordres qui,
particulièrement au moment des fêtes de la Pâque, devaient être évités.
La paix fut en ce cas plus importante pour lui que la justice. Non seulement
la grande et inaccessible vérité devait passer au second plan, mais aussi
celle du cas concret : il crut ainsi accomplir le vrai sens du droit – sa
fonction pacificatrice. Ainsi, peut-être, apaisa-t-il sa conscience. Sur le
moment, tout sembla bien aller. Jérusalem resta calme. Toutefois le fait que
la paix, en dernière analyse, ne peut être établie contre la vérité, devait
se manifester plus tard.
►
Présentation de la seconde partie du Jésus de Nazareth de Benoît XVI le 10 mars
Sources : www.vatican.va
Salle de presse du Saint-Siège
-
E.S.M.
© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 02.03.2011 - T/Benoît XVI
|