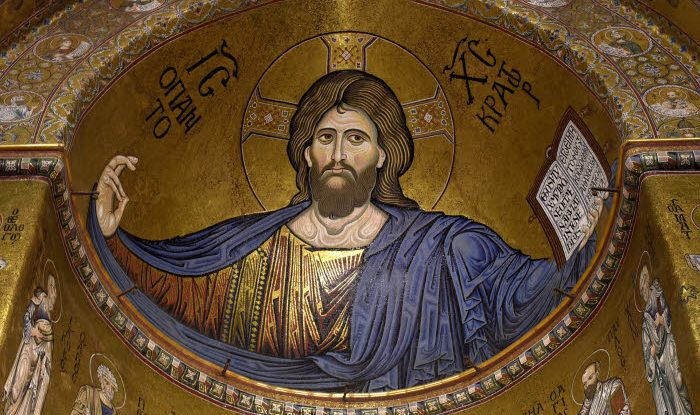 |
Benoît XVI : un message aussi dénué de contenu
|
Le 07 mars 2023 -
(E.S.M.)
-
Ne nous arrêtons pas au fait qu'un message aussi dénué de contenu,
grâce auquel on prétend mieux comprendre Jésus qu'il ne s'est
compris lui-même, aurait pu difficilement signifier quelque chose
pour qui que ce fût. Écoutons plutôt la suite : pour des raisons
difficiles à reconstituer, Jésus aurait été exécuté et serait mort,
après un échec total. Puis, on ne sait plus trop comment, serait née
la foi en la résurrection, l'idée qu'il était de nouveau vivant ou
tout au moins qu'il continuait à avoir une signification pour les
hommes. Peu à peu, cette foi se serait développée, pour aboutir à
l'idée, existant également ailleurs sous une forme semblable, selon
laquelle Jésus reviendrait plus tard comme Fils de l'homme ou comme
Messie.
|
|
Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme
-
Pour agrandir l'image
►
Cliquer
3) Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme
Revenons encore une fois à la question christologique au sens strict, pour
éviter de présenter nos considérations comme de simples affirmations ou même
comme une façon de se réfugier dans les problèmes actuels. Nous avions
constaté que l'adhésion chrétienne à Jésus équivalait à le reconnaître comme
Christ, c'est-à-dire comme celui en qui personne et œuvre sont identiques ;
à partir de là, nous avons découvert l'unité qui existe entre foi et amour.
La foi chrétienne, en se détournant des idées pures et de toute doctrine
abstraite pour se tourner vers le « Moi » de Jésus, conduit à un « Moi » qui
est ouverture totale, qui est tout entier « parole », tout entier « fils ».
Nous avons vu également que les concepts de « parole » et de « fils »
doivent exprimer le caractère dynamique de cette existence, sa pure
actualitas. La parole ne subsiste jamais en elle-même, elle vient de quelqu'un et elle est là pour être entendue, elle est donc ordonnée à d'autres.
Elle ne subsiste que dans la totalité de cette double relation : « à partir
de » - « pour ». Nous avions trouvé le même sens pour le concept de « fils
», qui exprime lui aussi cette suspension entre deux pôles. Tout cela
pourrait se résumer dans cette formule : la foi
chrétienne ne se réfère pas à des idées, mais
à une personne, à un « Moi », un « Moi
» défini comme
parole et fils, c'est-à-dire
comme ouverture totale. Or, cela entraîne deux
conséquences, où apparaissent la problématique interne de la foi (dans le
sens d'une foi en Jésus reconnu comme Christ, comme Messie), et le
nécessaire dépassement de cette foi, pour arriver au plein scandale de la
foi au Fils (foi en la divinité véritable de Jésus). Car si, comme nous
l'avons dit, la foi reconnaît dans le « Moi » de Jésus une pure ouverture,
un être tout entier « à-partir-du Père »; si, par toute son existence, ce «
Moi » est « Fils » - actualité d'un pur service - si, autrement dit, cette
existence n'a pas seulement de l'amour mais est amour,
n'est-elle pas alors nécessairement identique à
Dieu qui seul est l'amour ?
Jésus, le Fils de
Dieu, n'est-il pas alors lui-même Dieu ? N'est-il pas vrai alors que le «
Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu » (Jn 1, 1) ? Mais la question
inverse se pose également, pour nous forcer à dire : si cet homme est tout
entier ce qu'il fait, s'il est tout entier derrière ce qu'il dit, s'il est
tout entier pour les autres; si en se « perdant » ainsi, il reste pourtant
entièrement lui-même, s'il est celui qui s'est trouvé en se perdant (cf.
Mc 8, 35), n'est-il pas alors le plus humain des hommes, la plénitude
même de l'humain ? Avons-nous alors encore le droit de résorber la
christologie (discours sur le Christ) dans la théologie (discours sur Dieu)
? Ne devons-nous pas plutôt revendiquer Jésus passionnément comme homme,
et faire de la christologie un humanisme, une anthropologie ? Ou alors
l'homme authentique, par le fait même qu'il est entièrement et
authentiquement homme, serait-il Dieu, et Dieu serait-il précisément l'homme
authentique ?
Serait-il possible que l'humanisme le plus radical et la foi au Dieu de la
révélation se rejoignent ici jusqu'à se confondre ?
On peut voir, je crois, que ces questions, dont la force a
ébranlé l'Église des cinq premiers siècles, surgissent spontanément de la
confession de foi christologique ; la lutte dramatique qui s'esl livrée
alors autour de ces questions, a abouti, dans les conciles œcuméniques de
l'époque, à une réponse affirmative aux trois questions. Ce triple « oui »
constitue la substance et la forme définitive du dogme christologique
classique ; il ne visait qu'à rester entièrement fidèle à la modeste
confession de foi primitive en Jésus, reconnu comme «
Christ ». Autrement
dit : si Jésus est radicalement Christ, comme le dogme christologique
explicité l'affirme, cela suppose qu'il est Fils, et s'il est Fils,
cela
implique qu'il est Dieu. Pour rester un énoncé conforme au logos,
intelligible, le dogme doit être compris de cette manière, sinon on tombe
dans le mythe, en ne tirant pas cette conséquence. Mais il affirme aussi
catégoriquement que Jésus est, dans la radicalité de sa diaconie, le plus
humain des hommes, l'homme véritable. Il reconnaît ainsi que théologie et
anthropologie se compénètrent, ce qui constitue dès lors le caractère
vraiment exaltant de la foi chrétienne.
Mais une autre question se pose : si vraiment il n'est pas
possible d'échapper à la logique développée ici, s'il faut donc admettre la
conséquence qui découle logiquement du dogme, il reste tout de même le
critère décisif des faits : est-ce que, avec ce beau système, nous ne nous
serions pas élevés dans les hautes sphères de la pensée, en laissant
derrière nous la réalité ? Mais alors la logique incontestable du système ne
nous servirait à rien, à cause de l'absence de fondement. En d'autres
termes, il faut demander si les données de la Bible et l'éclairage critique
sur les faits nous autorisent à concevoir l'être filial de Jésus comme nous
venons de le faire, d'après le dogme christologique. A cette question, l'on
répond aujourd'hui de plus en plus franchement par la négative, comme allant
de soi. Aux yeux de beaucoup, la réponse affirmative apparaît comme une
position pré-critique, à peine digne de considération. Contre cela, je
voudrais essayer de montrer que la réponse affirmative non seulement
est
justifiée, mais s'impose, si l'on ne veut pas tomber, ou bien dans des
élucubrations rationalistes sans consistance, ou bien dans des
représentations mythologiques du fils, dépassées et surmontées par la foi
biblique au Fils et par l'explication donnée par l'Église ancienne12.
II. UN CLICHÉ MODERNE A PROPOS DU « JÉSUS HISTORIQUE »
II faut avancer lentement. Qui était au juste ce Jésus de
Nazareth ? Comment se comprenait-il ? A en croire le cliché qui commence à
se répandre largement aujourd'hui, comme présentation vulgarisée de la
théologie moderne13, les choses se seraient passées de la manière suivante
: il faudrait se représenter le Jésus historique comme une sorte de docteur
prophétique, apparu dans l'atmosphère d'exaltation eschatologique du
judaïsme tardif. Il aurait annoncé, conformément à cette situation imprégnée
d'eschatologie, la proximité du royaume de Dieu, affirmation tout d'abord à
sens strictement temporel : maintenant, très bientôt, arrivera le royaume de
Dieu, la fin du monde. D'autre part, Jésus aurait tellement mis l'accent sur
le « maintenant », que l'aspect de futur temporel ne pourrait plus être
considéré, par celui qui regarde les choses en profondeur, comme le message
authentique. Celui-ci consisterait plutôt - même si Jésus lui-même pensait à
un futur, à un royaume de Dieu - dans l'appel à la décision : l'homme serait
désormais entièrement engagé à l'égard du « maintenant
» qui vient
continuellement à sa rencontre.
Ne nous arrêtons pas au fait qu'un message aussi
dénué de
contenu, grâce auquel on prétend mieux comprendre Jésus qu'il ne s'est
compris lui-même, aurait pu difficilement signifier quelque chose pour qui
que ce fût. Écoutons plutôt la suite : pour des raisons difficiles à
reconstituer, Jésus aurait été exécuté et serait mort, après un échec total.
Puis, on ne sait plus trop comment, serait née la foi en la résurrection,
l'idée qu'il était de nouveau vivant ou tout au moins qu'il continuait à
avoir une signification pour les hommes. Peu à peu, cette foi se serait
développée, pour aboutir à l'idée, existant également ailleurs sous une
forme semblable, selon laquelle Jésus reviendrait plus tard comme Fils de
l'homme ou comme Messie. Dans une autre étape, on aurait projeté finalement
cette espérance sur le Jésus historique,
on l'aurait mise dans sa propre
bouche et l'on aurait modifié en conséquence la signification de sa
personne. On aurait présenté les choses comme s'il s'était proclamé lui-même
le Fils de l'homme ou le Messie à venir. Très vite, toujours d'après notre
cliché, le message aurait passé du monde sémitique dans le monde
hellénistique, entraînant des conséquences très importantes. Dans le monde
sémitique l'on avait interprété Jésus selon les catégories juives (Fils de
l'homme - Messie) ; ces catégories, n'ayant pas de sens dans le monde
hellénistique, auraient alors été adaptées à des concepts hellénistiques.
Aux schèmes sémitiques de Fils de l'homme et de Messie, on aurait substitué
la catégorie hellénistique de l' « homme divin » ou de l'« homme-Dieu » (θεἴὸς
ἀνήρ), pour rendre intelligible la figure de Jésus.
Or, l' « homme-Dieu », au sens de l'hellénisme, serait
caractérisé surtout par deux attributs : il est thaumaturge et d'origine
divine. Ce dernier attribut signifie qu'il est, d'une manière ou d'une
autre, issu de Dieu qui est son Père ; son origine mi-divine, mi-humaine est
précisément ce qui fait de lui un homme-Dieu, un homme divin. Le transfert
de la catégorie de l'homme divin aurait entraîné également le transfert sur
Jésus des deux attributs ci-dessus mentionnés. On aurait ainsi commencé à le
présenter comme thaumaturge ; le mythe de la naissance virginale aurait été
créé pour la même raison. Ce mythe, à son tour, aurait conduit à désigner
Jésus comme Fils de Dieu, parce que Dieu apparaissait maintenant, d'une
manière mythique, comme son père. De cette façon, l'interprétation
hellénistique, en faisant de Jésus un « homme divin », avec toutes les
particularités en découlant, aurait finalement transformé l'événement de la
proximité de Dieu, caractéristique de Jésus, en l'idée « ontologique » de
l'origine divine. La foi primitive de l'Église aurait continué à progresser
dans cette voie mythique jusqu'à la fixation définitive du tout dans le
dogme de Chalcédoine, avec sa conception de la filiation divine ontologique
de Jésus. Ce concile, en affirmant l'origine divine ontologique de Jésus,
aurait changé le mythe en dogme, l'entourant de spéculations abstruses, à
tel point que cette assertion mythique serait finalement devenue le schibboleth
de l'orthodoxie ; l'on aurait abouti ainsi à un complet
renversement par rapport au point de départ.
Pour qui pense en historien, tout cet ensemble constitue un
tableau absurde, même s'il trouve aujourd'hui des adeptes en foule. Pour ma
part, confesse Benoit XVI, j'avoue que vraiment, même abstraction faite de la foi chrétienne et
uniquement de par ma pratique de l'histoire, je suis plus volontiers et plus
facilement porté à croire que Dieu soit devenu homme qu'à croire à la vérité
d'un tel conglomérat d'hypothèses. Malheureusement, il ne nous est pas
possible, dans le cadre de cet ouvrage, d'entrer dans les détails de la
problématique historique; cela demanderait une recherche très vaste et très
longue. Nous devons plutôt (et nous en avons le droit) nous limiter au point
décisif, autour duquel tourne tout le reste : la filiation divine de Jésus.
Si l'on aborde la question avec une rigueur de langage qui évite de mélanger
les choses que l'on aimerait voir reliées ensemble, l'on peut arriver aux
constatations suivantes.
A suivre : A propos de l' « homme divin »
Notes :
12. Par là, on ne veut évidemment pas reprendre la tentative, rejetée plus
haut comme impossible, d'une construction de la foi à partir de l'histoire;
il s'agit ici de dégager la légitimation historique de la foi.
13. Parler d'une « forme de vulgarisation de la théologie moderne », c'est
dire en même temps déjà que dans les études de spécialistes les choses sont
présentées de façon plus nuancée et avec également une grande diversité dans
le détail. Mais les apories restent les mêmes et il ne suffit donc pas de
recourir à l'échappatoire habituelle en disant que les choses ne sont
évidemment pas si simples que cela.
Conseil de lecture :
►
Dans le Christ, vrai Dieu et vrai Homme, nous avons connu l’amour dans toute
sa signification (Message de Benoît XVI pour la Journée Mondiale
de la Jeunesse)
►

|
Les
lecteurs qui désirent consulter les derniers articles publiés par le
site
Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent cliquer
sur le lien suivant
► E.S.M.
sur Google actualité |
Sources :Texte original des écrits du Saint Père Benoit XVI -
E.S.M.
Ce document est destiné à l'information; il ne
constitue pas un document officiel
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 07.03.2023
|